
Gustave Courbet
Ornans, 1819 - La Tour-de-Peilz (Suisse), 1877
« Courbet, c’est mieux que tout. »
Édouard Manet
« Son grand apport, c'est l'entrée lyrique de la nature, de l'odeur des feuilles mouillées,
des parois moussues de la forêt, dans la peinture de dix-neuvième siècle
[...]. Et la neige, il a peint la neige comme personne ! »
Cézanne
« Jusque-là, le peintre était un monsieur à la solde d'un roi ou d'un empereur, ou même d'un groupe de collectionneurs. Mais du jour où Courbet a commencé, c'est devenu le contraire. Il a dit :
“Je fais un tableau Monsieur le Collectionneur vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre,
je ne le changerai pas, c'est à vous de vous soumettre à mes volontés” »
Marcel Duchamp
articles sur Gustave Courbet :
— Courbet et les deux amies, Sandor Kuthy,
— Salon de 1853, Théophile Gautier,
— Gustave Courbet à la tour de Peilz, Dr Paul Collin,
— Courbet, Champfleury,
— L'Enterrement à Ornans, 1880-1943, Champfleury.
— Courbet, Pierre Mac Orlan.
— Courbet, outre-monde, Christian Perret.
— Peut-on enseigner l'art ?, Gustave Courbet.
— Gustave Courbet, l'abbé Brune.
— Gustave Courbet, wikipedia.
Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans, près de Besançon (Doubs), et mort le 31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz en Suisse, est un peintre et sculpteur français, chef de file du courant réaliste.
Il est principalement connu pour le réalisme de ses œuvres opposées aux critères de l'académisme et transgressant la hiérarchie des genres, comme Un enterrement à Ornans  (1850), qui provoqua le scandale chez ses contemporains.
Anticlérical, ami de Proudhon et proche des anarchistes, il fut l'un des élus de la Commune de Paris de 1871. Accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme, il est condamné à la faire relever à ses propres frais. Réfugié en Suisse, il meurt avant d'avoir commencé à rembourser. (source: wikipedia)
(1850), qui provoqua le scandale chez ses contemporains.
Anticlérical, ami de Proudhon et proche des anarchistes, il fut l'un des élus de la Commune de Paris de 1871. Accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme, il est condamné à la faire relever à ses propres frais. Réfugié en Suisse, il meurt avant d'avoir commencé à rembourser. (source: wikipedia)

Sandor Kuthy, Berner Kunstmitteilungen, n° 222/223, juin/juillet 1983, p.1- 9. (traduction de l'allemand par l'auteur).
Courbet a peint une dizaine de tableaux représentant deux femmes. Dès la première fois où il en exposait un, critiques et public ressentaient le sujet comme équivoque et exprimaient leur désarroi, et même leur hostilité sans retenue.
Prenons deux exemples :
En visite au Salon de Paris en 1853 la veille de l’ouverture, l’empereur Napoléon III « donnait un coup de cravache au tableau »1.
Eugène Delacroix, lui, se rendait au Salon tout spécialement pour voir les œuvres de son jeune collègue, dont on parlait de plus en plus. Il confiait à son journal des sentiments fort mitigés :
« J’avais été voir les peintures de Courbet… J’ai été étonné de la vigueur et de la saillie de son principal tableau… mais quel tableau ! quel sujet ! La vulgarité des formes ne ferait rien ; c’est la vulgarité et l’inutilité de la pensée qui sont abominables ; et même au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle, était claire !… Ô Rossini ! Ô Mozart ! Ô les génies inspirés dans tous les arts qui tirent des choses seulement ce qu’il en faut montrer à l’esprit ! Que diriez-vous devant ces tableaux ! »2.
Courbet ne répondait pas à ces critiques, il ne donnait aucune explication concernant son sujet dont la « vulgarité et l’inutilité de la pensée (seraient) abominables ». Ce n’est que dans une lettre adressée à ses parents après le vernissage que l’on trouve une brève allusion. Il écrit y avoir apporté un changement en y ajoutant « un linge sur les fesses »3.. À l’origine, cette femme « vulgaire » était donc en plus toute nue ! Courbet s’était rendu compte qu’il exagérait parce que le tableau « épouvante un peu »4


musée du Petit-Palais, Paris. Fig. 2

musée des beaux-arts de Nantes. Fig. 3
Pour dissiper le malaise ressenti par des personnes aussi différentes que Delacroix ou Napoléon III, pour clarifier cette chose « abominable » à laquelle il faisait allusion sans jamais la nommer, il lui a fallu treize ans. C’est, en effet, le temps dont Courbet a eu besoin pour représenter sans ambiguïté ce rapport particulier entre deux amies, peint pour la première fois en 1853 sous le titre Baigneuses (fig.1). Et c’est en 1866, qu’avec Paresse et luxure (fig. 7), deux corps nus, couchés, enlacés, scène érotique par excellence, qu’il clarifiait le sens réel du sujet. Après cette mise au point, il n’y reviendra plus. Entre-temps, il aura varié le thème des deux amies avec une étonnante régularité, tous les deux ans (au rythme des Salons de Paris), dans une ou plusieurs compositions en leur donnant des titres divers :
— 1853 : Les Baigneuses (140)5 (détail), Musée Favre, Montpellier, fig. 1
— 1856 : Les Demoiselles au bord de la Seine (203), Musée du Petit Palais, Ville de Paris , fig. 2
— 1858 : Baigneuses (autre titre : Les deux amies) (229), Musée des beaux-arts, Nantes, fig.3
— 1860 : Amour et Psyché (copie d’une peinture ancienne, découverte chez un collectionneur à Montpellier, un tableau au sujet « quelque-peu équivoque »), localisation inconnue6.
— 1862 : L’étang dans la forêt (autre titre : Deux baigneuses) (329)
Paysage près de Saintonge (330)
Baigneuses dans la forêt (331).
— 1864 : Vénus et Psyché (370), détruit, fig. 4
Le réveil (371), fig. 5
— 1866 : Le réveil(533), Musée des beaux-arts de Berne, fig. 6
Paresse et luxure (532), Musée du Petit Palais, Ville de Paris, fig. 7

détruit. Fig. 4


musée des beaux-arts de Berne. Fig. 6

musée des beaux-arts de Berne. Fig. 7
À l’exception des trois tableaux de 1862, où les deux amies ne sont que des figurantes, on lit aisément la progression du thème. Le peintre commence par une situation un peu ambiguë. Par la suite viennent des scènes à caractère mythologique, jusqu`à ce qu’en 1866 tout devienne clair : avec Paresse et luxure on se trouve devant un hymne à l’amour lesbien et, au-delà, à l’amour sans distinction de sexe, à l’érotisme tout court, dans un tableau majestueusement peint.
La démarche de Courbet vers l’énoncé de ce thème choquant est hésitante. Pour commencer, il recouvre, ultérieurement, les fesses de la Baigneuse. De même, dans Les femmes dans les blés, dessin préparatoire des Demoiselles au bord de la Seine, 1855 (40), la tête de l’une repose sur l’épaule de l’autre – sur le tableau la posture est nettement moins intime (fig. 2). Le cadre, où, successivement, le peintre place les deux amies, change aussi. Le sous-bois, puis l’eau où elles s’apprêtent à se baigner, cèdent la place, en 1864, à l’atmosphère intime d’un grand lit à baldaquin. Le peintre devient de plus en plus précis et dans les poses, et dans les gestes. La brune se penche sur la rousse et, tous les deux ans, se rapproche un peu plus de son amie ; pour finir — dans Paresse et luxure — les deux amies s’enlacent, après avoir échangé leurs places.
Les Baigneuses de 1853 n’est pas la toute première composition ou Courbet représente deux femmes. Déjà en 1840, en peignant Loth et ses filles (13), il peint deux sœurs qui entre elles décident : « couchons avec lui afin de donner une descendance issue de notre père ». Mais ici il s’agit d’une histoire biblique7, d’une illustration, et non pas d’un thème qu’il invente. Les cribleuses de blé (166) sont deux également, mais accompagnées d’un enfant qui fouille dans le tiroir d’un meuble. Il y a aussi quelques esquisses dans un carnet de croquis, par exemple Femme nue couchée à qui un ange qui plane semble parler8. L’ange dessiné par Courbet n’est pas, contrairement à la tradition, un homme, mais une femme. Cette étude est un pas de plus vers l'idée développé dans Paresse et luxure. Après cette suite des deux amies, Courbet ne peindra plus de tableaux à caractère érotique9.
Il est évident, pour chacune de ces quatre compositions, que le peintre a eu recours à un seul et même modèle pour peindre les deux amies. La rousse est aussi la brune. C’est le même corps et le même visage10. L’identité de la rousse — qui selon le libre choix du peintre peut aussi être brune — est connue. Courbet a fait son portrait en 1866. Il s’agit de La belle Irlandaise, appelée aussi Jo, la Femme d’Irlande (fig. 9), la splendide rousse, dont Courbet admire la beauté et qui fut pendant plusieurs années son modèle. Elle était pour Courbet bien plus qu’un modèle parmi d’autres.
Il semble évident que Courbet aimait passionnément Jo. C’est à cette passion que nous devons quelques-unes des plus belles œuvres de l’artiste. Si personne n’en parle, si aucun document ne s’y réfère, c’est dû à sa sœur Juliette, à l’image immaculée qu’elle voulait transmettre de lui à la postérité. En effet, Juliette est l’inspiratrice de l’importante biographie consacrée par Georges Riat à Courbet, parue après sa mort. L’image du frère y est soigneusement épurée. Et pourtant, plusieurs tableaux témoignent de la passion pour Jo et sont confirmés par des recoupements biographiques.
Commençons avec le Portait de Jo de 1865 (447) ou, encore mieux, avec La belle Irlandaise, 186611. Courbet copie ce portrait à deux reprises, démarche inhabituelle pour lui, car deux acheteurs veulent l’acquérir. Il garde l’original, l’emporte dans son exil en Suisse et le présente, en 1876, à Lausanne et à Berne, dans le cadre de l’Exposition de l’art Suisse. Il précise qu’il prête trois tableaux importants ; le portrait de Jo n’est pas à vendre. En dehors de ces deux portraits, on identifie facilement la tête et le corps de Jo parmi les peintures de ces années, notamment dans les amies de 1864 et de 1866. Ajoutons à cela, sans prétendre à être exhaustifs, deux autres exemples12.
Dans la prison parisienne Sainte-Pélagie où il est enfermé du 22 septembre 1871 au 6 janvier 1872, Courbet a la possibilité de peindre. On connaît des natures-mortes, un autoportrait et un Portrait de Roussotte (783)13. Ce portrait que Courbet peint de mémoire alors qu’il est profondément déprimé, est celui de Jo. Il y peint aussi « sur la muraille, à côté de son lit, une magnifique tête de jeune fille, avec une fleur dans les cheveux, qui semblait reposer sur l’oreiller ; le directeur, abusé par ce trompe-l’œil, faillit se trouver mal à la vue d’une femme couchée dans le lit d’un prisonnier, puis il se mit à rire, son erreur reconnue »14. Il n’y a pas à douter que Jo représentait pour le peintre plus que n’importe laquelle de ses modèles. La deuxième peinture dont il faut parler est celle sur laquelle Jo apparaît différemment. C’est en 1866 que Courbet peint L’Origine du monde (530, fig.10). Courbet dit de cette peinture : « Vous trouvez cela beau…et vous avez raison… Oui, cela est très beau, et tenez, Titien, Véronèse, leur Raphaël, MOI-MÊME, nous n’avons jamais rien fait de plus beau »15. Il n’existe pas de preuve matérielle qui prouverait que Jo fut le modèle de L’Origine du Monde. Mais cela ne peut être qu’elle, si belle était aux yeux de l’artiste cette femme et tellement il l’a peinte « con amore » (Maxime du Camp). Il est par ailleurs hautement improbable que le rapport entre le peintre et le modèle de cet étonnant « portrait » ne fut que visuel.
Les biographies de Courbet ne mentionnent que rarement Jo, et comme modèle seulement. Pour en apprendre plus sur elle, on doit chercher dans les biographies du peintre américain James Mc Neil Whistler.

Symphonie en blanc, N° 2 : La Femme en blanc,
1864, Tate Gallery, Londres. Fig. 8.
.jpg)
Nationalmuseum, Stockholm, Fig. 9

musée d'Orsay, Paris. Fig. 10
Courbet fit la connaissance de Whistler, de quinze ans son cadet, en 1858, lorsque celui-ci finit ses études de peinture à l’École des beaux-arts à Paris. Une amitié immédiate s’établit entre eux, Whistler considérant alors Courbet comme son maître spirituel. Jusqu’en 1863, Whistler séjourne alternativement à Paris et à Londres. À partir de 1860, son modèle préférée et maîtresse, Jo Hiffernan, le suit dans ses déplacements. Entre 1860 et 1865, on l’identifie sur une dizaine de tableaux de Whistler. Celui-ci écrit à son ami Fantin-Latour que la chevelure de Jo « n’est pas rouge-or, mais rouge cuivre, exactement comme le rêvaient les Vénitiens ! »16 (fig. 8). Jo était Irlandaise, de religion catholique romaine.
Courbet a fait la connaissance de Jo dans l’atelier parisien de Whistler, boulevard de Batignolles, en hiver 1861/62. C’est en 1864 qu’il a fait le premier portrait d’elle. À la fin d’été 1865, Jo, Whistler et Courbet séjournaient pendant plusieurs mois à Trouville. Whistler a peint Courbet debout devant l’horizon infini dans Harmonie en bleu et argent : Trouville17, cependant que Courbet faisait son premier portrait de Jo.
Peu après leur retour à Paris, Whistler décide soudain de partir à Valparaiso pour soutenir les Chiliens contre l’Espagne. Avant son départ, le 31 janvier 1866, il donne plein pouvoir à Jo sur tout ce qu’il possède. À son retour, en septembre, Whistler et Jo se séparent à l’amiable. Whistler retourne en Amérique du Sud. En août, de nouveau à Paris, Whistler écrit une lettre incendiaire à son ami Henri Fantin-Latour au sujet de Courbet, il fustige son « maudit réalisme » et dit n’avoir jamais subi son influence. Juste avant, Courbet avait peint Le Réveil (fig.7), Paresse et luxure et, surtout, l’Origine du Monde !
Courbet avait une vie amoureuse mouvementée18. Sa liaison avec Virginie Binet a duré quinze ans. Courbet n’a jamais reconnu leur fils, Désiré Alfred Émile, né en 1847, « enfant naturel » selon son acte de naissance. Devenu ivoirier à Dieppe, il y est mort à l’âge de vingt-cinq ans.
En 1861, Juliette Courbet, d’Ornans, et son amie Lydie Jolicler, de Pontarlier, voulurent marier Courbet et Céline N., de Lons-le-Saunier. Les lettres de Courbet écrites à « Mademoiselle Céline » ne laissent aucun doute concernant son engagement sérieux19. Or, en Septembre 1861, lors de son séjour à Trouville en compagnie de Jo et de Whistler, Courbet informe les siens à Ornans qu’il prolonge son séjour. Deux mois plus tard, de retour à Paris, il écrit à son père qu’il est « las de toutes ces balivernes qu’on lui a contées, et qu’il a tout envoyé au diable »20. Suivent deux mois plus tard le départ inopiné de Whistler au Chili, les peintures susmentionnées de Courbet et peu de temps après, la rupture de Whistler et de Jo. Mais poursuivons !
Nous constatons, un peu surpris, s’agissant « seulement » d’un des nombreux modèles de son frère, que Juliette Courbet était très bien informée sur Jo Hiffernan. Après la mort de son frère, elle la rencontre à Nice (cela ne peut être un pur hasard). Jo y vivait depuis la guerre de 1870 et s’appelait Madame Abbott. D’après Juliette, Jo et Whistler ont eu un enfant (ce qu’ignorent les biographes du peintre !). Elle dit aussi que Jo Abbott « a des tableaux de Gustave, c’est une Parisienne établie ici depuis la guerre, c’est la Belle Irlandaise, qui nous raconte mille et mille choses. C’est chez elle, elle est mariée, où se donnent rendez-vous toutes les célébrités artistiques parisiennes. Elle invite à aller la voir tous les jours »21.
Le sens de la discrétion de Juliette se reflète dans la biographie de Courbet par Riat. Courbet y est présenté sans taches, sans ses principales faiblesses à savoir son fils non reconnu, sa passion amoureuse pour Jo, ou encore sa consommation démesurée d’alcool. Présenter l’œuvre et la vie d’un grand artiste dans toute sa complexité ne signifie nullement ternir sa réputation. En particulier, sa passion pour Jo a considérablement enrichi son œuvre picturale. Les peintures où Jo est représentée sont de qualité artistique exceptionnelle.
Quelques mois avant sa mort, Courbet, depuis son exil en Suisse, à La Tour-de-Peilz, reprit contact avec Whistler. Il sollicita son aide pour des ventes de tableaux. Cependant la première partie de la lettre est entièrement consacrée à leur séjour à trois à Trouville :
«Tour de Peilz, canton de Vaud
14 fevrier 1877
Mon cher Whistler
Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus, c’est domage (sic !), car les idées s’échangent.
Où est le temps mon ami où nous étions heureux, et sans autres soucis que ceux de l’art, rappelez-vous Trouville et Jo qui faisait le clown pour nous égayer. Le soir elle chantait si bien les chants Irlandais elle avait l’esprit et la distinction de l’art. Je me rappelle aussi de notre démenagement à la ficelle du casino hôtel de la mer où nous prenions des bains sur la plage gelée et des saladiers de crevettes au beure (sic) frais sans compter la cotelette au déjeuner ce qui nous permettait ensuite de peindre l’espace la mer et les poissons jusqu’à l’horizon, nous nous sommes payés du rêve et de l’espace.
J’ai encore le portrait de Jo que je ne vendrai jamais, il fait l’admiration de tout le monde… »22.
Courbet et Jo se sont connus en 1861, elle a été son principal modèle autour de 1866, elle a quitté Paris en 1870. Leur relation a duré plusieurs années. On ignore quand et pourquoi ils se sont séparés. Mais le portrait de Jo que Courbet a emporté dans son exil et gardé jusqu’à sa mort, ou celui peint de mémoire en prison sur le mur de sa cellule, ainsi que la lettre qu’il a écrite à Whistler permettent à eux seuls de souligner combien Jo a été importante pour lui et pour son œuvre.
Avec le concours et l'aimable autorisation de Sandor Kuthy,
ancien conservateur du musée des beaux-arts de Berne.
Notes
1) ↑— cf. George Riat : Gustav Courbet, Paris 1906 pp.104/105
2) ↑— idem p.105, où est cité le journal de Delacroix.
3) ↑— idem p. 102, lettre de Courbet à ses parents : « pour les Baigneuses ça épouvante un peu, depuis vous, j’y ai ajouté un linge sur les fesses »
4) ↑— idem
5) ↑— les chiffres entre parenthèses qui suivent les titres des peintures indiquent leurs numéros dans Robert Fernier : La vie et l’œuvre de Gustave Courbet, Lausanne/Paris 1978, tome I. 1819-1865 Peintures, tome II. 1866-1877 Dessins, Sculptures.
6) ↑— Genèse 19, 30-38.
7) ↑— Fernier tome I. p.113
8) ↑— Idem tome II. p. 271, P. 37
9) ↑— Courbet n’a pas peint de couples homme-femme à l’exception des autoportraits de jeunesse p.ex. Les amants dans la campagne, 1844 (46)
10) ↑— La ressemblance des modèles n’a pas encore été signalée.
11) ↑— Riat p. 228 — l’auteur est enthousiaste : « Courbet l’a représentée en buste, de profil à gauche, la gorge voilée d’une chemisette blanche ; de la main gauche elle tient un miroir, où elle admire son magnifique teint clair de rousse, tandis que de la droite elle soulève les boucles de son opulente chevelure. Ce splendide portrait est daté de Trouville, 1866 »
12) ↑— p.ex. La réflexion, 1864 (430), Femme endormie aux cheveux roux, 1864 (373), Femme au perroquet, 1866 (526), Femme couchée, 1866 (527), Femme nue, 1866 (528), Baigneuse, 1866 (535), Femme à la vague, 1868 (628)
13) ↑— Riat, p. 332
14) ↑— Riat, p. 326
15) ↑— Fernier Nr. 530
16) ↑— A.M.L.Young/M.MacDonald/R.Spencer : The Paintings of James McNeil Whistler, New York, Haven and London 1980 p. 35. Jo était le modèle de nombreuses peintures de Whistler p.ex. : 35, 38, 40, 44, 52, 60, 61, 62, 63, toutes entre 1860 et 1865. Whistler avait une vision de Jo très différente de celle de Courbet ; Ce n’est que dans une gravure qu’on reconnaît aisément qu’il s’agissait de la même femme ; cf. Th. Duret : Histoire de J.Mc.N. Whistler et son œuvre, Paris 190, Portrait de Joe, fig. p.20
17) ↑— Isabelle Stewart, Gardner Museum, Boston. Cf. Young, idem Nr. 64
18) ↑— Fernier : Courbet et les femmes, in : Les amis de Gustave Courbet, Bulletin n° 33-34 Paris/Ornans 1965 p. 9-14
19) ↑— Riat, p. 221
20) ↑— Catalogue de l’exposition Courbet au Grand Palais, Paris 1977/78 n° 90
21) ↑— Idem. pp. 179/180 – cf. Bibliothèque Nationale. Estampes boîte VI. Lettre de Juliette Courbet à Castagnary du 18 décembre 1882.
22) ↑— Lettre de Courbet à Whistler, 14 février 1877, au Glasgow University Library, Shelfmark Whistler C 196.

Théophile Gautier, Feuilleton de La Presse, 21 juillet 1853.
Il se fait depuis trois ans beaucoup de bruits autour du nom de M. Courbet ; il a des fanatiques et des dénigreurs outrés. Selon les premiers, tout est admirable chez M. Courbet; selon les seconds tout est détestable, en sorte que le public ne sait trop à quoi s'en tenir sur le jeune peintre d'Ornans, qui est entré dans le domaine des arts comme un paysan du Danube, vêtu d'un sayon de peau de bique, des sabots pleins de paille aux pieds, un bonnet de coton sur la tête, une pipe culottée au coin de la bouche, un bâton de houx retenu au poignet par une ganse de cuir.
Que cette rusticité soit sincère ou non, elle a produit un effet de surprise, et M. Courbet a obtenu tout de suite une réputation qui n'est ordinairement le fruit que de longues années de travail. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit le proverbe ; il n'y a pas de vogue sans motif, ajouterons-nous. Quel élément nouveau apporterait M. Courbet pour soulever tant de discussions tumultueuses et passionnées ?
De tout temps la peinture s'est divisée en deux caps: les idéalistes et les réalistes ; pour les uns, l'art n'est que le moyen ; pour les autres, il est le but. Les idéalistes empruntent à la nature des formes pour revêtir le type qu'ils portent en eux ou vers lequel ils aspirent ; les réalistes se contentent de la reproduction brute et sans choix de la nature elle-même : Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Corrège, Lesueur, Poussin, sont de la première école ; le Caravage, le Guerchin, l'Espagnolet, le Calabrèse, le Valentin, Ostade et presque tous les Flamands sont de la seconde. Notre intention n'est pas de comparer M. Courbet à aucun de ces maîtres encore si élevés, mais la question est la même : rompre violemment avec l'antique et les traditions du beau, peindre dans toute leur disgrâce, les laideurs les plus rebutantes avec une grossièreté volontaire de touche, tel est le programme que s'est imposé M. Courbet, et il le suit fidèlement. Seulement, comme les réalistes dont nous venons de citer les noms, il ne relève pas la trivialité de ses modèles par de grands partis d'ombre et de clair-obscur, par la sauvagerie de l'exécution et la puissance de l'effet ; la traduction mot-à-mot de la nature la plus commune, qu'il vulgarise encore, lui semble être la mission de l'artiste ; la lettre qu'il a écrite aux journalistes et où il se défend d'être l'élève de M. Hesse, qui ne serait guère flatté d'un pareil disciple, à part son petit grain de vanité puérile, est logique avec son système. Il prétend recevoir des objets l'impression directe et ne rien emprunter à la science de ses devanciers. Examinons les trois tableaux envoyés par M. Courbet, qui expose sa doctrine à des degrés différents.

Le meilleur de tous est assurément La Fileuse. Une grosse fille aux cheveux roux qui s'est endormie en filant. Sa têtes s'incline lourde de sommeil ; ses mains laissent échapper la quenouille garnie de filasse et la roue du rouet ne fait plus entendre son ronflement. C'est Marguerite, servante dans une auberge de rouliers ; les passages de la joue au col, avec leurs plis gras sont d'une couleur superbe. La vie habite ces formes lourdes ; si ce n'est de la chair, c'est au moins de la viande ; le fichu rayé de blanc et de bleu qui voile l'épais corsage de la donzelle s'ajuste à plis souples et vrais, et se soulève bien avec le souffle de la dormeuse ; la robe d'indienne à gros bouquets de fleurs est parfaitement peinte, mais les mains pèchent par le dessin ; elles ont l'air de spatules de bois, et sont d'ailleurs trop petites. Cette maritorne doit avoir de bonnes grosses mains rouges d'engelures, grasses d'eau de vaisselle, en harmonie avec sa face rougeaude et charnue. Ce tableau, d'une couleur sobre, forte et vraie dans sa trivialité, a quelques-unes des qualités de Lenain. Il rend sincèrement une nature grossière ; sans doute, M. Courbet eut bien fait de prendre un autre modèle ; mais ce choix admis, l'œuvre elle-même mérite des éloges. À travers les laideurs et les vulgarités perce un vrai tempérament de peintre.
La Baigneuse a obtenu un succès de scandale. Figurez-vous une sorte de Vénus hottentote sortant de l'eau, et tournant vers le spectateur une croupe monstrueuse et capitonnée de fossettes au fond desquelles il ne manque que le macaron de passementerie. Cette croupe est soutenue par des jambes énormes et gonflées par l'éléphantiasis. Le haut du corps, à partir de la ceinture, semble appartenir à une autre femme. La tête est petite, l'épaule maigre, et le flasque contour d'une gorge appauvrie apparaît sous le bras développé théâtralement dans un geste conventionnel presque académique qui nous a beaucoup surpris de la part de M. Courbet ; un bout de serviette ou de draperie blanche traversant le corps cache ce que les anfractuosités d'embonpoint de cette callipyge bourgeoise pouvaient avoir d'alarmant pour l'œil et la pudeur ; un chapeau et quelques hardes pendues à des branches indiquent une espèce de « dame de campagne » se livrant aux douceurs du bain nécessaire en compagnie de sa servante, forte paysanne déjà déchaussée, et qui contemple de la rive les charmes de sa maîtresse avant d'entrer à son tour dans l'eau. Le sourire niais de sa bouche de grenouille et le geste de ses bras tendus comme ceux d'une coryphée de ballet s'expliquent difficilement. Est-elle sérieuse ou se moquet-elle ? On ne sait. Mais assurément, elle est ignoblement laide ; et, chose étrange chez un rustique comme M. Courbet, très maniérée.

Quelle a été l'idée du peintre en exposant cette surprenante anatomie ? A-t-il voulu rompre en visière avec les belles formes antiques et protester à sa façon contre les blancs mensonges du Paros et du Pentélique ? Est-ce en haine de la Vénus de Milo qu'il a fait sortir d'une eau noire ce corps crasseux ? A-t-il eu l'intention d'opposer des reins de sa façon à ce torse immortel ? Pose-t-il dans cette baigneuse son idéal de beauté ; ou s'est-il contenté de copier une créature obèse, à la graisse mal distribuée, déshabillée sur la table de l'atelier ?
Nous admettons que ces formes étranges, ces boursouflures, ces plis, ces rouleaux, ces excavations et ces bouillonnements de chair soient de la plus rigoureuse vérité ; pourquoi nous faire subir cet affligeant spectacle ? Une jeune fille ou une jeune femme aux contours élégants et purs, à la peau satinée et fraîche, n'est-elle pas aussi naturelle qu'une énorme matrone matelassée de tissus adipeux, et déformée par des agglomérations d'axonge ? Le Laid seul est-il vrai ? Le chou est réel, mais la rose n'est pas fausse ; un beau vase de marbre existe autant qu'un poêlon de terre.
Rembrandt, nous le savons, a fait des Putiphar et des Bethsabée au Bain, se faisant couper les cors, d'une lourdeur toute hollandaise et d'une laideur ignoble ; mais quelle chaude, mystérieuse et blonde lumière, il versait sur ces vilaines formes ! Alchimiste de la couleur, il changeait en or vivace ces chairs blafardes et molles empruntées au Rydeck d'Amsterdam. Mais il y a loin de la plate réalité de M. Courbet à cette puissante fantaisie. Pourtant, pour être juste, cette monstrueuse figure renferme des parties très fines de tons, fermement modelées ; l'eau a une transparence profonde simplement obtenue ; le paysage est plein d'air et de fraîcheur, et cette toile malencontreuse prouve beaucoup de talent fourvoyé.
Quant aux lutteurs ils sont franchement détestables. Nous avons à la salle Montesquieu Blas (le féroce Espagnol), Arpin (l'invincible Savoyard), Rabasson, l'Océan et toute la bande athlétique, et ils nous ont paru couleur de chair comme les autres hommes. Les lutteurs de M. Courbet se sont roulés préalablement dans la suie et le charbon ; sans doute pour avoir plus de prise.
Comment admettre au plein jour de l'hippodrome, où le peintre a placé son groupe, ces ombres noires, ces demi-teintes fuligineuses, ces lumières plombées, ce jour de cave ? Hercule et Cacus ne seraient pas plus bistrés et plus bitumeux. Pour un réaliste comme M. Courbet, ces hommes noirs s'étreignant en plein soleil sont passablement fantasques.
Quoique nous préférions la recherche de la beauté, nous concevons cependant que l'on copie la nature comme elle se présente, mais il faut être d'une sincérité scrupuleuse, d'une conscience extrême, d'une naïveté parfaite, et ne pas faire comme M. Courbet, le Watteau du laid ; c'est une erreur de croire qu'on est maniéré qu'avec les lignes coquettes, des tons roses et une touche papillonnante, on l'est également avec des tournures épaisses, des couleurs boueuses et une facture brutale ; c'est le maniérisme inverse, voilà tout. Mais un paysan peut être aussi affecté dans un sarrau de toile qu'un marquis dans un frac de taffetas zinzolin ; il y a la fausse rusticité comme il y a la fausse élégance, et il est regrettable que M. Courbet continue à dépenser, dans des tâches qui semblent des gageures tenues contre l'art et la critique, des qualités de premier ordre. Il nous donne la caricature et non le portrait de la vérité.

Gustave Courbet à la tour de Peilz
Dr Paul Collin, Lettre incluse dans : G. Courbet et son œuvre, de Camille Lemonnier, Paris, 1868.
Mon cher ami,
Je connaissais Courbet depuis à peu près neuf ans. Je lui avais donné mes soins en 1869. Il était alors dans toute la maturité de son riche tempérament.

Très souffrant à la Tour de Peilz, il s'était souvenu de moi et il m'avait fait appeler. Il ne se doutait pas que la maladie allait se dénouer si brutalement par la mort.
La lettre dans laquelle il me demandait et sur laquelle il a posé sa dernière signature, avec les derniers mots qui soient sortis de sa main, renfermait, au contraire, une sorte d'assurance sereine.
Je vous en transcris le passage important, qui vous montrera avec quel calme Courbet suivait les.progrès de sa maladie :
« Malgré le traitement de Chaux-de-Fonds à la vapeur, malgré ma répugnance pour ce genre de traitement, j'ai dû, une fois revenu à la Tour de Peilz, subir le traitement des médecins par la ponction. Il y avait le docteur Blondon de Besançon et le vieux père Farvagnie de Vevey que vous connaissez. Cette ponction a été faite il y a à peu près quinze jours et aujourd'hui c'est à recommencer. Ayant repris mon obésité absolument, c'est-à-dire 145 centimètres, je ne sais si le docteur Collin est toujours dans les mêmes dispositions à venir me voir. Jusqu'à présent, j'ai craint de le déranger, mais maintenant que c'est le moment le plus intéressant de cette maladie, j'accepterai les services qu'il m'avait offerts si gracieusement il y a quelque temps.

« Cette obésité suit un cours absolument régulier. Je ne souffre dans aucune partie du corps ; j'ai le cœur légèrement engorgé, j'ai 80 pulsations et le foie tout à fait à sa place. Je n'ai pas de maux de tête et je n'ai que la fatigue provoquée par le poids. La première ponction qui n'a été faite qu'aux deux tiers, a produit 20 litres d'eau.
« Les bains de vapeur de la Chaux-de-Fonds ainsi que les purges, ont pu produire 18 litres par le fondement. Les jambes ne sont pas très enflées. Voilà l'état dans lequel je me trouve. »
Comme vous le voyez, la lettre est précise ; elle est datée du 18 décembre et indique l'absolue lucidité d'esprit du peintre. J'ai pu constater que Courbet ne se trompait que sur un point : son pouls ne battait pas 80 mais 110 pulsations.
Permettez-moi ici un souvenir (1871).
Pendant qu'il était à Sainte-Pélagie, Courbet avait été transporté à la maison Duval.
Il souffrait d'une forte douleur hémorrhoïdale.
Nélaton l'avait opéré.
« Une fois guéri, me raconta Courbet, j'allai voir Nélaton.
« — Bonjour, M. Nélaton, lui dis-je, je viens vous payer.
« — Me payer, vous, M. Courbet, me dit-il, mais je suis trop heureux d'avoir pu soigner un grand peintre comme vous !
« J'avais pris avec moi 5 000 francs ; il ne les voulut pas.
« Je retournai chez moi.
« Nélaton n'y a pas perdu ; au contraire, car je lui ai fait une grande toile de 6 000 francs. »
Et Courbet mit dans ces derniers mots toute l'ampleur de sa voix.

Je me rendis donc à son désir.
J'arrivai à la Tour de Peilz le 22 décembre ; je le trouvai beaucoup plus mal que je ne le croyais et qu'il ne le croyait lui-même. Il était au lit. Il ne se levait que rarement. Quelquefois, quand la fatigue du lit était trop forte, on le portait sur un canapé, et il s'y étendait, très accablé par son mal.
Son vieux docteur de Vevey lui avait fait l'avant-veille une ponction, la croyant urgente. Cette ponction avait déterminé 18 à 20 litres de liquide ; l'ouverture faite par le trocart s'était mal fermée ; l'écoulement avait continué à se produire. Courbet baignait littéralement dans le liquide ascitique, malgré un épongement presque continuel. Il me dit que le ventre avant l'opération mesurait 1m 50.
Courbet avait subi antérieurement une première ponction de son ami, le docteur Blondon de Besançon, un des premiers praticiens de sa ville natale.
Je constatai qu'elle avait été faite à 5 centimètres au dessus de l'épine iliaque gauche.
J'examinai très attentivement le malade. Je trouvai le foie plus petit qu'à l'état normal. De plus, le visage avait une teinte plombée ; ses urines étaient rares et d'une couleur rouge foncée due à un excès d'urates ; je ne doutai plus que Courbet ne fût atteint d'une cirrhose du foie. Puis je tâtai le ventre, très ramolli par suite de la seconde ponction, et touchai une grosseur considérable dans l'hypocondre gauche, m'indiquant un kyste de la rate.
Courbet me sembla perdu.
Je lui conseillai de vouloir bien m'adjoindre le docteur Péan, l'ami et le successeur de Nélaton ; Courbet s'y refusa.
Courbet avait une idée qui ne le quittait pas : c'était de prendre des bains dans le lac qu'il avait sous ses fenêtres.
— Ah! me disait-il, si je pouvais m'étendre dans les eaux du lac, je serais sauvé.
Il y avait alors une mélancolie indéfinissable dans ses yeux. Il se tournait vers le coin du ciel qui se voyait à travers les carreaux des fenêtres et une songerie semblait l'occuper tout entier. Il en sortait pour me parler de son amour pour l'eau, pour le lac.
— Figurez-vous, mon cher docteur, me disait-il, que quand j'y suis, j'y resterais des heures, regardant le ciel au-dessus de moi, à faire la planche. Je suis comme un poisson dans l'eau.
Il éprouvait une grande joie et comme une détente de toute sa personne malade à prendre des bains. Deux hommes le portaient alors jusqu'à sa baignoire, et il y demeurait au point de s'affaiblir complétement. Il fallait employer la persuasion, parlementer longuement, pour le déterminer à sortir.
— Non, non, disait-il en regardant les personnes qui le soignaient, de cet œil très doux qu'il avait pour ses amis, laissez-moi.
Et il demandait sans cesse qu'on lui épongeât le front à l'eau froide, répétant toujours :
— Oh ! que je suis bien !
Ce qui avait aggravé sensiblement l'état du malade, c'était le traitement dont il est parlé dans l'extrait de lettre rapporté plus haut.
Chaux-de-Fonds est un village perdu dans les hauteurs, où il n'y a que de la neige et des horlogers. Il était parti pour cette solitude, confiant dans la renommée d'un empirique italien qui guérissait, disait-il, les maladies du genre de la sienne au moyen de bains et de drastiques.
Il resta là-bas un mois. Mme Ordinaire, la femme de l'ancien député et préfet du Doubs pendant le siège, alla lui faire visite. C'est elle qui lui conseilla de revenir.
Il avait maigri, sans toutefois rien perdre de son obésité, et il n'avait gagné aux bains de transpiration que de perdre sa force musculaire. Il était désespéré. Il revint à la Tour de Peilz. C'est alors qu'il se laissa faire par les docteurs Blondon et Farvagnie, la ponction dont il parle dans sa lettre.
Ceci se passait un mois et demi avant sa mort.
Je vous ai dit quel avait été le résultat de la dernière ponction.
Courbet, cela est incontestable, avait aidé à son mal par des absorptions effrénées de boisson. Sur la fin, il buvait encore à peu près deux litres de liquide par jour et ne rendait qu'un demi-litre dans ses urines (rouge-acajou indiquant bien la vraie maladie). Mais antérieurement il lui arrivait de boire jusqu'à douze litres par jour. C'était malheureusement de ce vin qui fait tant de veuves dans le pays, et Courbet avait imaginé d'y mêler du lait, suivant une coutume des paysans, ce qui lui donna, deux jours après mon arrivée, une très forte indigestion.
Les habitants de la Tour de Peilz se souviendront toujours de ce noctambule attardé dans les cafés et qui ne pouvait se décider à rentrer chez lui.
Ces mêmes habitants m'ont affirmé que Courbet cherchait à étouffer un chagrin. Je sais, mon cher ami, combien mes paroles doivent être mesurées, venant d'une des dernières personnes qu'ait vues le peintre, de celle qui était présente à ses derniers moments. Eh bien ! sur ma conscience, les habitants de la Tour de Peilz avaient raison.
Courbet était torturé par une pensée ; c'est qu'on pût l'appeler communard. Il se prétendait calomnié par les journaux. La qualification de déboulonneur le mettait en rage. Il ne parlait jamais de politique et avait horreur qu'on en parlât devant lui. Peut-être une douleur plus vive s'ajoutait-elle à ce chagrin. Courbet avait eu le malheur de perdre un fils qu'il adorait et dans lequel il avait mis ses consolations.
Ce fils mourut à l'âge de vingt ans.
Il l'avait eu d'une femme qu'il avait connue au beau temps de l'amour et de la jeunesse — alors que tout lui souriait et que le bonheur éclairait le chemin devant lui.
C'est une histoire douloureuse et charmante. Une dame était venue poser pour son portrait dans l'atelier du jeune maître. Il avait alors vingt-huit ans. Bientôt l'amour se mit de la partie et un beau jour la dame tomba chez Courbet, le suppliant de la garder :
— J'ai quitté mon mari, lui dit-elle, et je veux être maintenant tout à toi.
Ils vécurent ensemble, et un enfant fut le gage de cette union. Le mari mort, Courbet, m'a-t-on dit, reconnut l'enfant. Quoiqu'il en soit, ce garçon, ce fils, fut un des plus grands bonheurs de sa vie. Il l'aimait d'une tendresse sans bornes, et quand il le perdit, huit mois après avoir perdu la femme qui le lui avait donné ; il se sentit frappé dans les profondeurs mêmes de son être.
Le jeune homme s'occupait de littérature ; il avait publié quelques articles bien pensés.
Chose bizarre, il ne semble pas que Courbet ait jamais fait le portrait de ce fils bien aimé.
Je dis ce que je sais, pas autre chose, et je vous le dis, parce qu'il était bon d'expliquer cette passion de la boisson et du noctambulisme qui a été une des causes de la mort de ce pauvre homme de génie.
Je tiens l'histoire de M. Pata, qui fut l'élève et l'ami de Courbet et à qui ce dernier l'avait contée lui-même, dans une heure de nostalgie.
Courbet, vous le savez par les journaux, habitait à la Tour de Peilz, faubourg de Vevey, une assez vaste maison, appelée Bon Port.
Ce nom lui venait de son voisinage avec la partie du lac où les pêcheurs, chassés par le gros temps, cherchaient un refuge.
Bon Port était primitivement un café, et le jardin qui s'étendait le long des fenêtres du rez-de-chaussée était encore garni de ses tables. La maison se composait d'un rez.-de-chaussée de plusieurs pièces et d'un étage où Courbet avait installé son atelier et sa galerie de tableaux. La chambre à coucher était au rez-de-chaussée et communiquait par un escalier de quelques marches avec un petit corps de bâtiment, bâti contre la maison du côté du lac et où l'ami de Courbet, M. Morel, avait son atelier.
Peu de meubles. Le maître n'avait autour de lui que le strict nécessaire. La chambre à coucher était garnie d'un poêle en faïence blanche près duquel se trouvait un canapé, d'une console placée entre les fenêtres et d'un lit en fer. On mettait sécher les linges sur le poêle. Courbet n'en avait que très peu, et celui qu'on lui enlevait lui servait aussitôt qu'il était sec. Détail assez triste, le lit n'avait qu'un seul matelas.

Un moulage en plâtre était posé au dessus du poêle. C'était le moulage d'une statue de la Liberté que Courbet avait faite pour la place de la Tour de Peilz. La statue est en bronze, d'un mouvement généralement très admiré, et couronne une fontaine. Elle regarde la France et porte cette inscription : Hommage à l'hospitalité !
Courbet se croyait aussi grand sculpteur que grand peintre.
Il avait exécuté un médaillon d'un sentiment très tendre et dont il m'a parlé plus d'une fois.
Ce médaillon renfermait une tête de femme, aux lignes délicates et pourtant fermement modelées, sur le front de laquelle se penchait une mouette, les ailes ouvertes et le cou abaissé dans l'attitude de la confidence.
— J'ai fait cela pour un de mes amis de Vevey, me dit-il. J'ai voulu faire la dame en contemplation et cette mouette est la mouette du lac. Elle vient lui communiquer ses pensées.
Courbet avait intitulé ce médaillon : La Dame du lac.
En réalité, cette figure était destinée à symboliser l'exil et la mouette qui se pose sur son front lui parle de la patrie absente.

Courbet aimait à montrer sa galerie. Elle renfermait cent cinquante tableaux environ et parmi ces tableaux il y en avait de fort beaux. J'ai noté surtout :
Un tableau représentant Courbet avec une expression désespérée et qu'il avait intitulé pour cette raison Désespoir. Cette peinture, faite en 1843, avait été exposée à Genève l'an dernier.
Un tableau représentant une Anglaise aux cheveux d'or se mirant dans un miroir. Rochefort avait voulu l'acheter, au prix de 5 000 francs, mais le peintre le lui avait refusé. Comme Rochefort insistait, Courbet avait décroché une adorable plage et la lui avait gracieusement offerte en lui disant : — A-t-on vu ce Rochefort ! Il veut m'acheter tout ce que j'ai de bon. Emportez celle-là, et ne me parlez plus de m'acheter rien du tout.
Cette marine est dans le salon de Rochefort, à Genève, et il est heureux de la montrer aux personnes qui viennent le visiter.
Le Curé et le Moribond, dont on a beaucoup parlé.
Les Demoiselles de la Seine, s'embrassant sous les arbres, à Bougival.
Un Portrait de Rochefort d'un beau modelé, mais exagéré au point de vue de l'anatomie générale de la tête. C'est le portrait au sujet duquel Courbet s'écriait :
— Cet animal-là n'a qu'une belle chose : c'est sa mâchoire. Il a des dents de cheval !
Un Portrait de son père, de tous points et de l'avis de tous, admirable.
L'Espagnole à la mantille, portrait d'une grande finesse.
Le Portrait du peintre et de sa maîtresse. Il a 25 ans alors. Il s'est peint regardant sa bien-aimée tendrement et lui serrant la main.
Puis plusieurs Baigneuses.
Une copie, d'après la Hille Bobbe de Frans Hals.
Courbet aimait à raconter au sujet de cette copie, qu'ayant obtenu la permission de copier le tableau, il avait mis un jour dans le cadre de la Hille Bobbe, sa copie au lieu de l'original :
— Je l'y laissai plusieurs jours, terminait-il, et personne ne s'en aperçut.

Il y avait un assez grand nombre de paysages d'Ornans, du Doubs, et du Lac de Genève, entre autres un très beau morceau, Les Rochers d'Ornans. Une vue du château Chillon n'avait pu être terminée ; elle avait été achetée pour le Musée de Besançon. Son magnifique tableau des Saules dans la Vallée, était à Paris, chez M. O' Douar.
Quant à ses grandes toiles, l'Enterrement à Ornans et le Retour de la Conférence, elles n'étaient pas chez lui, comme on l'a dit. Il les avait confiées à un ami qui les garde roulées.

Courbet était grand amateur de toiles anciennes, mais il ne m'a pas paru que ses connaissances fussent à la hauteur de sa passion et de son talent.
Il avait acheté à Genève, au prix de 8000 fr., un tableau représentant une magicienne dansant au milieu d'un cercle et entourée de visions. Cela était peint sur panneau parqueté et avait 3 mètres de hauteur.
Courbet attribuait la peinture à Watteau. Il en voulait 200 000 francs.
Courbet n'a pas, que je sache, laissé de testament ; mais il existe un relevé exact des tableaux et des esquisses qui composaient sa galerie. Ce relevé a été dressé deux mois avant le décès du peintre, par un notaire de la Tour de Peilz, sur la demande de la sœur de Courbet, Mme Juliette, et de ses amis M. et Mme Morel, qui avaient voulu ainsi calmer les inquiétudes de Courbet, très amoureux de ses tableaux et craignant toujours qu'on ne vint les lui enlever.
Il avait un fervent désir, dont il m'a fait part à moi-même : c'était de léguer à la ville de Paris ses principales toiles.
L'atelier de Courbet était des plus simples. Aucun ornement. De mauvais chevalets ; quelques tabourets pour s'asseoir.
Il peignait avec de la couleur achetée chez le droguiste, très commune et peu coûteuse.
Cela était sur la cheminée dans des pots.
Il se moquait des peintres qui se ruinent en couleurs fines.
— C'est dans le doigt qu'est la finesse, disait-il.
Il était très beau dans le feu de son métier ; sa main avait des élégances extraordinaires.
Il me raconta qu'un jour une dame était venue le trouver et lui avait demandé ce qu'il faisait pour peindre si bien.
— Je cherche mon ton, lui avait-il répondu ; c'est bien simple.
La dame avait demandé alors à travailler avec lui; mais elle n'avait fait rien qui vaille ; et comme elle s'en étonnait :
— Madame, vous n'avez pas l'œil, avait-il répondu. Tout est dans l'œil. Quand j'ai mon ton, ma toile est faite.
Tous les habitants de l'endroit vous diront que Courbet était bon et généreux. Les exilés étaient chez lui comme chez eux. Nul ne frappait en vain à sa porte : il était bienveillant pour tout le monde. Courbet, assez économe de sa nature, ne regardait ni à l'argent, ni au temps, ni à sa peinture, quand il s'agissait d'aider. Il secourait toutes les infortunes. Il avait offert des tableaux pour les inondés de France, il y a deux ans, puis pour les grêlés de Genève et il envoyait de ses œuvres pour toutes les quêtes de bienfaisance.
J'ai su qu'il avait été souvent la dupe des gens qui se présentaient à lui. Il était naturellement confiant et ne savait résister au plaisir d'être loué.
Un jour, c'est un Italien qui lui offre à boire au café ; on boit des vins fins, et le moment venu de payer, l'Italien déclare qu'il a perdu son porte-monnaie et lui emprunte trois louis pour payer la dépense.
Une autre fois, une dame marseillaise vient à la Tour de Peilz pour le voir. On lui dit que le peintre est au café, et en effet, Courbet y était avec des amis et jouait aux dominos.
— Moûssu Courbet, lui dit-elle aussitôt, ze vois que vous êtes aussi bel homme que vous êtes grand peintre. Et vous zouez aux dominos, moussu Courbet ?
— Comme vous voyez, madame, et j'y suis même d'une belle force.
La dame finit par lui offrir de faire avec elle une partie, et elle proposa un enjeu de 300 fr. Comme Courbet se récriait, elle lui dit :
— Ze paierai, moussu Courbet, si ze perds, mais si vous perdez, ze ne veux pas d'argent, non pas d'argent, moussu Courbet, mais un petit zouvenir de vous, le portrait de mon petit chien que z'aime beaucoup et que voilà.
La dame avait sous le bras un bichon.
Courbet, de guerre lasse, accepta et perdit : la dame avait un compère.
Le lendemain, Courbet était à son atelier. On frappe. Il ouvre. C'était la dame avec son bichon.
— Ze viens, Moussu Courbet, ze suis pressée. Ze pars tout à l'heure et comme vous êtes avant tout un homme de grand honneur…
Courbet peignit le petit chien. La dame emporta la peinture toute fraîche et… l'alla vendre à Genève pour 800 francs.
C'est Courbet lui-même qui me conta cette histoire. Il racontait très finement et y prenait plaisir. Il aimait les histoires gauloises. Son accent franc-comtois donnait du mordant à sa parole ; il imitait à s'y méprendre les patois français.
Il avait la voix forte, agréable à l'ouïe, le parler doux et sonore, la brièveté militaire par moments ; mais ce qu'il disait était toujours marqué d'une grande bonhomie. Il chantait avec sentiment ; deux mois avant sa mort il avait chanté un Noël avec sa sœur Juliette.
Courbet vivait sans domestiques à Bon Port, d'une vie presque rustique. Il était très simple et plein de prévenances pour les personnes qu'il recevait ; une fois, il poussa la bonté jusqu'à cirer les bottes d'un ami qui logeait chez lui.
Heureusement, une providence veillait sur le peintre et jamais je n'ai vu de dévouement plus absolu. M. et Mme Morel, réfugiés, ont entouré l'exil de Courbet d'une tendresse vigilante comme celle d'un frère et d'une sœur. Des nuits entières, cette excellente femme est demeurée assise à son chevet, épiant ses moindres désirs, et M. Morel, de son côté, s'occupait de ses affaires, gérait sa petite fortune avec une complaisance rare. Courbet était très sensible à leur bonté ; il était ému en parlant d'eux. Ces bonnes gens n'ont pas cessé un instant d'être ses fidèles et loyaux amis ; jusque par delà sa mort, ils l'ont aimé avec une tendresse dont on ne peut leur être trop reconnaissant.
Courbet aimait à parler de la nature, de ses paysages, de sa peinture. Il m'a souvent répété que son bonheur était de demeurer de longues heures en contemplation devant les montagnes du lac ou de suivre le vol des mouettes à perte de vue.
Il ne peignait plus depuis un mois. Sa main, souple et fine, était demeurée belle. Comme toutes les mains des grands peintres, elle aurait dû être moulée. On garderait ainsi quelque chose de leur génie, car la main est pour eux l'instrument direct de leur cerveau.
Courbet a peint plusieurs fois, sur la fin de sa vie, la Tour de Peilz. Les Anglais amateurs lui commandaient aussi des vues du château Chillon, ce manoir féodal, dernier vestige de la puissance des ducs de Savoie.
Courbet travaillait très vite, sa vieille pipe toujours à la bouche. Il mettait trois ou quatre heures au plus à ce qu'il appelait ses « morceaux de peinture. » Il demeurait d'abord comme embarrassé, cherchait le ton sur sa palette, et, le ton trouvé, il l'étendait au couteau et terminait rapidement son travail. Il maniait si extraordinairement son couteau préparé par lui-même, que je l'ai vu une fois exécuter à la pointe de la lame la silhouette tenue d'un paratonnerre.
Courbet a laissé peu d'élèves ; mais je dois cependant citer parmi les plus distingués MM. Chérubin-Pata, Marcel Ordinaire et Slom. Sa peinture était peu goûtée à Genève. Cela se comprend quand, comme moi, on a vu le musée de cette ville encombré de Calame que les Génevois admirent très fort pour leur fini.
J'ai perdu un peu de vue, à travers toutes ces notes, l'état de la maladie du grand peintre. J'y reviens, mais pour constater l'irrémédiable approche de la mort. En effet, Courbet n'était plus qu'un corps dont les forces se retiraient chaque jour. L'œil était devenu hagard et la parole chancelante ; il fallait lui répéter les paroles prononcées devant lui, et dès le 28 un hoquet l'avait pris, revenant de moment en moment. Un réfugié comme lui, M. Edgar Monteil, homme de lettres, qui lui était fort dévoué, venait le voir chaque jour.
Rochefort aussi était de ses amis. Il s'était même mis en route pour lui faire visite, mais un train manqué mit un retard dans son arrivée, et quand il débarqua à Bon Port, Courbet n'était plus.
Voyant ses forces diminuer d'heure en heure, je crus devoir prévenir immédiatement les parents.
Le père arriva le surlendemain. C'était un vieillard de 82 ans, d'une constitution robuste et d'un tempérament sanguin et énergique comme le fils auquel il avait donné le jour.
Il trouva l'artiste assis et très faible.
— Tiens ! Gustave, dit-il, je t'apporte un petit cadeau. C'est une lanterne sourde de chez nous.
Et il y adjoignit une livre de tabac français.
Cela fit sourire Courbet.
Son père demeura auprès de lui et la journée s'acheva assez bien. Mais il me fit appeler à l'entrée de la nuit. Courbet avait déjà le faciès hippocratique : le docteur Farvagnie qui venait le voir tous les jours, l'avait remarqué comme moi. Il m'expliqua qu'il avait ressenti un déchirement dans le flanc gauche, avec douleur atroce dans le bas-ventre : c'était probablement une déchirure du kyste de la rate que j'avais constaté.
Il me dit alors ce mot malheureusement trop juste :
— Je pense que je ne passerai pas la nuit.
Et il répéta le propos à l'homme de garde qui veillait près de lui.
Je lui posai des cataplasmes laudanisés, mais cela ne fut pas suffisant pour le calmer.
Il me supplia de lui faire une injection sous-cutanée dans la partie douloureuse.
Il avait en ce moment l'œil caverneux, la bouche sèche et fuligineuse. Le hoquet continuait.
Une demi-heure environ après l'injection de morphine, il s'endormit.
Il était alors 8 heures du soir environ.
Courbet se réveilla vers 10 heures et demeura quelque temps dans une sorte de somnolence. Il dit quelques mots, puis perdit connaissance.
L'agonie commença vers les 5 heures du matin et dura un peu plus d'une heure. Courbet mourut à 6 h. 30.
Ce fut une grande douleur dans la maison. C'était pour la France un grand peintre de moins. Pour ceux qui l'avaient aimé, c'était un cœur excellent, une nature affectueuse et bonhomme que la mort venait de leur enlever.
Je tâchai d'obtenir qu'on moulât le visage.
— Ce n'est pas la peine, me répondit le vieux père. Il y a assez de ses portraits à la maison.
Je n'oublierai jamais ce brave homme, répétant, au milieu de sa douleur, qu'il avait un moulin près d'Ornans et que Gustave devait être enterré dans le moulin.
— Il sera là près de moi, disait-il.
Ce vœu touchant n'a pu être réalisé. Courbet repose à la Tour de Peilz1, dans ce lieu de son exil.
Voilà, mon cher ami, des faits précis qui peut-être pourront vous servir. Un désir du grand peintre qui n'est plus m'a fait devenir le témoin de quelques particularités qui le concernent. Je vous les ai racontées telles que je les ai vues. Puis la mort est venue et, bien qu'éloigné, j'ai pensé à la France, que je représentais, sans l'avoir voulu, à ce chevet de moribond, et qui perdait en Courbet une de ses plus grandes illustrations.
Bien à vous,
Dr Paul Collin
1) ↑— La tombe de La Tour de Peilz et le corps de Courbet furent rappatriés à Ornans en 1929 soit plus de 50 ans après sa mort… Enterrement qui n'eut pas le faste ni la pompe de son célèbre tableau puisque, en 1929, la municipalité d'Ornans après bien de atermoiements, pris la décision de ne pas être représentée et le curé interdit à ses paroissiens de se rendre au cimetière. Seuls quelques Ornanais l'accompagnèrent vers sa dernière demeure. (Note : DAS)

L'Enterrement à Ornans, 1880-1943
Champfleury (Jules François Félix Husson, dit), in : Les Grandes figures d'hier et d'aujourd'hui, Paris, 1861.

1. Régis Courbet – 2. Sylvie Oudot – 3. Antoine Oudot – 4. Zélie Courbet – 5. Zoé Courbet – 6. Juliette Courbet – 7. Félicité Colard –Taland – 8. Alphonse Bon – 9. « La petite Teste » Françoise Élisabeth Zélie – 10. Claude Louis Promayet – 11. Jeanne Marguerite Victor Sevré – 12. Alphonse Promayet – 13. Claude Joseph Journet – 14. François Constant Panier – 15. François Constant Cauchye – 16. Benjamin Bonnet – 17. François Félicien Colard –Claudame – 18. Antoine Joseph Cassard – 19. Jean Baptiste Muselier – 20. Pierre–Xavier Maurice Clément – 21. Jean Baptiste Cardey – 22. François Pillot–Secretan – 23. Hippolyte Proudhon – 24. Urbain Cuenot – 25. Prosper Teste – 26. Adolphe François Marlet – 27. Maximin Buchon – 28. Guillaume François Bertin – 29. Claude Joseph Sage – 30. Eusebe Crevot – 31. Étienne Nodier – 32. La mère Gagey : Jeanne–Baptiste Groslambert – 33. Fifi Caillot : Jeanne –Philiberte Etevenon – 34. Joséphine Beauquin – 35. Françoise Garmont – 36. Françoise Roncet – 37. Célestine Garmont – 38. Jeune femme inconnue portant une coiffe – 39. Femme de profil inconnue – 40. Visage de jeune femme que Courbet fit disparaître du tableau et que la photographie récente reconstitua – 41. Jeune femme inconnue – 42. Personnage inconnu – 43. Pleureuse inconnue – 44. Visage de jeune femme inconnue – 45. Jeune fille inconnue – 46. Homme inconnu en pleurs – 47. Qui est l'enterré du catafalque? – 48. À qui appartient le chien ??
J'ai écouté les propos de la foule devant le tableau de l'Enterrement d'Ornans, j'ai eu le courage de lire les niaiseries qu'on a imprimées à propos de cette peinture, j'ai écrit cet article. De même qu'en politique on voit d'étranges associations de partis opposés se réunissant pour combattre un ennemi commun, de même les critiques réputés les plus audacieux sont entrés dans les rangs des sots et ont tiré sur la réalité.
M. Courbet a voulu rendre un enterrement de petite ville, tel qu'il se passe en Franche-Comté ; et il a peint cinquante personnes de grandeur naturelle, allant au cimetière. Tel est le tableau.
Les uns l'ont trouvé trop grand et ont envoyé le peintre à l'école des pattes-de-mouche de M. Meissonnier.
D'autres se sont plaint que les bourgeois d'Ornans manquaient d'élégance et ressemblaient aux caricatures de Daumier.
Quelques romantiques refroidis ont déclamé contre le laid comme de simples rienologues.
Les amateurs de rubans passés et de fard ranci qui chantent les exploits des filles du dix-huitième siècle, tremblent devant les habits noirs, et s'écrient : « Le monde est perdu, il n'y a plus ni pompons, ni mouches, ni faveurs roses. »
On veut que M. Courbet soit un sauvage qui ait étudié la peinture en gardant les vaches.
Quelques-uns affirment que le peintre est un chef de bandes socialistes.
Enfin, l'opinion des badauds peut se résumer dans cette phrase connue qui florissait sous l'Empire :
« Tout ce qu'on voit dans ces peintures est d'un si mauvais choix qu'on n'y reconnaît la nature que dans sa dégradation. Les figures d'hommes sont laides et mal faites, leurs habits grossiers, leurs maisons mesquines. On n'y trouve qu'une vérité basse. » L'académicien qui parlait ainsi en 1810 entendait désigner Teniers, Ostade et Brawer. Les critiques de 1850 n'ont rien changé aux arguments de l'académicien.
Ô misères !
Il ne se fait pas tant de bruit autour d'un tableau sans qu'il ne renferme des qualités sérieuses. Or, la critique qui nie rend plus de services que celle qui affirme. Le contre est plus utile que le pour. C'est par de semblables moyens non voulus qu'on fait le succès d'une œuvre. « J'aime mieux mes ennemis que mes amis », disait un grand homme qui savait combien la langue démange aux détracteurs, et il avait raison. La patrie est en danger ! s'écrie le Constitutionnel à propos du tableau de M. Courbet. Aussitôt tous les curieux de Paris courent au danger, qui est l'Enterrement à Ornans ; ils reviennent du Salon et content le scandale à tous ceux qui veulent l'entendre. « Les Barbares sont entrés dans l'exposition. » Ils s'écrient que M. Courbet est le fils de la République démocratique de 1848 ; ils voudraient mettre un crêpe sur l'Apollon du Belvédère ; ils proposent de fermer la salle des antiques. Si on les écoutait, les membres de l'Institut devraient s'asseoir sur leurs fauteuils, comme autrefois les sénateurs sur leurs chaises curules, et mourir fièrement, frappés par les sabots boueux des sauvages réalistes.
Les habitants d'Ornans frémissent en lisant dans les gazettes qu'ils peuvent être plus tard soupçonnés de complicité avec le monstre, pour avoir prêté un moment leur figure et leurs habits à ses pinceaux. Je comprends la terreur de M. Proudhon, cousin de l'économiste révolutionnaire, substitut du juge de paix, qui ne voyait pas de crime à entrer dans l'atelier du peintre, les habits de deuil bien brossés, en redingote noire et souliers vernis, le chapeau à la main. Marlet le cadet, l'adjoint, qui a fait son droit à Paris, cherche inutilement à le calmer.
Teste, le maire d'Ornans, un gros homme joyeux, va au café écouter ce que disent ses administrés. Le père Cardet, qui était à l'enterrement en habit marron, en culottes courtes et en bas bleus, court trouver son confrère Secrétan, qui demeure dans la rue de la Peteuse, et ces deux braves vignerons, revenus des affaires de ce monde, qui ne lisent pas les journaux, s'étonnent qu'on fasse tant de bruit à propos du chapeau à cornes de l'un et de l'habit gris de l'autre.
Malheureusement, le fils du vigneron Sage est aujourd'hui en Afrique ; il défendrait chaudement son ami le peintre. Max Buchon, le poète, n'est pas là non plus ; mais il soutiendra Courbet dans le journal de Salins. Pourquoi Jean-Antoine Oudot, le grand-père du peintre, est-il mort ? C'était un homme de prudent conseil et que tout Ornans consultait ; il aurait fait entendre raison à chacun.
Il ne reste dans la ville qu'Alphonse Bon, qui rencontre la Célestine Garmont, la boiteuse, la femme d'Alexandre le bossu. — On ne parle au marché, dit-elle, que de la peinture du fils au vigneron Courbet… Il ne nous a pas flattés, à ce qu'il paraît ; on dit qu'il nous a faits en caricatures ; mais quand il reviendra, patience ! Le fils à la mère Beurey lui en prépare de l'ouvrage… On ne se moque pas comme ça des gens. C'est un grand diable… »
En effet, ce qui indigne la ville d'Ornans, c'est que l'an passé elle allait au-devant du peintre, musique en tête. Promayer, qui dirige la musique de la garde nationale, avait arrangé cette surprise pour le Parisien ; et comment le peintre a-t-il récompensé ses compatriotes de ce triomphant accueil ? En amusant tout Paris aux dépens des bedeaux d'Ornans, du vigneron Jean-Baptiste Muselier et de Pierre Clément, le cordonnier.
Le curé de la paroisse, M. Bonnet, n'aime pas qu'on se moque ainsi de ses bedeaux, car ils appartiennent un peu à l'Église, et il ne faut jamais donner à rire de ce qui touche au clergé. Pourquoi les journaux n'ont-ils pas fait mention de Cauchi le sacristain, ni du vigneron Colart, le porte-croix ? Parce qu'ils n'ont rien de ridicule, tandis que le nez rouge de Pierre Clément indique de trop longues conversations avec la bouteille. M. le curé pense que les grands chapeaux, que loue le chapelier Cuenot pour les enterrements, sont cause qu'on ne s'occupe pas d'Étienne Nodier, qui porte le corps avec le père Crevot.
Les sœurs de Courbet ne savent que penser des journaux que leur envoie leur frère de Paris ; elles sont tellement sûres de ses intentions qu'elles essayent de prouver par tous les moyens que « Gustave » n'a pas songé à se moquer des personnes de la ville. Elles vont chercher la Fili Caillot qui a posé dans le portrait, et la Joséphine Bocquin, celle qui pleure et qui a un capuchon sur la tête, et leur montre un journal où on les a trouvées jolies. Les femmes, heureuses de voir un compliment imprimé, sont presque convaincues lorsque le gros Marlet entre ; il reçoit la Presse et lit un article où le critique affirme que le peintre a fait exprès de charger ses compatriotes, afin de paraître plus beau.
— Le journal a raison, dit le gros Marlet. Puisque Courbet sait s'embellir, il pouvait bien nous faire comme lui.
— Il n'est déjà pas si beau, avec sa pipe ! s'écrie la mère Promayer.
Seul, le fossoyeur Cassart ne dit rien. L'habitude d'enterrer les gens lui a appris à réfléchir, et il ne lâche pas ses mots comme un étourneau. Il écoute en caressant son chien les reproches du gros Tony Marlet, et s'éloigne en sifflant du côté de la vallée de Manbouc.
J'ai essayé de peindre les propos de petite ville à l'occasion des personnages de l'Enterrement à Ornans. Il était plus important qu'on ne le pense d'établir la position des types du tableau de M. Courbet, qu'on veut absolument sacrer socialiste. Aujourd'hui il est convenu de rechercher si la plume du romancier est entachée de communisme, si la mélodie est saint-simonienne, si le pinceau est égalitaire. Il n'y a pas l'ombre de socialisme dans l'Enterrement à Ornans ; et il ne suffit pas de peindre des casseurs de pierres pour me montrer un vif désir d'améliorer le sort des classes ouvrières.
Ces fantaisies dangereuses tendraient à classer les artistes par partis et à les faire réclamer tantôt par celui-ci tantôt par celui-là. Jamais on ne me persuadera que « Rembrandt était l'élève de Luther ». Impurs mélanges de panthéisme nuageux, de symboliques antithèses et de réalités, quand cesserez-vous de rissoler dans la même casserole et d'empoisonner la jeunesse ?
Cependant, je veux rentrer dans ce puits d'où ne peut sortir la vérité, pour montrer que M. Courbet n'est pas si socialiste qu'on veut le dire. Non pas que je pense le rattacher à un autre parti, ce qui serait aussi fatal au peintre et à ses œuvres futures. Malheur aux artistes qui veulent enseigner par leurs œuvres, ou s'associer aux actes d'un gouvernement quelconque. Ils peuvent flatter pendant cinq minutes les passions de la foule ; mais ils ne rendent que des actualités.
Si le socialisme n'était au fond qu'une nouvelle forme de libéralisme, c'est-à-dire une sorte d'opposition avec d'autres habits, quelles chances aurait un peintre socialiste ? Son œuvre passerait aussi vite que l'appellation elle-même de la doctrine, déjà moins bruyante que dans les deux premières années de la Révolution.
La peinture pas plus que la musique n'a pour mission d'exposer des systèmes sociaux ; quand la peinture se convertit en enseignement, elle n'est plus de la peinture. Elle devient une chaire triste et pénible à regarder, car il n'y a pas de prédicateur dans la chaire.
Heureusement M. Courbet n'a rien voulu prouver par son Enterrement. C'est la mort d'un bourgeois qui est suivi à sa dernière demeure par d'autres bourgeois. On sait que ce tableau n'est pas un portrait de famille ; quel est le vigneron assez riche pour commander une toile si importante ? C'est simplement, comme je l'ai vu imprimé sur des affiches, quand M. Courbet exposait ses tableaux à Besançon et à Dijon, le Tableau HISTORIQUE1 d'un enterrement à Ornans. Il a plu au peintre de nous montrer la vie domestique de petite ville ; il s'est dit que des robes d'indienne et des habits noirs valaient les costumes espagnols, les dentelles et les plumets Louis XIII, les armures moyen âge, les paillettes de la régence, et il s'est jeté avec le courage d'un bœuf dans cette immense toile, sans exemple jusqu'ici.
Et ce n'est pas la grandeur du tableau qui m'intéresse. Si M. Meissonnier ne peignait pas avec une épingle, s'il entendait l'effet, si son pinceau pénible n'entraînait pas des tons sales sur ses toiles microscopiques, j'aurais autant de respect pour cette peinture de Tom Pouce que pour les grandes architectures du Véronèse. Mais, devant ce travail de patience, je me représente M. Meissonnier avec une loupe d'horloger dans l'œil, peignant d'après des défroques de Babin.
Entre autres récriminations, les sots se sont écriés d'un commun accord : « Nous comprenons Ostade, Téniers et Brawer ; nous admirons leurs buveurs, leurs fumeurs ; mais, au moins, savaient-ils se restreindre dans de petites toiles ; leurs beuveries, leurs actions communes et leurs mangeailles se passaient dans de petits cadres. »
Les Espagnols, Murillo et Velasquez en tête, ont peint des mendiants, des pouilleux, des culs-de-jatte de la même taille que les grands et infantes d'Espagne ; les Fêtes de famille où on crie : « Le roi boit ! », où on chante, où on joue de la musette, où on se détourne de table, quand la digestion est pénible, sont de grandeur naturelle.

Nous avons au Louvre un chef-d'œuvre, le Prix de l'arc, de Van der Helst : c'est le portrait de trois échevins qui tiennent en main des vases d'or qu'ils vont distribuer au plus adroit tireur d'arc. Ce petit tableau de chevalet n'est que la réduction d'une toile de Van der Helst, qui a la taille du tableau de l'an passé de M. Courbet, un Après-dîner à Ornans. Au Musée d'Amsterdam, en face de la Ronde de nuit, de Rembrandt, se voit une immense peinture de Van der Helst, qui représente les bourgmestres de la ville discutant entre eux. Ce tableau est plus grand que celui de M. Courbet. Pourquoi les sots ne connaissent-ils pas la peinture de Van der Helst ? Car telle est leur science, égale à leur sentiment. Ignorants, niais et raisonneurs !

1648, Rijksmuseum, Amsterdam.
On dira que les bourgmestres et les échevins d'Amsterdam sont des gens importants ; mais le maire d'Ornans, l'adjoint d'Ornans, le substitut du juge de paix d'Ornans, le curé d'Ornans, le chien d'un rentier d'Ornans, n'ont-ils pas l'importance historique de bourgmestres et d'échevins flamands ? Dans cinquante ans on ne saura pas plus les noms des bourgeois d'Ornans que l'artiste qui voyage en Hollande ne connaît les noms des personnages du tableau de Van der Helst.
Quant à la laideur prétendue des bourgeois d'Ornans, elle n'a rien d'exagéré ; c'est la laideur de la province, qu'il importe de distinguer de la laideur de Paris. Tout le monde s'écrie que les bedeaux sont ignobles. Parce qu'il y a un peu de vin dans leurs trognes… La belle affaire ! Le vin donne un brevet à ceux qui l'aiment, et il colore d'un rouge puissant le nez des buveurs ; c'est la décoration des ivrognes. Jamais un nez rouge n'a été un objet de tristesse. Ceux-là qui ont le nez rouge ne baissent pas la tête en signe de honte ; d'ordinaire ils la relèvent, convaincus qu'ils inspirent de la joie à leurs concitoyens. Les bedeaux d'Ornans sont vêtus de robes rouges et de toques, comme des présidents de la Cour de cassation ; et c'est ce qui a indigné quelques gens sérieux, qui, dans leur erreur, s'indignaient de voir des magistrats porteurs de pareils nez. On ne se trompe pas de la sorte. Les juges, quoique en dehors des tribunaux ils soient rarement plaisants, n'offrent pas de ces figures vineuses où l'œil et l'oreille, indifférents aux choses extérieures, semblent prêter grande attention à des fumées intérieures. Chaque profession a son nez ; et il faut être bien pauvre d'idées physiognomoniques pour donner le nez d'un bedeau à un magistrat. Ces bedeaux m'amusent singulièrement, ils me réjouissent, donc ils ne sont pas laids. Non, tu n'es pas laid, Pierre Clément, avec ton nez plus rouge que ta robe ; console-toi, Jean-Baptiste Muselier, de ce que disent les folliculaires ; entre au cabaret et bois une bouteille de plus !

Chose étrange, on dit le plus grand mal de ces bedeaux à la mine réjouissante, et personne n'a songé à entamer la question de la laideur de l'homme d'affaires, si bien représentée par un personnage à la mine blême, aux lèvres minces, d'une propreté sèche et froide qui indique les mesquineries de la vie. Voilà un portrait d'homme laid, économe et prudent, rangé et vertueux. Voilà la laideur !
Les deux vieillards qui, devant la fosse ouverte, pensent aux choses du passé en prenant une prise, sont pleins de physionomie ; ils ne sont pas laids. Les porteurs de corps sont des jeunes gens à barbe et à moustaches, comme tous les jeunes gens. M. Courbet aurait-il dû les habiller de pantalons à la cosaque et de vestes de hussards ? Le fossoyeur est une admirable figure, le genou en terre, plein de fierté ; sa besogne est à moitié faite, il attend la fin des prières du curé. Il n'est ni triste ni gai; l'enterrement ne l'occupe guère; il ne connaît pas le mort. Son regard court à l'horizon du cimetière et s'inquiète de la nature ; ce fossoyeur toujours travaillant pour le compte de la mort, jamais n'a pensé à la mort. C'est le type de l'homme du peuple dans sa beauté robuste. L'enfant de chœur qui tient le vase à l'eau bénite est charmant ; plus aimable encore la petite fille qui tire le bras de sa mère en pleurs, et qui se penche comme pour cueillir une marguerite.

Le groupe de femmes est composé de jeunes et de vieilles ; par un malin caprice de « réaliste », M. Courbet a pris plaisir à rider de vieilles femmes. Leurs cheveux gris passent sous les coiffes de toile blanche et les grands bonnets. Mais les jeunes filles sont vraiment jeunes et robustes comme toutes les femmes de petites villes, moitié bourgs, moitié villages, perdues dans les montagnes ; cependant il y a des exceptions, et le peintre a rendu les exceptions. Du milieu du groupe des femmes se détache une jeune fille, la tête couverte d'un capot de taffetas noir, la figure fine et délicate, les grappes de cheveux blonds se détachant sur le noir du costume. C'est une physionomie délicate et charmante qui n'a rien des types de convention qu'on rencontre chez tous les jeunes peintres d'un coloris précieux, sortis de l'enseignement de M. Couture.

Les critiques avaient tant retourné Balzac sur le gril, qu'ils avaient fini par le brûler et lui faire mal : il n'aimait, disaient-ils, qu'à peindre des scélérats, il ne se plaisait que dans la peinture des gens vicieux. On a vu dans l'étude en tête du présent volume la défense de Balzac ; il répondait que si les vicieux étaient supérieurs en nombre aux vertueux, c'était sans doute la faute de la société et que, comme il avait la prétention de peindre la société réelle, il ne lui était pas permis de changer les hommes d'affaires en galants porteurs de houlettes.
Ainsi que le grand maître que nous avons perdu, M. Courbet pourrait dire à ses juges qui tiennent la plume : J'accorde que mes bedeaux ne sont pas des Antinoüs, je suis même persuadé que Winckelmann ne disserterait pas sur mon tableau à cause de la bassesse de quelques personnages ; mais la beauté n'est pas commune en France. Vous, critiques, qui dites comprendre le beau, allez vous regarder dans une glace et osez imprimer que votre figure est conforme aux Caractères des nobles passions de l'illustre M. Le Brun.2
M. Courbet peut citer hardiment trois têtes de femmes, les enfants, le fossoyeur et bien d'autres figures, comme type du Beau moderne, que les bedeaux emporteront la balance et feront déclarer l'Enterrement d'Ornans le chef-d'œuvre du laid3. Est-ce la faute du peintre si les intérêts matériels, si la vie de petite ville, si les égoïsmes sordides, si la mesquinerie de province impriment leurs griffes sur la figure, éteignent les yeux, plissent le front, hébètent la bouche ? Beaucoup de bourgeois sont ainsi ; M. Courbet a peint des bourgeois.
Suivant un procédé connu, on oppose l'exposition de 1850 à l'exposition de 1851 ; le tableau de l'Après-dîner à Ornans était bien supérieur au tableau de l'Enterrement à Ornans, dit-on. Et j'ai vu vingt fois imprimer, en présence de cette admirable toile, qu'il était regrettable que le peintre n’employât point ses robustes qualités à des scènes historiques.
Il y a encore en France beaucoup d'esprits faibles. Les courtisanes de la Régence, le fard, les mouches et les brebis, ont singulièrement troublé la tête de ces pauvres gens, qui ne trouvant ni la gloire, ni le bonheur dans leur époque, s'imaginent que les petits vers, les soupers et les petits chiens, les marquises, les actrices et les guerluchons, et Collé et Piron apporteraient un peu de calme dans leur esprit, où poussent de longues herbes sèches. Ils ignorent que le costume moderne est en harmonie avec la physionomie moderne, et que les galanteries des ajustements de Watteau nous rendraient plus ridicules que Cassandre. Notre costume noir et sérieux a sa raison d'être, et il a fallu les tendres chimères d'un précieux pour s'écrier combien il était heureux que « le prochain Longchamp apportât des feuilles aux arbres et des plumes aux chapeaux d'hommes ».
Heureusement le temps est passé de ces panthéistes qui ont fait jouer à la nature des comédies si niaises. Un art nouveau apparaît, sérieux et convaincu, ironique et brutal, sincère et plein de poésie. Ceux qui mettront à nu toutes ces friperies orgueilleuses ne tarderont pas à paraître : les esprits se remuent de toutes parts. Les jeunes intelligences attendent le premier audacieux qui fera sauter tous ces chercheurs de mots, cette école de plaisants, ces ramasseurs d'esprit, ces moutons de Panurge qui sautent tous le même fossé, ces faiseurs de proverbes, ces littérateurs à clichés, ces pâtissiers avec leurs vers fondus dans le même moule.
Et il n'y aura pas de temple assez grand pour contenir tous les livres à habits jaunes qu’on sera obligé de déchirer avant de les mettre au rebut ; car il faudra montrer comme ils étaient mal cousus, les bourres de mauvaise qualité qui les emplissaient et la triste doublure dessous. Pénible besogne qui demande plus d'un jour.
On comprend le scandale que produit l'Enterrement flanqué à gauche de l'Appel des victimes de M. Müller ; à droite, du Départ des volonlaires, de M. Vinchon ; en face, de la Bataille de Koulikovo, de M. Yvon ; c'est-à-dire la peinture anecdotique-sentimentale, la peinture académique et la fausse énergie, entourant une peinture mâle, puissante et sincère.
De loin, en entrant, l'Enterrement apparaît comme encadré par une porte ; chacun est surpris par cette peinture simple, comme à la vue de ces naïves images sur bois, taillées par un couteau maladroit, en tête des assassinats imprimés rue Gît-le-Coeur. L'effet est le même, parce que l'exécution est aussi simple. L'art savant trouve le même accent que l'art naïf. L'aspect est saisissant comme un tableau de grand maître. La simplicité des costumes noirs tient de la grandeur des parlements en robes rouges peints par Largillière. C'est la bourgeoisie moderne, en pied, avec ses ridicules, ses laideurs et ses beautés.
L'Enterrement de M. Courbet doit une partie du scandale qu'il a soulevé à une forte individualité, robuste et puissante, qui écrase les peintures ses voisines. La critique s'enthousiasme devant une tête de fumeur, un peu maniérée, qui est le portrait de l'auteur. Il y a du génie dans l'Enterrement à Ornans ; le portrait de l'Homme à la pipe, tant admiré, est dix fois mieux peint dans dix têtes de l'Enterrement. Je ne donnerai pas de conseil au peintre ; qu'il aille où l'emporte son pinceau. Il a produit une œuvre dans ce temps de médiocrités ; qu'il oublie dans l'étude les misères que lui feront subir les médiocrités.
Notes
1) ↑— HISTORIQUE est la petite malice d'un artiste fatigué de classements arbitraires dans le domaine de la peinture.
2) ↑— Charles Le Brun, né le 24 février 1619 à Paris, où il est mort le 12 février 1690, est un artiste peintre et décorateur français, premier peintre du roi Louis XIV, directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et de la Manufacture royale des Gobelins. Il s'est surtout illustré dans la décoration du château de Versailles et de la galerie des Glaces. Il est l'auteur d'une Méthode pour apprendre à dessiner les passions, (1698), livre posthume qui eut une grande influence sur l’art du xviiie siècle (Sce. WKPD)
3) ↑— Une planche importante se prépare d'après cet Enterrement ; mais c'était le lendemain de la discussion qu'il eût fallu la publier. Quel pavé pour la critique qu'un cahier gravé de vingt têtes du drame, réduites par la photographie d'après le tableau ! Dix laides, dix jolies ou belles, et pour légende, au-dessous, les commentaires de chaque critique. Le public aurait eu la preuve qu'il est presqu'impossible de montrer dans les arts.

Courbet
Pierre Mac Orlan, Masques sur mesure II, 1951.
I
En reliant entre elles les différentes notes, dont beaucoup appartiennent à mes documents imaginaires, je prends la mesure de la tâche que j'ai entreprise : elle n'est pas modeste. Écrire afin de présenter Courbet devant l'opinion de ses admirateurs est une besogne comparable à celle qui aurait pour but de donner une explication de la nature dans ses apparences les plus quotidiennes, c'est-à-dire les plus simples, les plus colorées, mais aussi les plus hermétiques. Il est difficile d'expliquer pour quelles raisons artistiques ou littéraires la rose sent la rose. C'est un fait, et la condition humaine des peintres authentiques est également un fait aussi mystérieux que tous ceux qui aident aux créations de l'art qui sont, peut-être, les seuls buts que puisse atteindre l'humanité pour s'enorgueillir de soi-même. En dehors des arts, qui toujours finissent par se confondre avec les éléments poétiques qui aident à la survivance de toutes les religions, l'humanité n'a pas tellement l'occasion d'être admirable. L'art a sauvé plus d'âmes que le Christ. On ne sait ce qu'il serait advenu de la puissance de l'art, sa puissance raisonnable et divine, si les peintres et les poètes avaient eu le souci de revêtir une chasuble. Le Moyen Âge, qui associa heureusement la pensée catholique à l'art, hésita peut-être, ou ne put protéger devant l'avenir cet esprit de collaboration religieuse qui pouvait sauver les hommes de l'inquiétude d'évoluer dans un monde puissant où se heurtent les intérêts particuliers de toutes les apparences de la vie. L'homme est seul devant la vie végétale, la vie minérale et la désespérante féerie des galaxies. Les dangers qui l'entourent sont ceux dont l'imagination complice sait offrir un semblant de représentation. C'est l'art qui donne une forme à la nature et qui, par l'autorité d'un individu prédestiné, nous garantit la paix dans nos promenades, dans une forêt, sur l'eau et souvent dans les rues. Cette paix n'est d'ailleurs qu'un compromis un peu mystique entre nous et les catastrophes qui rôdent autour de notre fragilité éternellement impuissante devant l'eau, la terre et ses feux, le ciel et je ne sais quoi encore de très imprécis mais de violent. La nature ne nous tend point que des pièges ; elle sait offrir des fêtes dont on connaît parfaitement les protocoles : la fête du printemps, celles de l'été, de l'automne et de l'hiver. Ces réjouissances sont celles de la couleur qui demeure toujours surprenante ; c'est la fête révélée par la peinture qui touche souvent la vérité par une sorte d'alliance entre elle et le don des choses.
Ainsi, à certaines minutes de sa vie, Courbet n'est pas très différent d'une rivière bavarde, d'un nuage alourdi par les eaux hostiles. C'est un peu la substance physique de Vlaminck, sans autre comparaison entre ces deux artistes dont l'un, Courbet, est un pur élément de la sensualité universelle, quand le corps féminin lui sert de pierre de touche pour essayer le miracle enclos dans ses tubes d'étain. La nature présente deux aspects dont les richesses sont certaines : elle se confie franchement aux peintres ; elle se dérobe devant les écrivains, à l'exception de quelques poètes, de quelques musiciens qui appartiennent au groupe sanguin des peintres.
Courbet est chez lui dans ce monde d'une simplicité parfois angoissante. Les orties ne le griffent point, le brocard et le daguet ne lui gardent point de haine pour avoir entendu sonner l'hallali d'Orléans dans la petite trompe de chasse à sept tours. Courbet était un grand chasseur. Il peignit souvent des scènes de chasse pendant les années 1858, 1859, 1867, 1873 aux environs d'Ornans.

Ce sont là des œuvres révélatrices, d'une brutalité naturelle. Courbet voit le paysage et ses accessoires, de ses yeux de loup, momentanément, car, en d'autres occasions, sa tendresse est celle d'un amoureux de tout ce qu'il peut toucher de la main prolongée de son pinceau. Courbet n'est pas un rustre ; il ne manque pas de culture littéraire ; mais il sait que toutes les philosophies, toutes les transcendances aboutissent toujours à ce geste : toucher de la main.
Le sens du toucher est le plus efficace quand il faut pénétrer dans les confidences de la nature en oubliant la présence de l'homme. Un garçon intelligent peut comprendre, à la rigueur, un ouvrage de mille pages qui lui expliquera ingénieusement que de mettre la main sur un morceau de fer chauffé à blanc fait mal. Mais il comprendra encore mieux le jour où, par mégarde, il mettra sa main, la sienne, sur ce fer incandescent. La morale de la nature puise ses enseignements dans l'éducation des cinq sens. Si l'on peut dire, en parlant d'éducation, elle est instinctive. On doit aussi tenir compte des dons qui permettent une utilisation subtile des yeux, du nez, de la bouche et des doigts. Un peintre fait plus ou moins partie de ces gens bien doués ; mais un peintre comme Courbet en est une puissante révélation. Courbet possédait l'intelligence de l'œil et la plus grande de toutes, celle des mains ; la mystérieuse sensibilité des aveugles qui comprennent tout et pénètrent facilement dans le surnaturel des choses par le bout des doigts. Chez Courbet, naturellement, l'extrémité des doigts se confondait avec le pinceau. Le pinceau, la brosse pour dire mieux, n'est pas un objet, mais une sorte de viscère apparent qui obéit à des réflexes délicats et secrets. Le pinceau est un organe de peintre ; il obéit à ses instincts ; il appartient à son corps comme l'œil et la main. Champfleury a certainement compris Courbet ; mais son jugement n'est pas fécond. Le meilleur juge et critique de Courbet, c'est Courbet lui-même. Personne ne peut expliquer un peintre puisqu'on n'explique pas l'effet en le confondant avec la cause. Le peintre, la nature et la toile : il n'existe aucune solution de continuité entre ces trois éléments. Il est évident qu'il ne s'agit pas de la peinture abstraite. Dans le cas Courbet, c'est l'image d'un cercle, d'un monde sans commencement ni fin. Courbet avait appris d'instinct le langage savant de la civilisation végétale. D'instinct, il possédait le vocabulaire des quatre éléments. Si un miracle signé Merlin, celui de la forêt de Paimpont pouvait donner aux arbres, aux herbes, aux rochers la parole, Courbet aurait pu s'entendre avec les érudits de la flore sauvage et des pierres. C'est peut-être dans le contact avec la brosse intelligente et libre qu'il a puisé une connaissance heureuse et inexplicable de la sémantique des plaines, des bois, de la mer et des femmes qui appartiennent par bien des détails aux grands clubs de la nature végétale.
Situer Courbet au centre lumineux des émotions qu'il suscite devient une besogne inhumaine. L'admiration est un mot dont la valeur n'est plus en usage que dans le vocabulaire de la critique, des dédicaces de livres et dans le savoir-vivre des usages mondains. Si, en tête de cet essai dont j'ignore en ce moment la bienséance, j'ai pu inscrire la phrase devenue célèbre de Théodore de Banville, c'est parce que j'ai pensé que cette phrase familière plairait à l'artiste qui est entré chez moi familièrement. Comme tous les peintres que j'ai connus et qui participent à ma vie indépendante, tout au moins en présence des formules de laboratoire littéraire, Courbet se tient debout dans ma pièce de travail, barbu, bien portant, bruyant. Il joue avec la foudre dans les porcelaines de la vie quotidienne. Ses gestes sont, pour lui, les meilleurs exercices d'une culture physique dont il a su utiliser les principes.
Il fume, il boit, comme il chasse, comme il peint. Il caresse les joues brunies d'une jeune fille de la campagne, comme il promène sa brosse sur la surface d'une toile dont le magnétisme secret l'attire et commande les gestes d'un métier qui atteint à la perfection. Bonjour, monsieur Courbet ! Que puis-je vous offrir si ce n'est d'ouvrir ma fenêtre sur mon clos peuplé d'arbres robustes, devant un ciel de Corot, des histoires de Haute-Chasse devenues légendaires, devant des bruits villageois invisibles parmi lesquels la cloche de l'église médiévale. Ce sont les détails divins de votre église particulière. Et c'est pourquoi je cite l'église catholique dont vous avez transposé les apparences. Votre foi libérée appelle la nature que la cloche convie à des congrès très distingués. C'est le signal de François d'Assise pour tous ceux qui ont prévu dans les temples un banc pour les bêtes attentives.
Bonjour, Monsieur Courbet ! Ce titre convient à cet entretien qui est simplement un hommage. Ce n'est plus monsieur Bruyas qui parle, mais un passant quelconque pour qui les routes fréquentées par les peintres sont accessibles. J'ai connu ces artistes, un peu gitans, qui, bien avant l'usage populaire de la voiture automobile, allaient sur nos chemins, le dos chargé d'un havresac, d'un chevalet et d'une boîte patinée par les intempéries : de Courbet à Segonzac, Vlaminck, Asselin, Derain, et quelques autres que, dans mes souvenirs, je peux revoir en cet équipage. On disait encore, pour parler d'eux, les peintres de la Nature. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces mots gardaient leur signification essentielle, car l'ordonnance des choses naturelles, selon les principes de la création, n'était pas encore très nettement bouleversée.
Ceux qui ont parfaitement connu Courbet, comme M. Max Buchon, sont à consulter pour faire revivre ce peintre que les Goncourt désignaient comme “Le Jordaens moderne”, ce qui n'est pas, je crois, une définition absolue. Cependant on peut conclure, grâce à la présence de certains hommes, très sensibles à l'art de peindre, que Courbet ne fut jamais un isolé. Le contact de ceux qui le comprenaient permettait à sa puissante personnalité de franchir aisément les barrières des manifestations officielles et les découragements offerts par l'esprit éphémère de la critique de l'époque.
II

Courbet fut toujours inspiré, provoqué par cette vigoureuse sensualité qui est la source des énergies naturelles. Cette sensualité se révèle dans son œuvre, quel que soit le sujet qui capte ses regards et sollicite sa main instinctive, une main d'une loyauté réconfortante... En dépit d'opinions assez diverses, comme celles de Champfleury qui déclarait mélancoliquement que Courbet ne comprenait rien aux femmes et de Castagnary qui lui accordait gentiment un brevet de chasteté, Courbet fut un très grand peintre de la femme. Devant lui, elle apparaît avec plus de franchise qu'elle ne s'en accorde à elle-même devant son miroir. Entre la palette du peintre à sa gauche et la toile vierge à sa droite, la femme maniait le pinceau miraculé par la vie. Courbet fut toujours bouleversé par cette sensualité primaire, inconsciente qui se dégage d'un corps féminin.Il l'aimait robuste, parce que dans la force des filles nues il découvrait le mystère initial de la genèse et l'explication presque religieuse de la vie.

Cette haute morale, qui est celle de la sensualité pure, inspire tout le travail de son existence, une œuvre qui n'est jamais anecdotique, à la manière des peintres du xviiie siècle qui gardaient la réputation d'être les peintres les plus sensibles de la femme. Les filles de Courbet sont sans histoire : ce sont des paysannes bien bâties et, quelquefois mais rarement, des filles publiques qui furent des paysannes authentiques avant d'accorder leurs dons naturels avec les exigences équivoques d'une profession vieille comme le monde. Le rayonnement sain et tonique qui se dégage des toiles peintes par Courbet devant le spectacle ingénu d'un corps féminin suffit pour qu'on puisse en comprendre la décence érotique et l'attrait. On devrait citer, en exégèse sur cette opinion qui est la mienne, les Demoiselles au bord de la Seine, les Trois baigneuses, la Fileuse endormie, les Baigneuses, la Femme qui enfile ses bas blancs, la Jeune fille au chevreau, la Baigneuse adolescente à la source, l'Irlandaise, etc., etc.

Le meilleur commentaire que l'on puisse faire sur ces images qui restent vivantes, c'est d'écrire que tout cela sent très bon, la bonne odeur de la sève dans les bois, l'odeur du ciel sur les foins, l'odeur de la chasse dans les brumes du jour qui se lève.
La plupart des aventures de la morale sociale viennent se heurter et trébucher devant l'œuvre de Courbet. Il devient même irritant de parler de la morale quand il s'agit d'une œuvre qui la domine nettement. La présence d'un jeune enfant dans l'atelier de Courbet, entre le modèle du Doubs et Baudelaire, est un symbole de candeur, d'innocence et, encore une fois, de vie. La peinture de Courbet laisse couler le sang intime de nos veines ; elle se voit et s'entend, parfois, comme s'entendent les battements du cœur. Le sang qui coule dans ces corps peints, abandonnés au peintre sans restriction hypocrite, n'est pas celui des livres. C'est le grand secret de la peinture que de garder les arcanes fondamentaux de la vie. Un portrait de Courbet demeure vivant.

C'est en quoi la métaphysique qui naît de la peinture diffère de celle que suscite l'art photographique. Un portrait photographique de Nadar est le portrait d'un mort ; un portrait peint par Courbet est le portrait d'un vivant. L'art photographique demeure, cependant, un art puissant, mais un art fantastique et funèbre. C'est un moyen d'expression plastique qui appartient à la littérature, particulièrement au surréalisme ; c'est également une des essences les plus fécondes d'un romantisme dont les détails s'assemblent depuis quelques années. Je pense à Kertesz.
Les femmes de Courbet ne peuvent inspirer un écrivain, car elles n'ont pas d'histoires à conter. Elles ne sont belles que par le rayonnement de leur condition de femme. Elles peuvent réconforter car elles disent qu'il y a toujours un instant dans la vie des filles laides où leur chance éclate “comme un coup de tonnerre à travers la baie”. Il s'agit de l'aurore qui se lève sur la baie de Moulmein dans la célèbre chanson de Rudyard Kipling.

Rien n'est plus chaste, au sens social de ce qualificatif, que ces deux femmes qui se reposent sur les rives de la Seine après une partie de canot. Laissons de côté la Grenouillère de Guy de Maupassant. Nous n'apercevons, dans cette image d'une simplicité littéraire surprenante, que deux filles alourdies par la sieste qui suit un bon déjeuner dans une guinguette de Bougival. L'image est lourde de sommeil ; cependant, elle se charge d'une puissance clandestine qui rejoint la littérature par des hypothèses dont le peintre n'est pas irresponsable.

C'est de sa part une création dont il est irresponsable. Encore une fois, bien que mortes depuis longtemps, ces femmes sont si vivantes qu'on peut leur prêter des intentions. J'ai voulu utiliser cet exemple afin de rendre plus claire ma pensée sur la survie picturale.
Pour mieux se lier à Courbet, il faut admettre que la couleur est instinctive de même que la parole. Des peintres comme Maurice Utrillo ont appris l'usage de la couleur en tubes avant celui de l'alphabet. Dans l'ombre de sa mère, Suzanne Valadon, tout enfant, il apprit a peindre comme d'autres apprennent à lire. À peine adolescent, sans directions familiales, Courbet sut aussi que la couleur serait son langage de libération. Et son lyrisme naquit d'une prodigieuse facilité à se servir de la couleur, des brosses et du couteau à palette. Ce lyrisme est si évident qu'il est à peu près impossible d'écrire sur l'œuvre de Courbet sans accorder son propre lyrisme avec le sien. La force de la vie nourrit à tel point le génie de Courbet qu'il est difficile d'imaginer les cadavres des filles qu'il peignit. Ce fait indique le magnifique optimisme de ce créateur qui obtint de son œuvre une protection permanente contre la mort.

Le désir et le pouvoir de protéger la forme et la couleur des choses contre la déchéance valurent à Courbet d'être classé comme un réaliste. Ce mot manque de signification précise, particulièrement quand il est nécessaire de transposer la vie sur la surface vierge d'une toile tendue sur son châssis. Bien des artistes ont su peindre ce qu'ils voyaient ; quelques-uns, d'inoubliables exceptions, purent animer l'image du feu de Prométhée. M. Georges Riat, dans l'ouvrage qu'il a consacré à Courbet, dit qu'il convient de ne pas chercher à approfondir trop les idées de Courbet ; c'était aussi l'opinion de Proudhon. L'un et l'autre sentaient parfaitement que la personnalité de ce peintre était évidente mais inexplicable. Cette substance inexplicable de l'œuvre de Courbet imposait à ses amis une attitude souvent irritante. Ils tentaient de bonne foi de l'excuser, en affirmant qu'en peignant les demoiselles des bords de la Seine, le peintre avait désiré montrer un des aspects du vice quand il représente une anecdote de la déchéance humaine. Je pense sincèrement que Courbet se souciait peu d'ajouter un paragraphe de plus au code de la morale sociale. Tel qu'il m'est permis de le comprendre, je le vois très bien, passant ses doigts dans sa barbe assyrienne et disant : “Que vont-ils chercher là !”

Par sa peinture, Courbet libérait sa pensée qui était souvent aussi fraîche que celle d'un enfant. Il le savait. Il savait surtout qu'on pouvait facilement le faire trébucher contre des obstacles insignifiants. Sa gloriole, sa violence verbale, son accent, son patois, son orgueil candide, n'étaient que des moyens de défense. Presque tous les timides savent en user. Et c'est ainsi que les catastrophes les plus désolantes sont quelquefois provoquées par des timides exaspérés par l'injustice. Il est probable que certains jugements de Théophile Gautier, de Delacroix et de beaucoup d'autres ne pouvaient lui plaire. Il simulait, parfois, l'indifférence. Mais je ne crois pas à la sincérité de cette attitude qui ne correspondait pas à la personnalité physique de Courbet rasé et de Courbet barbu. Ces deux visages sont émouvants : ils sont presque sans parenté car l'un dissimule l'autre. Malgré la courtoisie de Théophile Gautier dans sa critique de l'Enterrement d'Ornans, Courbet devait en souffrir à l'abri de tous les regards. Ce robuste était construit en matériaux tendres et le moindre coup d'ongle laissait des traces rouges difficiles à cicatriser. La jeune admiration de Manet pouvait servir de dictame.
Si les éducateurs rencontrèrent en Courbet un élève rétif, on ne doit pas négliger la très intelligente leçon de M. Oudot qui fut le professeur de rhétorique de Courbet. Une phrase de M. de Bonald, rapporte Georges Riat, servit de sujet au cours de dissertation française de ce professeur remarquable. Il faut la citer : “Un homme ne peut comprendre et produire d'art que celui qui interprète sa propre nature ; l'art, en tant qu'expression du sentiment de la société, doit par conséquent se transformer aussi souvent que la société même...”
Et Georges Riat ajoute : “Ces aphorismes, longuement médités, eurent pour conséquence une grande influence sur l'esprit de Courbet ; ils pourraient être la devise du réalisme.”
Les aphorismes de M. de Bonald marquent un des aspects les plus importants de l'histoire de la peinture. Un essai sur l'art, depuis 1901, pourrait en choisir afin de les placer en épigraphe. La peinture mieux que la nature sait trouver l'expression et la définition d'une époque et, si l'on veut, des moyens arbitraires mais neufs pour y parvenir ; ce que ne peut faire l'art littéraire ; étroitement lié à la tradition par la construction de la phrase. Il est vrai que l'on peut donner aux mots une apparence nouvelle.
La langue populaire, quelquefois les différents argots s'introduisent de plus en plus dans la langue savante. Mais les lois de la langue écrite sont toujours plus rigides que celles qui rassemblent les lignes, les couleurs et les notes de musique.
III
En deux volumes substantiels, M. Pierre Courthion a groupé avec clarté des documents vivants et précis. Ce “Courbet raconté par lui-même et par ses amis” me semble combler l'imagination d'un lecteur épris de ce grand peintre dont on ne peut oublier la présence quand on le fait entrer dans sa demeure pour une entrevue posthume, comme je les aime à cause de leur attachante sincérité. Georges Riat, le comte d'Ideville, Castagnary, GrosKost, Champfleury, Barbey d'Aurevilly, Proudhon, Millet, Jules Vallès... - et je m'arrête de citer – ont contribué à faire triompher le Franc-Comtois qui ne fut jamais entamé par les acides agréables d'un Paris mondain déjà menacé dans ses habitudes. Il semble que Courbet aimait à se mêler à la société de son temps ; ce n'était pas un solitaire. Il respectait la vie dans toutes ses manifestations, car il se savait physiquement assez fort pour lutter et vaincre. Ses victoires furent plus nombreuses que ses défaites. Sa santé s'alliait harmonieusement à son génie sans l'amoindrir par des conseils de prudence. Les entrevues posthumes dont je disais plus haut, me font mieux entendre le salut amical de monsieur Bruyas, le jour qu'il rencontra, sur la route de Montpellier, monsieur Courbet qui se rendait à son travail. Un jour ou une nuit ce fut Hogarth qui vint à sa rencontre, lors d'un voyage que le FrancComtois fit à Londres. Courbet raconte lui-même cette aventure littéraire, la seule, peut-être, qu'on puisse introduire dans son existence. Je connais Londres, mais je n'imagine pas dans quel endroit de cette ville secrète Courbet situa sa rencontre avec le vieux fantôme de l'année 1764. Londres, autant que je puisse l'assurer, ne laissa aucune trace dans l'œuvre de Courbet. Cependant il sut tout de suite que Londres était la ville des apparitions brumeuses. C'est pourquoi il accueillit la résurrection d'Hogarth qu'il aimait comme un artiste vivant et familier. Etait-ce dans Fleet Street ou dans ce Poplar, toujours un peu mystérieux ? Le fait est que j'entends la voix d'Hogarth et son accent cockney conventionnel : “Bonjour, monsieur Courbet ! ”
Cette anecdote rejoint assez intimement ce fantastique des villes romantiques qui, dans le temps où Courbet s'abreuvait - comme on dit – à toutes les sources de la vie, n'était point très apparent et ne pouvait guère inspirer un romantisme social qui ne dépassait pas le climat des tapis-francs de Paris et celui plus fécond d'une sorte de surréalisme né de l'argot des malfaiteurs.
À l'époque où Courbet peignait de robustes filles comme autant d'hommages à la beauté des paysannes et à la santé rustique, des éléments arbitraires, des personnages de laboratoires magiques, dont le Diable, dandy revêtu de pourpre, s'interposaient entre la vue et la pensée des écrivains. De Baudelaire à Gérard de Nerval chacun réclamait l'aide d'un monde cérébral né dans l'ombre la plus épaisse des malédictions artificielles. Le docteur Faust cherchait dans son cabinet de travail inef. ficace et prétentieux, la désagrégation de l'atome et, si l'on désire, le secret de la désagrégation du monde naturel.
Courbet, parmi peu qui le précédèrent et quelques-uns qui le suivirent, lutta comme un arbre dans la tempête en se confiant à son instinct vital, contre la fin ou, tout au moins, le bouleversement des paysages héréditaires, paysages humains et végétaux. Il prévoyait, à son insu, qu'une cascade née d'une source de montagne, la cascade de Marcel Duhamel, pourrait se muer en une réunion de tuyaux destinés à alimenter un jeu de turbines. Mais il ne pouvait prévoir qu'une telle profanation puisse devenir un élément authentique de beauté et d'émotion. Il est, je crois, imprudent de s'essayer à définir la présence du naturalisme dans une œuvre peinte ; car la peinture, qui est un poème d'une mobilité surprenante, se libère de toutes les définitions au moment qu'elle crée. Cette mobilité dans le lyrisme doit s'accorder, par exemple, avec Pablo Picasso qui est un peintre du mouvement dans la nature, ce mouvement éternellement insatisfait qui, par principe, échappe à toutes les conclusions de la culture classique.
Le besoin de stabiliser sur ces toiles le mouvement de la vie donnait à Courbet sa sérénité quotidienne. Les nombreux tableaux qu'il consacra à des scènes de chasse, d'une beauté solennelle, le situent facilement dans sa condition de peintre de la nature, doué du merveilleux pouvoir des cinq sens originels.
J'ai devant mes yeux de fort belles reproductions de l'Hallali du cerf et de cette à peu près divine Remise des chevreuils à Plaisir-Fontaine que l'on peut voir au musée du Louvre. Dans ce paysage, profondément inspiré par la civilisation des bêtes libres, Courbet est sans doute présent, derrière un buisson au bord du ruisseau, contre le vent. Il a oublié qu'il tenait un fusil prêt à être épaulé. Il a oublié tout ce qui n'est pas l'élégance de ces bêtes dans l'admirable complicité du paysage. C'est là que nous retrouvons la haute morale du peintre qui anéantit dans sa lumière les hypothèses saugrenues de ceux qui voulurent juger les filles dans leur remise des bords de la Seine en essayant de le justifier maladroitement. Ceux qui vivent dans l'Est connaissent ces paysages de chasse. On porte en soi la Forêt de Brocéliande et, ainsi, on la retrouve partout avec ses légendes, ses usages, les sonneries mélancoliques et barbares de la petite trompe des bois. Très loin, derrière le morne raffut des rabatteurs de fortune, elle lance aux échos son pur langage : les têtes, le daguet, la biche sacrée, le sanglier, le renard, pour finir sur l'hallali et l'adieu. Dans cette énumération, j'oublie le cerf qui porte la croix flamboyante entre ses bois. Tant d'amour, tant de compréhension, tant de respect pour les bêtes pour aboutir au meurtre ! C'est inexplicable comme sont inexplicables les cruautés et les tendresses de la nature. Tout cela se retrouve dans les scènes de chasse peintes par Courbet, parce que les détails de la composition se soudent les uns aux autres sans préséance. La biche vaut l'arbre et l'arbre vaut le ruisseau qui donne à ce morceau de forêt un enchantement durable. Les scènes de chasse sont difficiles à transposer ; il n'est pas possible de ruser ; chacun sait que le sujet est ingrat. Courbet a su lui imposer sa distinction définitive. Le maître des champs, des bois, des plaines de la montagne, et, parfois, de la mer est à l'aise. Il est partout chez lui quand l'homme ne dérobe point à la nature ses couleurs et ses dons.
J'ai connu des peintres qui, sans posséder l'immense pouvoir de Courbet, lui ressemblaient par une grande intelligence de leur propre santé. Ces peintres portaient la barbe pointue, annelée des satrapes heureux. Ils buvaient bien, mangeaient beaucoup, fumaient quarante grammes de tabac par jour. J'ai toujours éprouvé de la sympathie pour ces hommes puissants que la délicatesse de l'oeil et de la main protégeait contre les vulgarités de la pensée. Ils vivaient facilement dans les chansons de cabarets des nuits sans sommeil. À l'aube, n'ayant pas fermé l'oeil, ils entraient frais et comme recouverts de rosée dans l'éternel rajeunissement du jour. Il existe une étroite relation entre l'aspect décoratif de ces peintres et la tradition respectée de nos paysages familiers. Depuis deux guerres, les peintres ne ressemblent plus à la silhouette négligée et sympathique qui toujours rappelle la présence de Courbet dans ses paysages. Leur tenue s'est modifiée ; les paysages que nous connaissons tendent à se modifier également ; les décors se meuvent dans des apparences logiques, peu précises, souvent inquiétantes.
L'inspiration sociale de la peinture rejoignit le monde urbain et son pittoresque mondain ou crapuleux. La reproduction de l'agitation populaire des grandes villes sembla réservée aux peintres du “deuxième rayon”, si l'on peut dire. Mais s'il est évident que Courbet se préoccupa fort de la société de son époque, il n'en est pas moins certain qu'il n'hésita jamais, pour œuvrer, à se mêler à l'existence de petites gens, honnêtes comme il l'était lui-même. D'autres, tel Constantin Guys, accordaient aux filles, par exemple, une place qui leur échappait depuis les graveurs galants du XVIIIe siècle ; leur présence n'entrait pas dans la vie sensible et sociale de Courbet ; si cela existe on peut dire que les témoignages en sont très rares. Je n'en connais que deux révélations peintes ; encore l'une d'elles est nettement inspirée par la mythologie ; Courbet malgré sa sensualité n'insista jamais sur le rôle social des filles légères. Dans les deux amies de la sieste au bord de la Seine, on ne sait retenir qu'une allusion fragile aux attitudes célébrées par la poétesse antique. C'était un jeu de lignes féminines harmonieuses beaucoup plus qu'une allusion érotique qui éveillait la curiosité de l'artiste.
La subtilité de Courbet est très efficace. Il est de ceux qui purifient tout ce qu'ils touchent parce qu'ils sont eux-mêmes sains ou, mieux, à l'abri des tentations déraisonnables. Les divers aspects de la pureté sont innombrables ; ils sont aussi nombreux que ceux du vice. Le mot pureté est d'ailleurs un mot dont il est préférable d'user modérément et avec soin.
La peinture est révélatrice de la chasteté de la pensée, car la couleur est une matière plus honnête que l'encre. Les couleurs dont elle use afin de faire entendre ses messages inspirent la confiance. Elles donnent à l'homme cette éphémère dignité qui, sitôt née, s'évanouit pour disparaître dans l'état de défense dont la nature l'a gratifé sans en prendre la responsabilité légale.
Ces quelques notes sentimentales me reconduisent vers la rencontre avec Courbet, mais, cette fois, loin des influences champêtres, quand il chantonnait au bord de la route, la main offerte, au devant de monsieur Bruyas, son domestique ému, et son chien. Courbet dut lutter, non seulement contre les Parisiens, mais contre l'atmosphère de Paris : le Paris de sa jeunesse estudiantine, le Paris des expositions d'art, et, ce qui est admis comme une calamité dans la vie d'un artiste, le Paris des bouleversements sociaux. La condition de l'artiste, l'usage instinctif qu'il fait de sa liberté, le désignent d'avance comme une victime à peu près sans défense. Combien de noms estimés pourraient s'inscrire ici, en partant de Courbet, pour aboutir à une forme dangereuse du découragement.
IV
Un document signé de la main de Courbet indique l'orientation de son esprit. Courbet écrit : “Savez-vous ce qu'il faudrait atteindre, François ? Eh bien ! c'est le renoncement au chauvinisme et les Etats-Unis d'Europe. Comme ça, tout serait fini, et on vivrait en hommes ! ”
Courbet écrit encore : “Ah ! que le malheur qui pèse sur l'homme est grand ! qu'il est puissant et difficile à vaincre. Que les ténèbres qui obscurcissent tant d'intelligences sont lentes à se dissiper ! ...”
Ces mots médités par Courbet pourraient toujours servir d'épigraphe à un essai sur la vie politique du peintre qui, par certains détails d'une très émouvante honnêteté, fait parfois songer à George Sand quand elle se mêla à la Révolution de 1848 à côté de Ledru-Rollin. Courbet connut des épreuves infiniment plus substantielles. Il se rapproche encore de George Sand quand il prend la résolution de renoncer. Il écrivait alors au chansonnier Pierre Dupont ces mots : “Tous ces rêves ont fui, et bientôt nous serons condamnés à baser notre avenir sur le souvenir.” Cette amertume associe Ornans à Nohant et quelques hommes de mon âge à Courbet. Courbet fut blessé profondément, incurablement par l'injustice cruelle qu'apporte la victoire de l'un ou de l'autre dans les guerres civiles. On sait qu'il fut condamné par un conseil de guerre versaillais à six mois de prison et par d'autres tribunaux à payer le montant des dépenses nécessaires à la reconstruction de cette colonne Vendôme qui pesait peu devant son œuvre. M. Castagnary publia en 1883 un “plaidoyer pour son ami mort”. Incarcéré à Sainte-Pélagie, Courbet en sortit accablé par la sottise d'un jugement qui l'obligeait à vivre jusqu'à l'âge de quatre-vingt-onze ans pour se libérer de sa dette.
En 1872, Courbet est à Ornans. Il reconstituait son atelier ; c'est à ce moment qu'il apprend sa condamnation. L'alternative était : ou payer ou faire cinq ans de prison. Courbet décida de se réfugier en Suisse. J'ai résumé brièvement cette sinistre aventure. Elle est importante car elle représente une sorte d'illustration de la vie des artistes et des poètes dans les périodes où chacun est enclin à prédire la fin du monde ou, plus simplement, la fin d'une civilisation, ce qui revient au même pour les victimes de ces catastrophes naturelles. En Suisse près de Vevey, le peintre retrouva une sorte de sérénité : celle qui suit les grandes aventures spirituelles dont les plus fortes personnalités sortent vaincues. Les idéaux de Courbet étaient vieux comme le monde des hommes. Mais les idéaux les plus nobles ne sont pas désespérants tant qu'ils restent dans le domaine des idées. Le découragement naît au moment qu'un visage humain, célèbre souvent, mais à sa manière, en devient le symbole.
On pourrait écrire longuement sur les rapports de la politique avec l'indépendance naturelle aux créateurs d'art. Ces rapports sont dangereux pour ces derniers, car la politique est soumise à des lois qui deviennent des pièges pour ceux qui ne font pas un métier de cet art compliqué de conseiller les peuples et les gouverner. Courbet voulait le bonheur des hommes comme tant d'autres. Ce désir émanait de lui comme de la rose émane un parfum particulier dont la suavité est légendaire. Membre de la Commune de Paris, il raisonnait en utilisant la même force qui l'animait quand il peignait la remise des chevreuils, le dos souple et charmant de l'adolescente, la jeune baigneuse à la source, du Metropolitan Museum of Art de New York. Pour ce sincère idéaliste, bien servi par la protection de ses sens, - il faut insister – la politique devenait aussi pure que la volonté d'une source de couler librement vers son but. Courbet aimait l'humanité comme il aimait la faune et la flore dont il accorait son besoin de vivre, le beau navire de la confiance en soi, en dehors de l'anecdote sociale (La colonne Vendôme).
Les derniers jours du grand peintre d'Ornans furent pénibles. On sait qu'il souffrait d'hydropisie. Cet homme épris de ses forces les voyait fondre au soleil qui multipliait le jeu des couleurs sur le lac. Il suivait des yeux et des doigts les progrès de sa déchéance physique, conscient d'entrer dans les faubourgs de la mort. Autour du lit se groupaient quelques hommes qui l'avaient aimé.
Cependant, les amis qui n'étaient pas présents dans le salon mortuaire surprenaient l'imagination par leur nombre et leur qualité : des bêtes douces, des bêtes chassées qui avaient pardonné, des arbres abattus par la cognée des bûcherons, déracinés par le vent, des arbres sans haine. Les cortèges de la nature rendaient encore une fois hommage à l'un des avatars, le plus humain, le plus fécond et le plus irresponsable, du dieu Pan devenu peintre, à bout de ressources. Sa présence païenne signifiait qu'il avait choisi cette enveloppe périssable pour mieux enseigner aux hommes le culte de la simplicité, de la vie et de l'indulgence des grands apôtres libérés dès qu'ils naissent.


Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague.

coll. Mr. et Mrs. James S. Delly, New York.


Princeton University Art Museum, Princeton, US.

MET, New York, US.

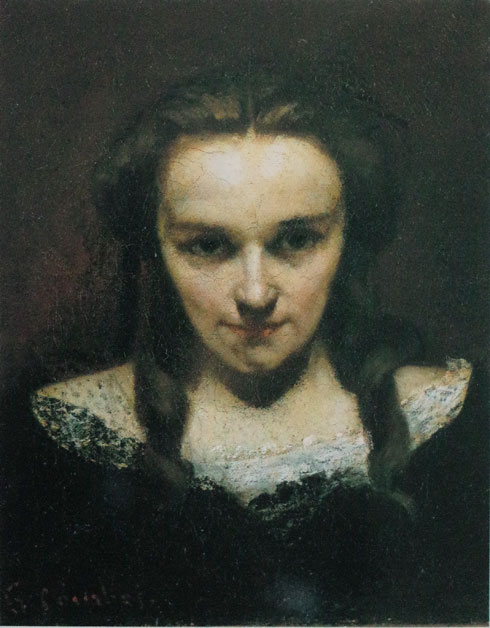



musée de l'Hermitage, Saint-Pétersbourg, RU.















peinte à la prison de Sainte-Pélagie en 1871.

Norton Simon Museum, Pasadena, US.


1855, musée d'Orsay, Paris.





Champfleury (Jules François Félix Husson, dit), in : Souvenirs et portraits de jeunesse, Paris, 1872.
I
Certains jeunes gens, plus enthousiastes que critiques, qui écrivaient dans les petits journaux en 1848, s'étaient réfugiés dans une feuille satirique, le Pamphlet. À la faveur du bouleversement politique, toutes sortes d'idées personnelles étaient permises. De Courbet j'écrivais :
« On n'a pas assez remarqué cette année au Salon, une œuvre grande et forte, la Nuit classique de Valpurgis, peinture provoquée par l'idée générale du Faust.
« Je le dis ici, qu'on s'en souvienne ! Celui-là, l'inconnu qui a peint cette Nuit, sera un grand peintre. La critique, dont le devoir est de découvrir les talents naissants, l'a oublié.
« Le peintre s'appelle Courbet. Il est parti dans les montagnes, allant courir après la nature qu'il ne voyait plus depuis la république.
« Courbet débutait avec dix toiles : un immense tableau, des portraits, des paysages, des dessins. Signe de force que cette fécondité et que cette abondance de moyens divers.
« Courbet envoyait à la faveur de la révolution, car le jury académique aurait tout refusé, des peintures très remarquables et qui ont été peu remarquées. C'est la condamnation du jury et de la critique. »
De la libre exposition de 1848 il résulta pourtant un enseignement.
La justice se faisait des œuvres, prompte et rapide, par le cri public plus que par la critique. Les huées atteignaient directement le malheureux qui osait se dire artiste, et des couronnes de foin furent attachées à des tableaux grotesques.
On n'a pas malheureusement renouvelé depuis cette tentative1.
Quand on voit la quantité d'œuvres médiocres, de fades portraits officiels, de misérables commandes, de batailles si pauvrement peintes qui emplissent nos expositions, il faut regretter la liberté du salon de 1848.
Courbet bientôt allait faire sensation à l'exposition de 1849. Une autre feuille satirique me permit, encore une fois, d'exposer mon libre sentiment sur les œuvres les plus caractéristiques de l'exposition.
« Courbet force les portes du Salon avec neuf tableaux. Personne hier ne savait son nom : aujourd'hui il est dans toutes les bouches. Depuis longtemps on n'a vu succès si brusque.
« Seul, l'an passé, j'avais dit son nom et ses qualités ; seul j'ai parlé avec enthousiasme de quelques tableaux enfouis au dernier Salon, dans les galeries du Louvre.
« Je ne me suis pas trompé, j'avais raison. Aussi m'est-il permis de fouetter l'indolence des critiques qui s'inquiètent plus des hommes acceptés que de la jeunesse forte et courageuse, appelée à prendre leur place et à la mieux garder peut-être.
« Courbet a osé peindre un tableau de genre de grandeur naturelle. C'est à la campagne, un soir ; après la chasse on a dîné gaiement. Sous la cheminée grande comme une porte cochère, un jeune homme joue du violon. Le chasseur allume sa pipe, et un vieillard, tout en caressant son verre, écoute, les épaules voûtées, pendant qu'un énorme bouledogue étendu se laisse aller à ses pensées.
« Ce tableau peut être mis hardiment dans les musées flamands, au milieu des grandes assemblées de bourgmestres de Van der Helst, il ne faiblira pas.
« Des dessins au fusain, cinq ou six paysages, complètent l'exposition de Courbet. Les paysages représentent presque tous des environs de Besançon, des montagnes et des roches qui ressemblent à des forteresses, paysages solides à couper au couteau. Ils n'ont pas le charme voilé des œuvres poétiques de Corot ; mais ils ont la qualité suprême de l'horreur de la composition. Courbet, avant peu d'années, sera un de nos plus grands artistes. »

À partir de 1849, Courbet exista, car le tableau de l'Après-dîner à Ornans fut accepté sans contestation par la foule et par le jury qui acheta cette belle toile, actuellement au musée de Lille.
Retiré dans la petite ville d'Ornans, Courbet m'écrivait : « Depuis que je vous ai quitté, j'ai déjà fait plus de peinture qu'un évêque n'en bénirait. » Par ce mot on peut juger de l'homme qui, malgré son séjour à Paris, a conservé l'essence du paysan franc-comtois.
Courbet se préparait alors à l'exposition de 1851 par une série de tableaux importants, entre autres l'Enterrement à Ornans et les Casseurs de pierres.


Ce dernier tableau il me le décrivait ainsi dans une lettre :
« Je n'ai rien inventé, cher ami ; chaque jour allant m'y promener [sic], je voyais les personnages (les casseurs de pierres) si misérables. Dans cet état, c'est ainsi qu'on commence, c'est ainsi qu'on finit. Les vignerons, les cultivateurs, que ce tableau séduit beaucoup, prétendent que j'en ferais un cent que je n'en ferais pas un plus vrai. »
Quand on pense au scandale que produisit au Salon de 1851 cet envoi de tableaux considérables, il est utile de mettre en regard la lettre que m'écrivait Courbet à propos de l'Enterrement à Ornans. On a tellement accusé le peintre de système, de parti pris, de charlatanisme, que la meilleure réponse à faire aux curieux, aux ignorants et aux gens rusés qui veulent transporter leur propre ruse dans l'esprit de chacun, est d'imprimer quelques lignes confidentielles dans lesquelles le peintre rend compte de ses travaux :
« Ici les modèles sont à bon marché, tout le monde voudrait être dans l'Enterrement ; jamais je ne les satisferai tous, je me ferai bien des ennemis. Ont déjà posé le maire qui pèse 400, le curé, le juge de paix, le porte-croix, le notaire, l'adjoint Marlet, mes amis, mon père, les enfants de chœur, le fossoyeur, deux vieux de la Révolution de 93 avec leurs habits du temps, un chien, le mort et ses porteurs, les bedeaux (un des bedeaux a un nez comme une cerise, mais gros en proportion et de cinq pouces de longueur), mes sœurs, d'autres femmes aussi, etc. Seulement je croyais me passer des deux chantres de la paroisse, il n'y a pas eu moyen ; on est venu m'avertir qu'ils étaient vexés, qu'il n'y avait plus qu'eux de l'église que je n'avais pas tirés. Ils se plaignaient vivement, disant qu'ils ne m'avaient jamais fait de mal et qu'ils ne méritaient pas un affront semblable, etc. Il faut être enragé pour travailler dans les conditions où je me trouve, je travaille à l'aveuglette, je n'ai aucune reculée. Ne serai-je jamais casé comme je l'entends ! Enfin dans ce moment-ci je suis sur le point de finir cinquante personnages grandeur nature, avec paysage et ciel pour fond, sur une toile de 20 pieds de longueur sur 10 de hauteur. Il y a de quoi crever ; vous devez vous imaginer que je ne me suis pas endormi. »
Courbet n'en dit pas plus ; il ne parle pas du scandale que produira son tableau, scandale prémédité, selon la critique. Si on doit chercher la véritable pensée d'un homme, n'est-ce pas dans les lettres confidentielles à un ami?
La seule récrimination de l'artiste est contre le peu de reculée de son atelier. C'était un grenier étroit, une sorte de boyau. On a peine à croire qu'une œuvre comme l'Enterrement ait pu être exécutée dans des conditions si difficiles ; mais l'amour de l'art fait passer par-dessus tant d'obstacles!
Plus tard seulement Courbet apprit quel épouvantail il était devenu par ses envois au Salon de 1851, et cependant il envisageait la situation avec sérénité :
« Oui, mon ami, il nous manque un soubassement de trente mille francs pour répondre à toute éventualité ; malgré tout il ne faut pas s'épouvanter. Quand je jette un coup d'eil rétrospectif et que je vois où nous sommes déjà arrivés sans le sou, ça me parait encourageant, car le plus difficile est fait. Il faut bien se le mettre dans la tête : plus on nous niera, plus on déblatérera contre nous, plus on nous grandira, plus on nous donnera d’avenir ; car chaque année qu'on nous enlève dans ce moment-ci équivaut à dix ans d'avenir.
« Il m'est difficile de vous dire ce que j'ai fait cette année pour l'Exposition, ajoutait Courbet, j'ai peur de mal m'exprimer. Vous jugeriez mieux que moi si vous voyiez mon tableau ; d'abord j'ai dévoyé mes juges, je les mets sur un terrain nouveau ; j'ai fait du gracieux, tout ce qu'ils ont pu dire jusqu'ici ne sert plus à rien. »

This painting, which initiated a series of pictures devoted to the lives of women, shows Courbet’s three sisters—Zélie, Juliette, and Zoé—strolling in the Communal, a small valley near his native village of Ornans. One of the girls offers alms to a young cowherd. Courbet had high hopes for the work, but when it was exhibited at the Salon of 1852, critics attacked it as tasteless and clumsy. They reviled the models’ common features and countrified costumes, the “ridiculous” little dog and cattle, and the overall lack of unity, including traditional perspective and scale.
Metropolitan Museum
Hélas ! ce que Courbet appelait du gracieux devait fournir une mine de plaisanteries aux vaudevillistes. Il s'agissait des Demoiselles de village, cet admirable paysage que la critique ne put comprendre et que diverses expositions postérieures ont montré comme l'expression la plus sincèrement puissante de la nature.
De ce tableau, Courbet aurait pu dire déjà ce qu'il m'écrivait plus tard, accablé de luttes et conservant pourtant sa bonne humeur : « Les gens qui veulent juger auront de l'ouvrage, ils s'en tireront comme ils pourront ; car il y a des gens qui se réveillent la nuit en sursaut et criant : je veux juger, il faut que je juge. »
Raviver la discussion à propos des œuvres de Courbet est inutile.
Les fantaisies de jeunesse de l'artiste, son éducation, la bonne fortune qu'il eut de rencontrer un professeur qui jeta en lui des graines d'indépendance, feront connaître mieux l'homme que des négations ou des affirmations.
II
Surtout les ascendants de l'artiste me préoccupent. Un ami de jeunesse du peintre, Max Buchon2, dans une longue lettre, a dessiné à mon intention de curieux croquis, entre lesquels se détache le profil du vigneron Oudot, grand-père de l'artiste : « Ardent révolutionnaire de 93, sachant par cœur, sans être pourtant lettré ni prétendre à l'être, bon nombre de passages des tragédies de Voltaire, ne doutant jamais de lui, extrêmement affirmatif, brusque et grossier au besoin dans la discussion ; du reste, d'une probité virginale et au fond d'une mansuétude parfaite, avec une réputation de vigneron consommé, voilà l'homme. »

Portrait de Max Buchon, musée, Jenisch, Vevey, CH.
On pourrait dire, voilà le peintre. La meilleure partie des qualités du vieil Oudot a passé dans le sang de Courbet par l'influence maternelle ; l'application que portait le vigneron à la terre, l'artiste l'a montrée pour la peinture.
Des portraits de femmes, la grand-mère et la mère doivent être cités, braves ménagères, travailleuses, économes « ne dînant jamais à table et servant les hommes » ; mais les femmes sont en hérédité les petits poids de l'horloge, elles jouent un rôle discret, de second plan. Leur influence se fait sentir chez l'artiste par l'ordre appliqué au désordre. Les qualités d'économie, de sociabilité sont issues de leur sang. Audaces, aspirations à la gloire, résistance des nerfs dans les luttes artistiques me paraissent appartenir aux ascendants mâles. Du moins l'ai-je remarqué chez divers hommes considérables dont j'ai pu étudier les parents.
« La mère de Courbet, ajoute Max Buchon, est une femme tenace, affirmative, de bon sens, affectueuse, simple et bonne. Le père est beaucoup plus idéaliste, parleur sempiternel, très amoureux de la nature, sobre comme un Arabe, grand, élevé sur jambes, très beau garçon dans sa jeunesse, d'une affectuosité immense, ne sachant jamais l'heure qu'il est, n'usant jamais ses habits, chercheur d'idées et d'améliorations agronomiques, inventeur d'une herse de sa façon et faisant, malgré sa femme et ses filles, de l'agriculture qui ne lui profite guère. »
Un mot est à souligner dans ce croquis, le mot idéaliste, qui peut étonner comme caractéristique d'un cultivateur ; mais on l'emploie à Ornans, même à propos d'une discussion relative à des terrains. Ce pays a produit tant de philosophes, d'idéologues et d'utopistes que des bribes de langue métaphysique ont pénétré jusque chez les paysans.
Si le père de Courbet est un idéaliste, l'artiste l'a été autant que son tempérament le lui permettait. Il peint aujourd'hui de grossières Baigneuses ; il est homme le lendemain à rendre des fiancés qui, séparés, se sont juré de regarder une certaine étoile à une certaine heure.

Qui, parmi les maîtres modernes, a su donner une idée plus poétique des plages désertes, de la mer, du spectacle des nuages, sans surprises ni faux pittoresque. Pas une barque, pas un pêcheur. Rien que le drame des immensités. Les animaux de Courbet, ses forêts, ses rochers, ses fontaines, ne témoignent-ils pas d'un amour désintéressé de la nature !

L'homme des villes, l'artiste le traduira maladroitement, son tempérament de montagnon s'opposant à ce qu'il s'incarne dans l'élégance acquise ; mais quelles robustes sensations sont enfouies dans ses représentations d'épaisses verdures et que de grandeurs dans ses « paysages de mer ! »
Et pourtant voilà un homme qui en Allemagne, pressé de laisser trace de son passage dans un groupe artistique, peindra, une heure avant de monter en chemin de fer, le portrait de sa pipe, avec la signature :
COURBET,
sans idéal et sans religion.

III
Il faut expliquer cette boutade sur laquelle la Bavière a dû discuter un an au moins.
La Franche-Comté donne naissance à nombre d'esprits paradoxaux et logiques, dont le plus curieux spécimen est le sophiste Proudhon.
Sans idéal et sans religion donne la main à la propriété c'est le vol.

Un pistolet est sur la table de l'écrivain et du peintre et fait partie de leurs instruments de travail. Avant de lancer une œuvre, ils tirent un coup de pistolet, qui quelquefois les blesse eux-mêmes.
On pourra trouver une contradiction entre la naiveté dont je parlais à propos des débuts de Courbet, et ces fanfaronnades si particulièrement comtoises.
Du peintre et de son compatriote le sophiste il en fut longtemps de même. Labeur rude et long avant que leur nom ne fût affirmé. Ils se lançaient dans la mêlée avec des œuvres sérieuses ; leurs robustes études étonnaient et froissaient. Les gens de tempérament débile s'effrayaient en face de telles manifestations. De prétendus lions, qui depuis longtemps avaient revêtu une peau de brebis pour secouer l'eau bénite de critiques anodines sur le troupeau des médiocrités, étaient pris de terreurs immenses. Le nouveau les blessait sous leur bât garni de vieilles ouates ; loin de marcher en avant, ils regimbaient contre l'aiguillon d'un art vivace. La foule, qui ne raisonne que quand on lui a mâché un raisonnement, croit à l'équité de ces regimbements. L'art est dans ornière-tradition. — Une commode route que l'ornière, s'écrie la foule.
C'est alors que des coups de fouet et des coups de pistolet semblent nécessaires aux lutteurs impatients qui vont au-delà de la voie qu'ils demandaient à parcourir. Pour avoir pris un élan qui dépasse leurs forces, ils sont en proie à des faiblesses, à des défaillances, trop heureux si elles ne les abattent pas à jamais.
J'ai dit quelles influences héréditaires avaient présidé au tempérament du peintre, il faut noter quelques détails de son éducation au séminaire, en 1831. « Courbet, m'écrit son camarade d'enfance, était alors un absolu modèle d'indiscipline, réfractaire à toutes les routines de l'enseignement officiel. Bègue renforcé (ce défaut a disparu) et cependant très verbeusement raisonneur, pas du tout fort en thème, ennemi acharné de tout favorisé des professeurs, très alerte à la chasse aux papillons et aux jeux de mouvement, il jouissait d'une influence suprême dans toutes les questions de choix de promenades, choix auxquels sa connaissance et son amour des lieux lui faisaient attacher la plus haute importance. »
On vit plus tard le futur peintre courir les bois, les montagnes pendant les vacances et s'ingénier à reproduire des coins pittoresques de paysage.
L'enfant se faisait homme. Il n'avait toutefois rien appris : ni grec, ni latin, ni mathématiques.
« Ses devoirs, ajoute M. Max Buchon, étaient d'un tel comique que le professeur en réservait la lecture pour la fin de la classe, afin de mettre en gaieté sans inconvénient les élèves. »
Et cependant voici qu'une lueur traverse l'esprit du rhétoricien. Courbet jusque-là n'a compris que la nature. Un homme va jeter quelques étincelles dans ce foyer latent.
Dérogeant à la rhétorique officielle, le professeur Oudot établissait son cours sur cette donnée de M. de Bonald, « qu'un homme ne peut comprendre et produire d'art que celui qui interprète sa propre nature, et que l'art, en tant qu'expression du sentiment de la société, doit par conséquent se transformer aussi souvent que la société même. De même que l'on dit : “Le style c'est l'homme”, de même on doit pouvoir dire : “L'art c'est la société” »3.
Courbet but avidement à cette source qui était de nature à désaltérer son esprit. De l'esthétique du professeur Oudot ressortait surtout cette affirmation : L'artiste est l'interprète de sa propre nature. On pense quelle liberté laissaient de tels préceptes à de jeunes affamés d'indépendance.
Tout ce que dit dès lors le professeur de rhétorique, l'élève l'écouta avec recueillement. Le peintre en a conservé plus tard des habitudes de discuter, employant à tort et à travers de grands mots scolastiques ; mais de ces nuages de métaphysique il s'échappe souvent de nettes boutades qui se font jour à travers le brouillard de la pensée.
Je n'en citerai qu'une.
On voulait marier l'artiste. Ses amis souhaitaient que l'homme se rangeât.
— Un homme marié, dit Courbet, est un réactionnaire en art.
Notes
1) ↑— Ces Mémoires étaient écrits avant le Salon des refusés, système que l'administration a eu tort de ne pas pousser à l'extrême. Qu'importe que le public rie avant d'entrer, il faut faire l'éducation du public.
2) ↑— Joseph-Maximilien Buchon, dit Max Buchon, né le 8 mai 1818 à Salins (Jura) où il est mort le 14 décembre 1869, est un poète, romancier et traducteur français. (wkpd)
3) ↑— Je donne ces aperçus métaphysiques tels que me les envoyait M. Max Buchon. Passablement embrouillés et contradictoires, ils devaient répondre d'autant plus à l'esprit singulier du futur chef d'école.

Peut-on enseigner l'art ?
Gustave Courbet, 25 décembre 1861.
Messieurs et chers Confrères,
Vous avez bien voulu ouvrir un atelier de peinture où vous puissiez librement continuer votre éducation d'artistes, et vous avez bien voulu m'offrir de le placer sous ma direction.
Avant toute réponse, il faut que je m'explique avec vous sur ce mot direction. Je ne puis m'exposer à ce qu'il soit question entre nous de professeur et d'élèves.
Je dois vous rappeler ce que j'ai eu récemment l'occasion de dire au congrès d'Anvers : je n'ai pas, je ne puis pas avoir d'élèves.
Moi, qui crois que tout artiste doit être son propre maître, je ne puis pas songer à me constituer professeur.
Je ne puis pas enseigner mon art, ni l'art d'une école quelconque, puisque je nie l'enseignement de l'art, ou que je prétends, en d'autres termes, que l'art est tout individuel, et n'est pour chaque artiste, que le talent résultant de sa propre inspiration et de ses propres études sur la tradition.
J'ajoute que l'art ou le talent, selon moi, ne saurait être, pour un artiste, que le moyen d'appliquer ses facultés personnelles aux idées et aux choses de l'époque dans laquelle il vit.
Spécialement, l'art en peinture ne saurait consister que dans la représentation des objets visibles et tangibles pour l'artiste.
Aucune époque ne saurait être reproduite que par ses propres artistes, je veux dire par les artistes qui ont vécu en elle. Je tiens les artistes d'un siècle pour radicalement incompétents à reproduire les choses d'un siècle précédent ou futur, autrement dit, à peindre le passé ou l'avenir.
C'est en ce sens que je nie l'art historique appliqué au passé. L'art historique est par essence, contemporain. Chaque époque doit avoir ses artistes, qui l'expriment et la reproduisent pour l'avenir. Une époque qui n'a pas su s'exprimer par ses propres artistes, n'a pas droit à être exprimée par des artistes ultérieurs. Ce serait la falsification de l'histoire.
L'histoire d'une époque finit avec cette époque même et avec ceux de ses représentants qui l'ont exprimée. Il n'est pas donné aux temps nouveaux d'ajouter quelque chose à l'expression des temps anciens, d'agrandir ou d'embellir le passé. Ce qui a été a été. L'esprit humain a le devoir de travailler toujours à nouveau, toujours dans le présent, en partant des résultats acquis. Il ne faut jamais rien recommencer, mais marcher toujours de synthèse en synthèse, de conclusion en conclusion.
Les vrais artistes sont ceux qui prennent l'époque juste au point où elle a été amenée par les temps antérieurs. Rétrograder, c'est ne rien faire, c'est agir en pure perte, c'est n'avoir ni compris ni mis à profit l'enseignement du passé. Ainsi s'explique que les écoles archaïques de toutes sortes se réduisent toujours aux plus inutiles compilations.
Je tiens aussi que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes. C'est une langue toute physique, qui se compose, pour mots, de tous les objets visibles, un objet abstrait, non visible, non existant, n'est pas du domaine de la peinture.
L'imagination dans l'art consiste à savoir trouver l'expression la plus complète d'une chose existante, mais jamais à supposer ou à créer cette chose même.
Le beau est dans la nature, et sa rencontre dans la réalité sous les formes les plus diverses. Dès qu'on l'y trouve, il appartient à l'art, ou plutôt à l'artiste qui sait l'y voir. Dès que le beau est réel et visible, il a en lui-même son expression artistique. Mais l'artiste n'a pas le droit d'amplifier cette expression. Il ne peut y toucher qu'en risquant de la dénaturer, et par suite de l'affaiblir. Le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l'artiste.
Le beau, comme la vérité, est une chose relative au temps où l'on vit et à l'individu apte à le concevoir. L'expression du beau est en raison directe de la puissance de perception acquise par l'artiste.
Voilà le fond de mes idées en art. Avec de pareilles idées, concevoir le projet d'ouvrir une école pour y enseigner des principes de convention, ce serait rentrer dans les données incomplètes et banales qui ont jusqu'ici dirigé partout l'art moderne.
Il ne peut pas y avoir d'écoles, il n'y a que des peintres. Les écoles ne servent qu'à rechercher les procédés analytiques de l'art. Aucune école ne saurait conduire isolément à la synthèse. La peinture ne peut, sans tomber dans l'abstraction, laisser dominer un côté partiel de l'art, soit le dessin, soit la couleur, soit la composition, soit tout autre des moyens si multiples dont l'ensemble seul constitue cet art.
Je ne puis donc pas avoir la prétention d'ouvrir une école, de former des élèves, d'enseigner telle ou telle tradition partielle de l'art. Je ne puis qu'expliquer à des artistes, qui seraient mes collaborateurs et non mes élèves, la méthode par laquelle, selon moi, on devient peintre, par laquelle j'ai tâché moi-même de le devenir dès mon début, en laissant à chacun l'entière direction de son individualité, la pleine liberté de son expression propre dans l'application de cette méthode. Pour ce but, la formation d'un atelier commun, rappelant les collaborations si fécondes des ateliers de la Renaissance, peut certainement être utile et contribuer à ouvrir la phase de la peinture moderne, et je me prêterai avec empressement à tout ce que vous désirerez de moi pour l'atteindre.
Tout à vous de cœur,
Gustave Courbet
Gustave Courbet
Abbé Paul Brune, Dictionnaire des Artistes et Ouvriers d'Art de la Franche-Comté, 1912.
Né à Ornans (Doubs), le 10 juin 1819 ; mort à La Tour-de-Peilz (Suisse), le 31 décembre 1877. Fils de Régis Courbet et de Silvie Oudot. Premier-né d'un agriculteur aisé qui le destinait à l'Ecole polytechnique, Courbet manifesta de bonne heure ses goûts artistiques. En 1831, au petit Séminaire d'Ornans, cette vocation fut encouragée par le peintre Beau, professeur de dessin. Après avoir dessiné des fleurs, des paysages et des têtes, Courbet s'essaya au portrait à l'huile et peignit, entre autres, le portrait de son condisciple Bastide en 1834. Placé au collège royal de Besançon, en 1837, Courbet continua à dessiner. L'année suivante il se lia avec les peintres Arthaud, Baille et Jourdain qui l'introduisirent au cours de Flajoulot, leur maître. Sous sa direction, Courbet compléta ses études de dessin et peignit d'après le modèle vivant. Il fit de la lithographie, illustra les Essais poétiques de Max Buchon et commença une série de paysages peints à Ornans ou dans ses environs. En 1842 il vint à Paris et se fit inscrire à l'atelier du baron de Steuben et d'Auguste Hesse, mais ne fréquenta que l'atelier de Suisse et le Louvre. À côté de pastiches de maîtres italiens, espagnols, flamands ou hollandais des XVIe et XVIIe siècle, de copies de Delacroix, Géricault ou autres maîtres de l'art moderne, Courbet exécuta divers portraits : Zélie Courbet, 1842, et Juliette Courbet, 1844, ses soeurs, le Courbet désespéré , 1841 et le Courbet avec un chien noir, 1842, admis au Salon de 1844. À partir de ce Salon,l'existence de l'artiste fut d'une prodigieuse activité qui inquiéta les rivaux de Courbet autant que l'originalité de son talent. En 1844-1845, il peignit les Amants dans la campagne (musée de Lyon), œuvre type de sa première manière, avec l'Homme blessé, 1844 (musée du Louvre). Le 15 avril 1847, il fit partie du groupe d'artistes qui fonda un Salon indépendant. Lié avec Champfleury et Proudhon, Courbet justifia leurs théories sur le réalisme et l'humanitarisme en des toiles célébres dont il emprunta les sujets à son pays natal : l'Après-diner à Ornans, l'Enterrement à Ornans, les Paysans de Flagey revenant de la foire
, 1841 et le Courbet avec un chien noir, 1842, admis au Salon de 1844. À partir de ce Salon,l'existence de l'artiste fut d'une prodigieuse activité qui inquiéta les rivaux de Courbet autant que l'originalité de son talent. En 1844-1845, il peignit les Amants dans la campagne (musée de Lyon), œuvre type de sa première manière, avec l'Homme blessé, 1844 (musée du Louvre). Le 15 avril 1847, il fit partie du groupe d'artistes qui fonda un Salon indépendant. Lié avec Champfleury et Proudhon, Courbet justifia leurs théories sur le réalisme et l'humanitarisme en des toiles célébres dont il emprunta les sujets à son pays natal : l'Après-diner à Ornans, l'Enterrement à Ornans, les Paysans de Flagey revenant de la foire , etc. Une sorte d'exaltation s'empara bientôt de l'auteur de ces chefs-d'œuvre. Dégoûté des expositions officielles. il organisa des exhibitions de ses peintures à Ornans. â Besançon et à Dijon. En 1853, ses Baigneuses firent scandale au Salon. L'Exposition Universelle de 1855 suggéra à Courbet la nouvelle exhibition de peintures qu'il fit dans une salle construite à ses frais, par l'architecte Isabey, sur l'avenue Montaigne, avec l'enseigne suivante : Le Réalisme. — G. Courbet. Exhibition de 40 tableaux de son œuvre. — Prix d'entrée : 1 franc. L'artiste y montra ses Cribleuses de blé, sa Rencontre
, etc. Une sorte d'exaltation s'empara bientôt de l'auteur de ces chefs-d'œuvre. Dégoûté des expositions officielles. il organisa des exhibitions de ses peintures à Ornans. â Besançon et à Dijon. En 1853, ses Baigneuses firent scandale au Salon. L'Exposition Universelle de 1855 suggéra à Courbet la nouvelle exhibition de peintures qu'il fit dans une salle construite à ses frais, par l'architecte Isabey, sur l'avenue Montaigne, avec l'enseigne suivante : Le Réalisme. — G. Courbet. Exhibition de 40 tableaux de son œuvre. — Prix d'entrée : 1 franc. L'artiste y montra ses Cribleuses de blé, sa Rencontre et surtout son Atelier
et surtout son Atelier , synthèse des goûts de Courbet. Le peintre assagit alors sa manière. On retrouve le charme du modèle de l'Atelier dans les Demoiselles du bord de la Seine
, synthèse des goûts de Courbet. Le peintre assagit alors sa manière. On retrouve le charme du modèle de l'Atelier dans les Demoiselles du bord de la Seine , 1857, la Vénus et Psyché, 1863, la Femme au perroquet
, 1857, la Vénus et Psyché, 1863, la Femme au perroquet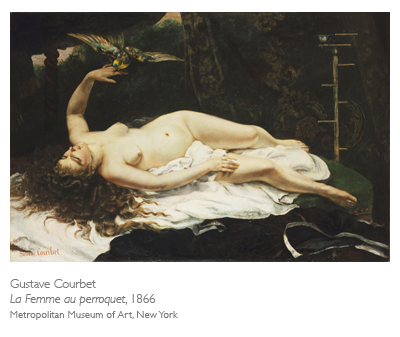 , 1866, etc. En 1861-1862, il ouvrit un atelier dont l'enseignement était basé sur la liberté d'expression de la nature dans l'art et l'inutilité de la peinture académique. Cet atelier, situé rue Notre-Dame-des-Champs, réunit une quarantaine d'élèves parmi lesquels le peintre Fantin-Latour. Les modèles étaient des animaux, des végétaux, etc. Eu 1864 Courbet organisa une dernière exposition particulière de ses œuvres. L'année suivante, il refusa la Légion d'honneur.
, 1866, etc. En 1861-1862, il ouvrit un atelier dont l'enseignement était basé sur la liberté d'expression de la nature dans l'art et l'inutilité de la peinture académique. Cet atelier, situé rue Notre-Dame-des-Champs, réunit une quarantaine d'élèves parmi lesquels le peintre Fantin-Latour. Les modèles étaient des animaux, des végétaux, etc. Eu 1864 Courbet organisa une dernière exposition particulière de ses œuvres. L'année suivante, il refusa la Légion d'honneur.
Au moment de la commune de 1871, Courbet devint président de la commission des musées nationaux qu'il contribua à protéger et émit le vœu du déboulonnement de la colonne Vendôme. Prisonnier lors de la reprise de Paris, il fut condamné à six mois de prison et 500 fr. d'amende. La responsabilité dans le déboulonnement de la colonne lui valut une saisie-arrêt sur ses biens en 1873 ; il se réfugia à Genève, puis la la Tour-de-Peilz. Les poursuites continuèrent et se terminèrent par une condamnation définitive à une somme de 323 000 frs, prix de la restauration du monument. Tous ces revers, unis à un exil qui lui pesait, contribuèrent à abréger la vie de Courbet.
Gustave Courbet
Gustave Courbet est issu d’une famille aisée de propriétaires terriens, son père Régis Courbet possède une ferme et des terres au village de Flagey où il élève des bovins et pratique l’agriculture. Gustave naît le 10 juin 1819 à Ornans dans le Doubs, sa mère Sylvie Oudot donne par ailleurs naissance à quatre filles. À l'âge de douze ans, Gustave l'aîné entre au petit séminaire d’Ornans où il reçoit un premier enseignement artistique avec un professeur de dessin, disciple de la peinture préromantique d'Antoine-Jean Gros. Ensuite, il entre au Collège Royal de Besançon où, dans la classe des beaux-arts, il suit des cours de dessin dans la classe de Charles-Antoine Flajoulot (1774-1840), un ancien élève de Jacques-Louis David. À cette époque, Charles-Antoine Flajoulot était également le directeur de l'École des Beaux-Arts de Besançon. Après des études considérées comme médiocres et qu’il abandonne, il part pour Paris vers la fin de 1839. Logé par son cousin Jules Oudot, il suit des études de droit et parallèlement fréquente l’atelier du peintre Charles de Steuben. Son ami d’enfance Adolphe Marlet l’introduit à l’atelier de Nicolas-Auguste Hesse un peintre d’histoire qui l’encourage dans la voie artistique. Courbet se rend aussi au musée du Louvre pour y étudier les maîtres, en particulier les peintres de l’école espagnole du xviie siècle Diego Vélasquez, Francisco de Zurbarán et José de Ribera. Il est admiratif du clair-obscur hollandais, de la sensualité vénitienne et du réalisme espagnol. Courbet est un œil, il a un sens unique de l'alchimie visuelle. Il est aussi influencé par les œuvres de Géricault dont il copie une tête de cheval.
Le 21 juin 1840, Gustave Courbet est réformé du service militaire. Il s’installe au Quartier latin et occupe son premier atelier rue de la Harpe. Il fréquente l'Académie de Charles Suisse, à l'angle du boulevard du Palais et du quai des Orfèvres, mais abandonne rapidement, jugeant les œuvres copiés, sans intérêt. Il décide alors de se former lui-même en dessinant et copiant des maîtres du passé tel que Diego Vélasquez ou bien Rembrandt. En 1842, il peint un premier autoportrait dit Autoportrait au chien noir (œuvre exposée au Salon de 1844), le chien étant un épagneul qu'il a acquis la même année. D'autres autoportraits suivent, où il se représente en homme blessé ou en homme à la pipe. En 1845, il propose plusieurs toiles pour le Salon, le jury choisit de faire exposer le Guitarrero. Il a une relation avec Virginie Binet dont il a un enfant qu'il ne reconnaît pas. À cette époque il fréquente la brasserie Andler, 28 rue Hautefeuille, où s'élaboraient les grandes théories et que Champfleury appelait le temple du réalisme. Il y rencontre la bohème parisienne. Courbet est au cœur de l’effervescence artistique et politique. Il se lie avec des artistes qui veulent proposer une alternative à l’antagonisme romantisme-académique (tels que Charles Baudelaire, Hector Berlioz… dont il a fait les portraits). Sous l’impulsion de Champfleury, Courbet jette les bases de son propre style, le réalisme. Il veut s’inspirer des idéaux de la bohème. Champfleury rédige pour le peintre la liste de ses œuvres pour le Salon de 1849. En août 1849, il fait un voyage en Hollande où il découvre les peintures de Frans Hals et Rembrandt.
En 1849, Courbet revient à Ornans où son père Régis lui a aménagé un atelier de fortune dans le grenier de la maison familiale de ses grands-parents (Bien qu'exigu et de modestes dimensions, il y composera pourtant certaines de ses œuvres les plus monumentales). Ce retour aux sources, dans son “pays” natal, va changer sa manière de peindre : il abandonne le style romantique de ses premiers autoportraits et de sa Nuit de Walpurgis. Inspiré par son terroir, il crée un style qu’il qualifie lui-même de réalisme. Sa première œuvre de cette période est Une après-dinée à Ornans tableau exposé au salon de 1849 qui lui vaut une médaille de seconde classe, et qui est remarqué par Ingres et Delacroix. Cette médaille le dispense de l’approbation du jury. Il va s’en servir pour ébranler les codes académiques. Ses paysages, dominés par l’identité de retrait et de solitude, ont une signification quasi autobiographique.
En 1850, il peint Les Paysans de Flagey revenant de la foire, exposé au musée de Besançon. L'œuvre fera scandale.
Un enterrement à Ornans (1850), Paris, musée d'Orsay.
Il peint Un enterrement à Ornans, tableau ambitieux dont le grand format (315 x 668 cm) est habituellement destiné aux tableaux d’histoire, qui représente un enterrement où figurent plusieurs notables d'Ornans et les membres de sa famille. Au salon de 1850-1851 lors de son exposition le tableau fait scandale auprès de la critique de même que ses Casseurs de pierres salué comme la première œuvre socialiste par Proudhon.
En 1852, il décide de se mettre à de grandes compositions de nus en vue de son prochain salon. Après avoir réformé le paysage, les scènes de genre, le portrait, il “s’attaque” là à l'un des derniers bastions de l'académisme esthétique du temps. Les Baigneuses de 1853 a créé beaucoup de controverse, on voit deux femmes, dont une nue avec un linge qui la drape à peine alors qu'elle ne représente plus une figure mythologique idéalisée. La critique de l'époque s'empare de cette toile de façon très virulente : Courbet a réussi à obtenir ainsi un succès de scandale. Les portraits féminins de Courbet ont une trace de sensualité (Jo, La belle Irlandaise maîtresse de Courbet, La Belle Espagnole de 1855, La Mère Grégoire... Tous ces tableaux sont chargés d’exotisme qui célèbre le charme féminin). La Source est l’un des derniers nus de Courbet, fait en 1868.
est l’un des derniers nus de Courbet, fait en 1868.

L’Origine du monde de 1866 a un drapé académique, classique et néo-classique. En 1853, Courbet fait la rencontre déterminante d’Alfred Bruyas (1821-1876), un collectionneur montpelliérain qui lui achète Les Baigneuses et La Fileuse. En 1854, Courbet saisit l’âpre beauté des paysages du Languedoc. En 1855, avec une série d’ambitieux tableaux, Courbet se montre sensible aux traditions (portraits, nature morte) mais aussi aux avancées des jeunes générations (Manet en tête). Il expérimente une carrière de portraitiste mondain, et apprend à s’adapter à la psychologie comme aux exigences de ses modèles, mais Courbet reste maître et inventeur de ses peintures. La série des natures mortes est réalisée en 1862, lorsqu’il séjourne en Saintonge à l’invitation du mécène éclairé Étienne Baudry. Courbet comprend l’importance de ce thème, qui ouvre la voie aux compositions impressionnistes. En 1859, il découvre les côtes normandes : paysages puissants et tourmentés. Le 6 mars 1860, il achète à Ornans l’ancienne fonderie Bastide, bâtiment dans lequel il aménage sa maison et un grand atelier, restant dans ce lieu jusqu'à son exil en 1873 en Suisse. En 1862-1863, il séjourne à Saintes et participe, avec Jean-Baptiste Corot, Louis-Augustin Auguin et Hippolyte Pradelles à un atelier de plein air baptisé « groupe du Port-Berteau » d'après le nom du site des bords de la Charente (dans la commune de Bussac-sur-Charente) adopté pour leurs séances communes de peinture. Une exposition collective réunissant 170 œuvres est présentée au public le 15 janvier 1863 à l’Hôtel de Ville de Saintes. Il peint à Saintes Le retour de la conférence qui fera scandale et sera refusé au Salon.
Ses idées républicaines et socialistes lui font refuser la Légion d'honneur, proposée par Napoléon III, dans une lettre adressée le 23 juin 1870, au ministre des lettres, sciences et beaux-arts, Maurice Richard. Après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il est nommé président de la commission des musées et délégué aux Beaux-Arts ainsi que président de l'éphémère Fédération des Artistes. Ami de Proudhon et proche de la Fédération jurassienne de Bakounine, il prend une part active à la Commune de Paris14. Aux élections complémentaires du 16 avril 1871, il est élu au Conseil de la Commune par le VIe arrondissement et délégué aux Beaux-Arts14. Le 17 avril 1871, il est élu président de la Fédération des artistes. Il fait alors blinder toutes les fenêtres du Louvre pour en protéger les œuvres d’art, mais aussi l’Arc de triomphe et la Fontaine des Innocents. Il prend des mesures semblables à la manufacture des Gobelins, à celle de Sèvres et fait même protéger la collection de Thiers14. Il siège à la commission de l'enseignement et, avec Jules Vallès, vote contre la création du Comité de Salut public, il signe le manifeste de la minorité. Il propose au Gouvernement de la Défense nationale le déplacement de la Colonne Vendôme, qui évoque les guerres napoléoniennes, aux Invalides. La Commune décide, le 13 avril 1871, d’abattre et non de déboulonner la colonne Vendôme. Courbet en réclame l'exécution, ce qui le désignera ensuite comme responsable de sa destruction. Celle-ci avait été prévue pour le 5 mai 1871, jour anniversaire de la mort de Napoléon, mais la situation militaire avait empêché de tenir ce délai. Plusieurs fois repoussée, la cérémonie aura lieu le 16 mai 1871, la colonne est abattue, non sans difficultés, à 17 h 30, sous les acclamations des parisiens. Courbet démissionne de ses fonctions en mai 1871, protestant contre l'exécution par les Communards de Gustave Chaudey, qui, en tant que maire-adjoint, avait fait tirer sur la foule le 22 janvier 1871. Après la Semaine sanglante il est arrêté le 7 juin 1871 et le 3e conseil de guerre le condamne à six mois de prison — qu'il purgera à Versailles, à Sainte-Pélagie — et à 500 francs d'amende, auxquels s'ajoutent 6 850 francs de frais de procédure. puis, Comme il est malade, il est transféré le 30 décembre 1871 dans une clinique de Neuilly où il reste jusqu'en avril 1872. Son engagement dans la Commune lui valut de la part de nombreux écrivains une hargne d'une violence inouïe ; ainsi, Alexandre Dumas fils osa écrire à son propos : « De quel accouplement fabuleux d'une limace et d'un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée cette chose qu'on appelle Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l'aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d'œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant ». Mais en mai 1873, le nouveau président de la République, le maréchal de Mac-Mahon, décide de faire reconstruire la colonne Vendôme aux frais de Courbet (soit 323 091,68 francs selon le devis établi). La loi sur le rétablissement de la colonne Vendôme aux frais de Courbet est votée le 30 mai 187318. Il est acculé à la ruine après la chute de la Commune, ses biens mis sous séquestre, ses toiles confisquées. Il s'exile en Suisse, à La Tour-de-Peilz, près de Vevey. Il participe le 1er août 1875, à un congrès de la Fédération Jurassienne à Vevey. Courbet doit payer près de 10 000 francs par an pendant 33 ans, mais il mourra d'une maladie de foie, la veille de recevoir la première traite à payer, maladie que son intempérance avait aggravée. « Je me suis constamment occupé de la question sociale et des philosophies qui s'y rattachent, marchant dans ma voie parallèlement à mon camarade Proudhon. […] J'ai lutté contre toutes les formes de gouvernement autoritaire et de droit divin, voulant que l'homme se gouverne lui-même selon ses besoins, à son profit direct et suivant sa conception propre »
Après quelques semaines passées dans le Jura (Le Locle, La Chaux-de-Fonds), à Neuchâtel, à Genève et dans le canton du Valais, Courbet se rend compte que c'est sur la Riviera lémanique, grâce aux nombreux étrangers qui y séjournent, qu'il aura le plus de chance de nouer des contacts et de trouver d'éventuels débouchés pour sa peinture. Il loge brièvement à Veytaux (château de Chillon), puis jette son dévolu sur la petite bourgade de La Tour-de-Peilz (au bord du lac Léman) et s'installe à la Pension Bellevue (tenue par le pasteur Dulon), en compagnie de Cherubino Pata, puis, dès le printemps 1875, dans une maison au bord du lac, du nom de Bon-Port, qui devient le port d'attache des dernières années de sa vie. De là, il circule beaucoup, et les rapports que des espions (infiltrés jusque parmi la colonie des proscrits de la Commune de Paris) envoient à la police française nous renseignent sur ses nombreux contacts et ses innombrables déplacements (Genève, Fribourg, la Gruyère, Interlaken, Martigny, Loèche-les-Bains, La Chaux-de-Fonds, etc.). Durant les premières années de son exil, il écrit à sa sœur en 1876 : « Ma chère Juliette, je me porte parfaitement bien, jamais de ma vie je ne me suis porté ainsi, malgré le fait que les journaux réactionnaires disent que je suis assisté de cinq médecins, que je suis hydropique, que je reviens à la religion, que je fais mon testament, etc. Tout cela sont les derniers vestiges du napoléonisme, c'est le Figaro et les journaux cléricaux. » Il peint, sculpte, expose et vend ses œuvres ; il organise sa défense face aux attaques du gouvernement de l'« Ordre moral » et veut obtenir justice auprès des députés français ; il participe à de nombreuses manifestations (fêtes de gymnastique, de tir et de chant) ; il est accueilli dans de nombreux cercles démocratiques confédérés et dans les réunions de proscrits. Comme par le passé, il organise sa propre publicité et entretient des rapports sociaux tant dans les cafés qu'avec les représentants de l'establishment du pays qui l'accueille. Il reçoit des encouragements de l'étranger : en 1873, invité par l'association des artistes autrichiens, il expose 34 tableaux à Vienne en marge de l'Exposition universelle ; le peintre James Whistler le contacte pour exposer des œuvres à Londres ; aux États-Unis, il a sa clientèle et il expose régulièrement à Boston depuis 1866. Plusieurs peintres du pays lui rendent visite à La Tour (Auguste Baud-Bovy, Francis Furet, François Bocion) ou présentent leurs tableaux dans les mêmes expositions (Ferdinand Hodler). Des marchands, comme l'ingénieur exilé Paul Pia à Genève, proposent régulièrement à la vente des œuvres du peintre franc-comtois. La demande de tableaux était tellement importante depuis 1872 que Courbet ne pouvait suivre et s'était assuré la collaboration d'« aides » qui préparaient ses paysages. Courbet ne faisait aucun mystère de ce mode de production. On sait, en outre, que Courbet n'hésitait pas à signer de temps à autre un tableau peint par l'un ou l'autre de ses collaborateurs. Il travaille simultanément pour madame Arnaud de l'Ariège dans son château des Crètes à Clarens et donne des tableaux pour des tombolas de sinistrés et d'exilés. Il réfléchit à un projet de drapeau pour le syndicat des typographes à Genève, et exécute le portrait d'un avocat lausannois, le député radical Louis Ruchonnet (futur conseiller fédéral) ; il converse avec Henri Rochefort et Madame Charles Hugo à La Tour-de-Peilz et, quelques jours après, il joue le rôle de porte-drapeau d'une société locale lors d'une fête de gymnastique à Zurich. Son œuvre n'échappe pas non plus à ce continuel va-et-vient entre une trivialité proche du kitsch et un réalisme poétique. Cette production inégale n'est pas limitée à la période d'exil, mais elle s'accentue depuis la menace qui pèse sur le peintre de devoir payer les frais exorbitants de reconstruction de la Colonne (condamnation effective par le jugement du 26 juin 1874 du tribunal civil de la Seine), l'entraînant à produire de plus en plus. Cela a incité de nombreux faussaires à profiter de la situation et, déjà du vivant de l'artiste, le marché de l'art a été envahi d'œuvres attribuées à Courbet, dont il est difficile d'apprécier l'originalité.
Les circonstances (guerre et exil), les procès, l'étroitesse de l'espace culturel du pays qui accueille le peintre, l'éloignement de Paris sont autant de facteurs qui ne l'incitent guère à réaliser des œuvres de l'importance de celles des années 1850. Dans ce contexte défavorable, Courbet a la force de peindre des portraits de grande qualité (Régis Courbet père de l'artiste, Paris, Petit Palais), des paysages largement peints (Léman au coucher du soleil du musée Jenisch à Vevey et du musée des beaux-arts à Saint-Gall), quelques Château de Chillon (comme celui du musée Gustave-Courbet à Ornans). Fêtard porté sur l'alcool et les femmes, ses excès ont des répercussions sur son état de santé qui se dégrade durant la dernière période de sa vie : il continue de grossir — ses ennemis le comparent volontiers à une barrique — et est très diminué par une incurable hydropisie stomacale et abdominale. Il s'attaque en 1877, en prévision de l'Exposition universelle de l'année suivante, à un Grand panorama des Alpes (The Cleveland Museum of Art) resté partiellement inachevé. Il aborde également la sculpture, les deux réalisations de ces années d'exil sont, la Dame à la mouette et Helvétia. Par solidarité avec ses compatriotes exilés de la Commune de Paris, Courbet refusa toujours de retourner en France avant une amnistie générale. Sa volonté fut respectée, et son corps fut inhumé à La Tour-de-Peilz le 3 janvier 1878, après sa mort survenue le 31 décembre 1877. Sa dépouille a été transférée à Ornans en 1919. Dans Le Réveil du 6 janvier 1878, Jules Vallès rend hommage au peintre et à « l'homme de paix » : « […] Il a eu la vie plus belle que ceux qui sentent, dès la jeunesse et jusqu'à la mort, l'odeur des ministères, le moisi des commandes. Il a traversé les grands courants, il a plongé dans l'océan des foules, il a entendu battre comme des coups de canon le cœur d'un peuple, et il a fini en pleine nature, au milieu des arbres, en respirant les parfums qui avaient enivré sa jeunesse, sous un ciel que n'a pas terni la vapeur des grands massacres, mais, qui, ce soir peut-être, embrasé par le soleil couchant, s'étendra sur la maison du mort, comme un grand drapeau rouge. »
En 2013, un dossier plaidant pour le transfert de la dépouille de Gustave Courbet (conservée dans le cimetière d’Ornans depuis 1919) vers le Panthéon est déposé par le psychiatre Yves Sarfati auprès du président des Centre des monuments nationaux Philippe Bélaval. La proposition d’hommage posthume à l’artiste apparaît lors du colloque Transferts de Courbet à Besançon en 2011 (publication aux Presses du réel en 2013). Il est appuyé par une tribune dans le Quotidien de l’art du 25 septembre 2013 (numéro 250), où il est affirmé que « la République a une dette envers sa mémoire » ; puis par une tribune dans la rubrique « idées » du Monde.fr où il est dit qu’ « en honorant Courbet, c'est l'engagement républicain et la justice, que l'on honorerait », qu’ « en honorant Courbet, c'est le monde d'aujourd'hui et celui des Beaux-arts, que l'on honorerait » et qu’ « en honorant Courbet, c'est la Femme, avec un grand F, que l'on honorerait. » Parmi les membres du comité de soutien à la panthéonisation de l’artiste, on trouve : Nicolas Bourriaud, Annie Cohen-Solal, Georges Didi-Huberman, Xavier Douroux, Romain Goupil, Catherine Millet, Orlan, Alberto Sorbelli.
Rares sont les artistes qui ont, davantage que Courbet, construit leur carrière grâce à la stratégie du scandale. Plusieurs événements jalonnent clairement cette construction : le Salon de 1850-1851, l'exposition de La Baigneuse au Salon de 1853 — qui suscite un emportement critique sans précédent dans la plupart des périodiques de l'époque — l’érection du Pavillon du réalisme en 1855, l’élaboration de l’œuvre Le Retour de la conférence en 1863, et l’engagement en 1871 dans la Commune de Paris. Plusieurs travaux ont analysé le phénomène du scandale et ses réceptions : une provocation calculée où la toile est prise aux rets des discours et conflits du temps. Les critiques du temps ont interprété les œuvres du peintre de manière parfaitement antinomique, nourrissant l’image d’un peintre insoumis et frondeur. Ainsi, tandis que les détracteurs (Edmond About, Charles Baudelaire, Cham, Théophile Gautier, Gustave Planche…) stigmatisent une peinture réaliste , ses défenseurs (Alfred Bruyas, Pierre-Joseph Proudhon, Émile Zola) considèrent qu’elle est capable de véhiculer esprit d’indépendance, liberté et progrès. Certains historiens poussent la réflexion jusqu’à imaginer que cet espace de débat serait un espace démocratique, dans le sens où l’entend le philosophe Claude Lefort, dans la mesure où il institue un conflit d’opinions autour de sa peinture.
Si Courbet a fait couler beaucoup d’encre en son temps, il a ensuite continué à susciter un intérêt critique : on doit à Louis Aragon un bel ouvrage, L'Exemple de Courbet (1952) qui proposait en plus de ses analyses, un premier catalogage des dessins du peintre. La rétrospective organisée en 2007-2008 au Grand Palais, et relayée par un colloque au musée d'Orsay, a rendu plus sensible la diversité de la production du peintre, mêlant les toiles destinées — en leur temps — à une réception publique et les toiles réservées aux intérieurs des collectionneurs. On doit à la critique anglo-saxone l'ouvrage décisif de Timothy Clark : Une image du peuple. Gustave Courbet et la révolution de 1848 (1973), ainsi que Le Réalisme de Courbet (1997) de Michael Fried. En France, on peut citer parmi les études récentes : l'essai de Dominique Massonnaud, Courbet Scandale, Mythes de la rupture et Modernité (2003) et, surtout, la grande monographie de Ségolène Le Men, Gustave Courbet (2007).
Gustave Courbet enduisait sa toile d’un fond sombre, presque noir, à partir duquel il remontait vers la clarté, détails de personnages et de paysages, par superposition de touches de couleurs plus claires. Cette technique empruntée à l'école de peinture flamande est, peut-être, en train de condamner les œuvres de Courbet. En effet, ce goudron tend, avec le temps, à remonter à travers la peinture et à assombrir dangereusement la surface de ses tableaux. Courbet a parfois recours à la photographie, en particulier dans la représentation du nu féminin : comme Eugène Delacroix avant lui, il utilise des clichés à la place des traditionnelles séances de pose assurées par des modèles vivants. Ainsi, la figure centrale des Baigneuses (1853) s'inspire d'un cliché du photographe Julien Vallou de Villeneuve. Quant à la toile destinée à une réception privée, L'Origine du monde, son cadrage serré évoque les stéréophotographies pornographiques d'Auguste Belloc.
Principales œuvres de Gustave Courbet :
- L'Enfant et la Vierge, musée d'Oran
- Portrait de Régis Courbet, vers 1840, huile sur toile, 73 × 59,5 cm, collection particulière
- L'Embouchure de la Seine, 1841, palais des beaux-arts de Lille
- Autoportrait au chien noir, 1842, huile sur toile, 27 × 23 cm, musée de Pontarlier
- Portrait de Paul Ansout, 1842-1843, huile sur toile, 81 × 62,5 cm, château-musée de Dieppe
- Autoportrait dit Le Désespéré (1843-1845), collection particulière.
- Portrait de l'artiste dit Le Désespéré, 1843-1845, huile sur toile, 45 × 54 cm, collection particulière
- Courbet au chien noir, 1842-1844, huile sur toile, 46 × 56 cm, Petit Palais, Paris
- Les Amants heureux, 1844, huile sur toile, 77 × 60 cm, musée des beaux-arts de Lyon
- Le Coup des dames, 1844, huile sur toile, 25 × 34 cm, coll. Adolfo Hauser, Caracas
- Loth et ses filles, 1844, huile sur toile, 89 × 116 cm, collection particulière
- Le Hamac, 1844, huile sur toile, 71 × 97 cm, coll. Oskar Reinhart, Winterthur
- Portrait de Juliette Courbet, 1844, huile sur toile, 72 × 62 cm, Petit Palais, Paris
- Jeune homme dans un paysage dit Le Guitarrero, 1844, huile sur toile, 55 × 41 cm, collection particulière
- La Bacchante, entre 1844 et 1847, huile sur toile, Fondation Rau, Cologne
- Jeune fille à la balançoire ou Sara la Baigneuse, 1845, huile sur bois, 69 × 52 cm, musée des beaux-arts de Nantes
- Le Sculpteur, 1845, huile sur toile, 55 × 41 cm, collection particulière
- Portrait de l'artiste dit L'Homme à la ceinture de cuir, 1845-1846, huile sur toile, 100 × 82 cm, musée d'Orsay, Paris
- Portrait de H. J. Van Wisselingh, 1846, huile sur toile, 57,2 × 46 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas
- Portrait d'Urbain Cuenot, 1846, huile sur toile, 55,5 × 46,5 cm, musée Courbet, Ornans
- Sentier enneigé en forêt, huile sur toile, musée des beaux-arts et d'archéologie de Châlons-en-Champagne
- Portrait de Charles Baudelaire, vers 1848, huile sur toile, 54 × 65 cm, musée Fabre, Montpellier
- L'Homme à la pipe (autoportrait), 1848-1849, huile sur toile, 45 × 37 cm, musée Fabre, Montpellier
- Les Casseurs de pierres, 1849, 159 × 259 cm. Détruit pendant les bombardements alliés sur la ville de Dresde en février 1945 (le tableau se trouvait à la Gemäldegalerie).
- Le Casseur de pierres, 1849, 45 × 54,5 cm, version avec un seul personnage (le vieux), collection particulière, Milan
- L'après-dînée à Ornans 1848-49, huile sur toile, 195 × 257 cm, palais des beaux-arts de Lille
- Un enterrement à Ornans, 1850, musée d'Orsay, Paris, à son sujet, le critique parisien Champfleury avait écrit « C'est toute la laideur de la province »
- Lutteurs (1853), musée des beaux-arts de Budapest.
- Portrait d'Hector Berlioz, 1850, huile sur toile, 61 × 48 cm, musée d'Orsay, Paris
- Les Demoiselles de village, 1851, huile sur toile, 195 × 261 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York
- Portrait d'Adolphe Marlet, 1851, huile sur toile, 56 × 46 cm, National Gallery of Ireland Collection, Dublin
- Les Baigneuses, 1853, huile sur toile, 227 × 193 cm, musée Fabre, Montpellier
- La Fileuse endormie, 1853, huile sur toile, musée Fabre, Montpellier
- Portrait d'Alfred Bruyas dit Tableau solution, 1853, huile sur toile, 91 × 72 cm, musée Fabre, Montpellier
- Lutteurs, 1853, musée des beaux-arts de Budapest
- L'Homme blessé, 1854, huile sur toile, musée d'Orsay, Paris
- Autoportrait dit au col rayé, 1854, huile sur toile, 46 × 37 cm, musée Fabre, Montpellier
- La Rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet, 1854, huile sur toile, 129 × 149 cm, musée Fabre, Montpellier
- Les Bords de la mer à Palavas, 1854, musée d'art moderne André Malraux - MuMa, Le Havre
- Le Bord de la mer à Palavas, 1854, huile sur toile, 27 × 46 cm, musée Fabre, Montpellier
- Les Cribleuses de blé, 1854, musée des beaux-arts de Nantes
- La Mère Grégoire, 1855-1859, 129 × 97,5 cm, huile sur toile Institut d'art de Chicago
- L'Atelier du peintre, 1855, musée d'Orsay, Paris
-Les Demoiselles des bords de la Seine, 1856, huile sur toile, 174 × 206 cm, Petit Palais, Paris
- Demoiselle des bords de Seine, 1856, huile sur toile, collection privée
- Falaise et vagues par temps d'orage, musée national des beaux-arts d'Alger, Alger
- La Curée, 1856, huile sur toile, 210,2 × 183,5, musée des beaux-arts de Boston
- La Bretonnerie dans le département de l'Indre, 1856, huile sur toile, 60.8 × 73,3 cm, National Gallery of Art, Washington
- Portrait de M. Gueymard, artiste de l'Opéra, dans le rôle de Robert le Diable, 1857, huile sur toile, 148,6 × 406,7 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York
- L'Atelier du peintre (1855), Paris, musée d'Orsay.
- Le Pont d'Ambrussum, 1857, huile sur papier marouflé sur bois, 48 × 63 cm, musée Fabre, Montpellier
- La Mer à Palavas, 1858, musée Fabre, Montpellier
- La Dame de Francfort, 1858, huile sur toile, 104 × 104 cm, Wallraf-Richartz Museum, Cologne
- Vue de Francfort-sur-le-main, 1858, huile sur toile, 53,5 × 78 cm, Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main
- Le Chasseur allemand, 1858, huile sur toile, musée des beaux-arts, Lons-le-Saunier
- Le Renard pris au piège, vers 1860, huile sur toile, musée Courbet, Ornans
- Le Rut du printemps, combat de cerfs, 1861, huile sur toile, 355 × 705 cm, musée d'Orsay, Paris
- Portrait de Jules Vallès, écrivain, journaliste et homme politique, 1861, huile sur toile, musée Carnavalet, Paris
- Le Retour de la Conférence, 1863, détruit
- La Source de la Loue, 1863, huile sur toile, 84 × 106,5 cm, Kunsthaus Zürich
- Portrait de Laure Borreau, 1863, huile sur toile, 81 × 59 cm, Cleveland Museum of Art
- Le Chêne de Flagey, 1864, 89 × 110 cm, musée Courbet, Ornans
- Les Sources de la Loue, 1864, 80 × 100 cm, musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles
- Proudhon et ses enfants, 1865, Petit Palais, Paris
- Marine, 1865, huile sur toile, 53,5 × 64 cm, Wallraf-Richartz Museum, Cologne
- Le Château de Thoraise, 1865, huile sur toile, 66 × 86,4 cm, collection privée.
- Les Trois Anglaises à la fenêtre, 1865, huile sur toile, 92,5 × 72,5 cm, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague
- Le Ruisseau couvert, 1865, huile sur toile, 94 × 135 cm, musée d'Orsay, Paris
- Le Ruisseau du Puits Noir, vers 1865, huile sur toile, 80 × 100 cm, musée des Augustins de Toulouse
- La Femme au perroquet, 1866, 129.5 × 195,6 cm, Metropolitan Museum of Art, New York
- L'Origine du monde, 1866, musée d'Orsay, Paris
- L'Origine du monde (1866), Paris, musée d'Orsay.
- Le Château de Blonay (vers 1875), musée des beaux-arts de Budapest.
- Le Sommeil
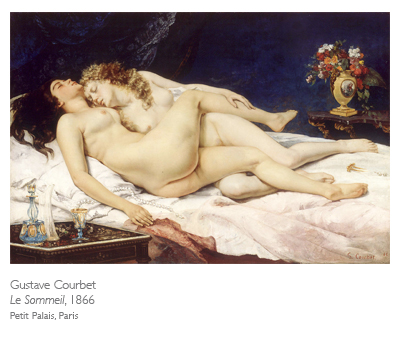 , 1866, huile sur toile, 135 × 200 cm, Petit Palais, Paris
, 1866, huile sur toile, 135 × 200 cm, Petit Palais, Paris- La Trombe, 1866, 43 × 56 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie
- La Pauvresse de village, 1866, huile sur toile, 86 × 126 cm, collection particulière
- La Remise des chevreuils en hiver, 1866, huile sur toile, (54 × 72,5), musée des beaux-arts de Lyon
- L'Hallali du cerf ou Épisode de chasse à courre sur un terrain de neige, 1867, huile sur toile, 355 × 505 cm, musée des beaux-arts et d'archéologie, Besançon
- Jo l'Irlandaise, 1866, huile sur toile, 54 × 65 cm, Nationalmuseum, Stockholm
- Pendant le reste de la saison de récolte, 1867, huile sur toile, 71 × 91,5 cm, Petit Palais, Paris
- La Femme à la vague, 1868, huile sur toile, 65 × 54 cm, Metropolitan Museum of Art, New York
- Femme nue au chien, 1868, huile sur toile, 65 × 81 cm, musée d'Orsay, Paris
- L'Hiver, 1868, 61 ×81 cm, collection privée, France
- Portrait de Pierre Dupont, 1868, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
- La Vague, 1869, Musée d'art moderne André Malraux - MuMa, Le Havre
- La Vague, 1869, huile sur toile, 66 × 90 cm, Musée des beaux-arts de Lyon
- La Vague, vers 1869/1870, huile sur toile, 63 × 91,5 cm, Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main
- Mer calme, 1869, 59,7 × 73 cm, Metropolitan Museum of Art, New York
- La Vague (1869), Le Havre, musée d'art moderne André-Malraux.
- La Falaise d'Étretat, 1869, huile sur toile, 93 × 114 cm, Von der Heydt Museum, Wuppertal
- Portrait de Paul Chenavard, 1869, huile sur toile, 54 × 46 cm, Lyon, musée des beaux-arts de Lyon
- La Trombe, Étretat, v. 1869/1870, huile sur toile, 54 x 80 cm, Dijon, musée des beaux-arts de Dijon
- La Falaise d'Étretat après l'orage, 1870, 162 ×133 cm, musée d'Orsay, Paris
- La Truite, gonflée et blessée est une allusion à la destinée de l'artiste, 1871, huile sur toile, 52,5 × 87 cm, Kunsthaus Zürich
- Portrait de l'artiste à Sainte-Pélagie, vers 1872, huile sur toile, 92 × 72 cm, musée Courbet, Ornans
- Pommes rouges au pied d'un arbre, 1871-1872, huile sur toile, 50,5 × 61,5 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich
- Les amoureux dans la campagne, 1873, 65 × 81 cm, musée Courbet, Ornans
- Le Château de Chillon, 1874, 80 × 100 cm, musée Courbet, Ornans
- Coucher de soleil sur le Léman, 1874, 55 × 65 cm, musée Jenisch, Vevey
- La Vigneronne de Montreux , 1874, 100 × 81,5 cm, musée cantonal des beaux-arts, Lausanne
- Le Lac Léman soleil couchant, vers 1876, huile sur toile, 74 × 100 cm, Kunstmuseum, Saint-Gall
- Grand panorama des Alpes, la Dent du Midi, 1877, huile sur toile, 151 × 203 cm, Cleveland Museum of Art
Source : Wikipedia

Christian Perret,
essai prononcé en conférence au xve colloque annuel de la Society of dix-neuviémistes, le 10 avril 2017, Kent University, Canterbury.
Au centre optique de nombreuses peintures de Courbet, il y a le noir ; absolu. Le rien du visible ou le tout de matière ; un gouffre qui attire l’œil vers ce qu’il va expulser : le visible ; qui attirant l’œil nous expulse du visible. Ce noir, source et tombe, s’ouvre ou se ferme en un lieu qui signe l’origine et la fin de son art.
Le lieu, l’origine, est sans doute prédéterminant de ce noir symptôme : qui travaille le visuel est d’emblée travaillé par lui, et ce dès l’enfance. L’environnement paysagé est primordial, pour celui qui, né en 1819, vivait en campagne franc-comtoise, même si le statut bourgeois de sa famille, propriétaire des terres de Flagey, lui ouvrait les quelques demeures patriciennes d’Ornans, la plaine et la société de Besançon et, plus lointaine, les potentialités urbaines et artistiques de Paris. « Pour peindre un pays, il faut le connaître. Moi je connais mon pays, je le peins. Les sous-bois c’est chez nous ; cette rivière, c’est la Loue, celle-ci c’est le Lison ; ces rochers ce sont ceux d’Ornans et du Puits-Noir. Allez y voir, vous reconnaîtrez tous mes tableaux1 ». De Besançon, aller à Ornans2, dernier bourg le long du val de la Loue, où ensuite tout est encaissé, c’est franchir collines et plateaux en enfilade, avec toujours l’impression que, la route sinueuse montant, Ornans sera au creux du prochain trou. Le parcours traverse sombres forêts de sapins et denses feuillus, débouche sur le vert gras des prairies et se heurte à la blancheur des falaises calcaires. Quelques fermes et masures, quelques troupeaux, blottis dans les creux, donnent préscience qu’arriver à Ornans sera entrer dans une caverne. Alors, est-on surpris, une fois arrivé, de trouver le bourg dans un site qui paraît relativement ouvert, non pas enfermé, mais lové entre les falaises, courant le long d’une Loue plus large qu’imaginée, aux flots moins profonds et agités que conçus. Son bourg, Courbet l’a pourtant peu peint (l’église, le château, vus de l’extérieur de la cité, le moulin, à sa marge), préférant monter sur les plateaux alentours, ou longer en amont la Loue, le Lison ou la Brême, jusqu’au Puits-Noir ou jusqu’à leur « source3 ». Cette plongée dans les vals étroits, fermés de rocs, troncs et feuillages où sans recul le monde se donne à peindre, est au centre de la dernière grande peinture mondaine de Courbet : L’Atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique (1855, Musée d’Orsay, Paris).
Dans son Journal, en peintre, Delacroix, admiratif de ce manifeste exposé en entrepreneur indépendant4, remarquait que : « la seule faute est que le tableau qu’il peint fait amphibologie5 : il a l’air d’un vrai ciel au milieu du tableau6 ». Dans L’Atelier, Courbet se montre comme enfermé en une cave sans recul7. Il s’y abîme, avec ses amis, relations et souvenirs et nous fait entrer dans son gouffre. Nulle ouverture n’est présente, hors l’éclairage qui frappe le paravent et le propose comme porte trompeuse. Si une lumière semble provenir de l’avant scène, il reste difficile d’y concevoir une fenêtre. L’éclairage est en effet plus allégorique que naturel, frappant la nudité du modèle, le drap qu’elle tient et sa robe chue, alors que les autres zones d’éclairement ou d’ombres portées sont sans commune mesure avec la luminosité qui frappe la modèle de blancheur8. Au fond de cet abîme, les seules ouvertures semblent être les peintures : des paysages, et celui qui domine est en travail sur chevalet au centre de l’image — non seulement au centre de sa surface mais aussi de sa faible profondeur. C’est un fond de vallée, dont le creux se situe à gauche, là où le peintre, figuré assis au côté de la toile, porte son pinceau, geste soutenu par la diagonale d’un massif forestier qui descend du coin supérieur droit du format qu’il peint.
Le centre géométrique de L’Atelier tombe sur la frondaison dorée du plus grand arbre du tableau peint. Le centre du tableau dépeint dans cet atelier est derrière la manche du bras tendu de l’artiste et figure, sur cette peinture qu’il peint, un fossé noir. Au bout du bras tendu de Courbet, un pinceau achève la lisière obscure du plus lointain des bosquets verts, là dans le creux. Ce point fixe le centre d’attention, pinceau ou main, où se croisent les regards du peintre, de l’enfant, du modèle et, le « regardant » depuis son revers, du mannequin supplicié9, comme capable de passer le trou noir du point de fuite — vanishing point10. Ce point d’où tout semble apparaître, déjà là, et où tout disparaît, encore là, est le lieu d’où pourrait surgir, ou disparaître quelque rivière, et que seul le groupe central considère. Aucune autre figure ne regarde la peinture en travail : ni à gauche en son envers, « le monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort » ; ni à droite en son endroit, « les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l’art ».
Ainsi cette « histoire morale et physique de mon atelier [… qui] sont les gens qui me […] soutiennent […], qui vivent de la vie, qui vivent de la mort. C’est la Société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi11 », un monde ignorant totalement le peintre et son travail, sa peinture et sa recherche12. La mondanité, triviale ou cultivée, pauvre ou riche, les amateurs du monde de l’art même ignorent ce que fait le peintre. L’activité de Courbet leur échappe et Courbet, de son profil « assyrien », de même : comme si le sujet de L’Atelier n’était pas la société. Dans son haut, à droite, chacun est venu se faire peindre socialement pour faire libre étalage de son apparence, comme pour se donner à voir en une conversation de salon où personne ne dialogue avec ni ne regarde personne ; cette société n’apparaît pas concernée par la recherche de l’artiste. Dans son bas, à gauche, tous ont été pris en peinture, captation réalisée comme à leur dépend, livrant la misère de chacun, replié en son ignorance, retiré sur lui-même, des autres et quasi de soi-même. Cette société n’a ni intérêt ni passion13, la cultivée trop préoccupée de soi, la miséreuse totalement privée de soi. En son milieu, Courbet a sa manière de voir la société : l’ignorer et peindre un pur paysage, assez semblable à la ceux de la série des Puits-Noir. Détourné du monde, le corps de l’artiste est montré peignant, étrangement de profil et très au devant sa toile, comme collé ou confondu au paysage peint, dans une proximité invraisemblable14. Courbet fait corps avec son tableau en travail et son corps se fond au motif paysagé.
« C'est l'histoire morale et physique de mon atelier, première partie », écrivait Courbet à Champfleury pour lui décrire son Atelier […] déterminant une phase de sept années de ma vie artistique. À savoir qu’après cette phase de sept années commençait une nouvelle phase, « seconde partie », dont Courbet en 1855 ne parle pas15. Une phase « hors du monde » et de ses discours que le corpus pictural exemplifie : dès lors, il y aura peu de grandes machines de Salon, tels que furent L’Après-dînée à Ornans (1849, Musée des beaux-arts, Lille), Le Tableau de figures humaines, historique d'un enterrement à Ornans (1850, Musée d’Orsay, Paris), La Toilette de la morte (1850-55), College Museum of Art, Northampton) ; de rares visions socialisantes, tels que l’ont été Les Casseurs de pierre (1849, détruit), Les Cribleuses de blé (1854, Musée des beaux-arts, Lille) ou Paysans de Flagey revenant de la foire (1850, Musée des beaux-arts, Bezançon)16 ; quelques portraits sociaux et un autoportrait17. Restent surtout des femmes endormies, en état de second ou de somnolence18, et le thème du paysage, qui va se développer tout en s’enveloppant. Ainsi, les paysages d’avant 1855 offrent des vues larges, des plateaux en dessus d’Ornans, offerts par les dégagements du Château d’Ornans ou Fontaine d’Ornans, Bassin aux vipères (1850, The Minneapolis Institute of Arts), de La Vallée de la Loue par ciel d’orage (1849, Musée des beaux-arts, Strasbourg), des Demoiselles du village (1852, Metropolitan Museum of Art, New York) ou de La Rencontre (1854, Musée Fabre, Montpellier) ; ceux d’après 1855 ne vont plus jamais ouvrir cette vue large, perspective, sur le monde. Il semble se déterminer à cette date une vision qui de mondaine19, « sur les plateaux », fait plonger Courbet sous ces plateaux, en retrait du monde. Prémisse : déjà en 1850, Le Tableau de figures humaines, historique d'un enterrement à Ornans, marque une limite entre dessus et dessous. La vue est située à peine au-dessus du nouveau cimetière, placé en haut du bourg, comme pour mieux présenter frontalement les falaises de la Roche du Mont en horizon, laissant la foule, l’entier des gens qui font et assistent au monde, sous cet horizon, comme enterrés par lui20. Ce monde que L’Atelier de 1855 encave serait-il avec son paysage l’ouverture de la « seconde partie » parfois vue comme un déclin21 ou la fin de la période de la persée réaliste22. Cet enterrement du réalisme en mondanité appelle-t-elle autre chose ?
Avec le paysage de L’Atelier du peintre, nous avons été précipités des plateaux mondains dans un abîme autre, proche des cours d’eau de la Loue, de la Brême et du Lison23. Et là au fond, quelque chose nous est donné à puiser : les vues du Puits-Noir, outre le nom du lieu, manifestent toutes une tache aveugle au centre de l’image, renforcée par les lignes des frondaisons, des troncs, des rocs et ravins qui y tombent. La rivière déborde du seuil de l’image, nous installant au milieu du cours d’eau dont il est difficile de savoir si de là, il descend ou monte, se perd dans le creux de la gorge ou en vient24. Seul signe du courant, dans la massivité bleu-vert brunâtre, sombre et presque noire de l’eau, quelques éclats blancs des remous, sont le plus souvent en aval des pierres sur lesquels le flux accroche. Si ces éclats sont visibles, c’est que sous l’obscurité des frondaisons, perce quelque lumière, devenue diffuse. L’éclairage est plus net sur les parties hautes, marquant un tronc, un feuillage, un pan de falaise d’une grasse clarté. Le soleil, assez haut dans le ciel, est toujours hors image, à gauche ou à droite, mais en son fond, précipitant le val en un presque contre-jour. Son disque absent fait exister d’une lumière chaude, presque dorée, la visibilité, jusqu’à ce que falaises, feuillages, troncs abîment ce visible dans le noir.
À moins que ce noir, sorti de nulle part, engloutisse de lui-même la lumière, tel dans la version du Baltimore Museum of art (ill.1). Le Ruisseau couvert (ill.2) confirme cette impression : le noir semble manger la lumière, vouloir se répandre en spirale centripète, et de son centre avaler l’intégralité du monde visible. Seul au premier plan en bas à droite, un roc sur lequel se tient un long tronc décharné semble résister ; comme échappe encore à l’arrière plan, symétriquement en haut à gauche, la frondaison éclairée. Le Ruisseau de Plaisir-Fontaine dans la vallée du Puits-Noir (ill.3) prend de même le visible en tenaille dans la fissure noire des frondaisons, qui descendent obliquement vers la gauche, libérant dans leur creux la claire visibilité de l’eau qui d’une oblique symétrique coule vers la droite. Le regard, suivant ce cours, heurte un rocher pour mieux replonger dans un creux noir, sous lequel s’affirme la signature de l’artiste. Courbet, dont on sait qu’il commençait ses peintures par le noir, semble s’évertuer à créer, par force de bruns, verts sombres, plus clair, pâles bleus et blancs, un visible qu’il destine au retour dans le noir. Comme s’il ajoutait masse de couleur sur masse de couleur pour, cumul de matière visible sur cumul de matière visible, destiner toute cette matérialité à l’invisible. « Ainsi le passage du sombre au clair est-il […] le négatif de l’impression du spectateur qui devant la toile croit remonter de la clarté des surfaces jusqu’à l’obscurité originelle25 ».
Origine et fin alternent, selon les versions, indiquant qu’elles se donnent pour même, sortant ou rentrant de ces noirs quasi omniprésents au centre géométrique ou optique des peintures paysagères de Courbet. L’œil du peintre comme du spectateur s’y engouffrent, dans un regard menacé par la force des choses, leur noire pesanteur. Cet écrasement affecte de nombreux paysages : il est deux promeneurs, passant un pont bien au dessus de nous, pour franchir la cascade du Gour de Conches (ill.4) où le blanc minéral de l’eau jouxte le centre noir du creux de roche. Ce trou noir peut être creux ou bosse. Ainsi, face à la massive frontalité du Chêne de Flagey (ill.5), le regard se heurte-t-il au tronc d’un arbre qui « sature le champ, le remplit bord à bord et […] le déborde26 ». Centré, le tronc est éclairé de la droite et ouvre dans toute sa rudesse le milieu de la toile en béance obscure. De cette droite, un minuscule chien course un lièvre situé de l’autre côté du tronc. Il semble prêt de se heurter contre cette masse en béance immobile, et en paraît ridicule, fragile devenir qui va se heurter contre le tronc du chêne. Bien souvent, le vivant ou les lieux de vie se précipitent ou s’encastrent dans des masses ou abîmes noires. Le Paysage avec rocs près d’Ornans (ill.6) présente un ciel qui au sol se mire dans quelques flaques, appel bleu ouvert. Le clair pan des pierres d’une bergerie s’appuie sur un roc dont la crête descend en oblique de gauche à droite sur un feuillage d’or. Entre bleu, gris clair et ocres lumineux, s’ouvre la béance noire de l’ombre, qui enserre la masure. Le Doubs à la Maison Monsieur (ill.7) et Le Rocher à Bayard, à Dinant (ill.8) encastrent de même les habitats dans le sombre, qu’il soit ombre des feuillage ou défilé de rocs.
Masse ou abîme, ce lieu noir peut être géométriquement centré ou non, se déportant en un centre optique où chaque fois le regard est attiré. Le Paysage de Chauveroche dans les Vaux d’Ornans (ill.9) équilibre le parallélépipède vertical de la tour rocheuse qui se découpe à gauche et le rectangle horizontal de la falaise qui le poursuit, comme si l’un était le basculement de l’autre. Amplifiant cet effet, la séparation de l’ombre et de la lumière agit comme un axe oblique entre les deux blocs clairs. Symétriquement, l’alignement du sommet de la tour et du décrochement de la falaise trace jusqu’à un peuplier qui se dresse, en bas à droite, dans le creux du terrain. Et la pointe de ce peuplier s’affiche sur une aire noire où le regard s’égare, déporté avec un sentiment de basculement. La Roche pourrie, étude géologique (ill.10) suit un même schème visuel, dramatisé : l’architecture de deux pylônes unis par un pont surmonte une barre rocheuse grise inclinée et effondrée en sa moitié. La brisure verticale tombe sur un cône herbeux mêlé de caillasses, surplombé d’une autre falaise, brune et molle, qui s’affaisse sur elle-même. Ce ploiement mène aux gouffres noirs qui s’ouvrent sous les caillasses dispersées sur un cône herbeux. Sous le poids, ce cône glisse vers les deux coins inférieurs de l’image, où gît le noir. Si le pont minuscule nous donne l’illusion d’un vol léger, nous sommes déjà ensevelis, écrasé, par l’effondrement. Le Paysage de rocs avec figure (ill.11) porte en son centre la saillie d’un roc en surplomb, qui pourrait se détacher du reste de la falaise, tel que marqué par la fissure noire qui l’en sépare ; mais aussi par le poids des bosquets obscurs qui surmontent les roches, et encore au-dessus un autre roc, à peine éclairé d’une lumière qui filtre du ciel lourd. Sous la saillie du roc en surplomb, une masse noire attire le regard dans le gouffre qui s’ouvre en creux rond, et au bord de son abîme, vers un personnage au gilet beige sur blancheur de chemise, de dos, regardant comme nous le gouffre. Assis, minimisé et obscurci, il se repose de quelque éprouvante marche ou labeur, tourné vers l’obscur, comme insouciant du roc en saillie qui pourrait se détacher, et sur lui tomber.
Basculement et chute dans un regard annihilé, où, artiste et spectateur, tombent, tel que l’annonçait Le Fou de peur (1843-45, Nasjonalmuseet, Oslo), évidence de précipice, maintenant à sa place et non plus dans le miroir de représentation, aussi proche soit-il. Inachevé, le tableau laisse la peinture s’écouler, en plaque massive, dans le gouffre centré au seuil de l’image27. Et même béance, il y a évidemment la tombe de L’Enterrement à Ornans qui s’ouvre au devant de l’espace de représentation, plaçant l’artiste comme le spectateur dans un virtuel trou noir28. Ce qui n’est pas tout : sous l’horizon, pressée par la masse des falaises trop proches, la foule, « mur solide de pigment noir29, comme déjà absentée dans ce noir, oscille, et semble devoir être en instance de sombrer dans la tombe. Cette foule cachant le creux du val de la Loue, que resterait-il sous les falaises, si elle disparaissait, une image du néant ? Est-ce la mort ? La mort du sujet, qu’il soit représenté (image), représentant (peintre) ou devant la représentation (spectateur) ? La fin du regard ?
La réception contemporaine à Courbet en fut part persuadée, l’accusant soumis au procédé technique de la daguerréotypie : machine aveugle qui « sans volonté, sans goût, sans conscience, se laisse pénétrer par l’apparence des objets quels qu’ils soient, et en rend mécaniquement l’image. L’artiste, l’homme, renonce à lui-même ; il se fait instrument, il s’aplatit en miroir, et son principal mérite est d’être bien uni et d’avoir un bon tain30 ». Ainsi, « il faudrait remplacer la brosse et le pinceau par la chambre noire et le daguerréotype31 », chambre noire qui constitue une « froide image du néant32 », et l’idéal de la vision picturale se réduirait à « un daguerréotype promené par un aveugle33 ».
À quoi on peut laisser Courbet répondre : « cela vous étonne que ma toile soit noire ? La nature, sans le soleil, est noire et obscure ; je fais comme la lumière, j’éclaire les points saillants, et le tableau est fait34 ». Ces saillies, il les réalisait en prenant « son couteau dans une boîte où étaient des verres remplis de couleurs, du blanc, du jaune, du rouge, du bleu. Il en faisait un mélange sur sa palette ; puis, avec son couteau, il l’étendait sur la toile et la raclait d’un coup ferme et sûr35 ». Ou, témoignage semblable : « il fait grand usage du couteau à palette qui dépose la couleur sur la toile avec une franchise éclatante et brutale, tandis que les poils du pinceau creusent de petits sillons où la lumière vient s’émousser et s’éteindre36 ». Ainsi ces saillies, écrasées par la massivité des empâtements menacent toujours de s’effondrer sur elles-mêmes, de partir en creux, au revers, dans l’obscur gouffre originel de son noir fond pictural. « Je veux tout ou rien37 » : comme la lumière, Courbet éclaire, s’assimile au soleil, se rend co-présent de la visibilité qu’il peint, et travaillant la masse picturale, en ce qui résiste à la lumière, fait ombre, Courbet fusionne avec la matière, se garde co-absent dans la matérialité des choses. Et il en est de même du spectateur : il voit, présent à ce qu’il regarde, mais devant scruter le noir, s’engouffre, disparaît, absent dans le regardé. Ne reste qu’une sensation d’épuisement : tant d’énergie pour échapper de la condition originelle d’un rien, tout avoir et revenir au point d’origine, tant de travail pour rien ou pour la mort : « travailler c’est dépenser sa vie ; travailler en un mot, c’est se dévouer, c’est mourir […]. L’homme meurt de travail et de dévouement38 ».
Vivre : naître pour mourir ?
Mourir, les scènes animalières et de chasse en sont le brutal témoignage. Mort directement mise en scène dans la blancheur de la masse affalée du Cheval mort (ill.12) surmontée de la béance noire de la forêt où fuit un homme transportant, quoi, un paquet, un enfant ? Quelque drame peu lisible a eu lieu. Mort moins directement montrée dans Le Cerf à l’eau, Chasse à courre ou Le Cerf forcé (1861, Musée des beaux-arts, Marseille) qui, invisiblement poursuivi, se jette à l’eau en ouvrant, dans un râle, la béance noire de sa bouche. Mort sous-entendue dans Le Rut de printemps ou Combat de cerfs (ill.13) non moins violent : le rythme des troncs, qui sépare le duo combattant de l’esseulé bramant, tombe, entre eux et au centre sur une zone sombre qui engloutit les trains arrières des bestiaux. Plus paisible, La Remise des chevreuils, au ruisseau de Plaisir-Fontaine (ill.14) s’ouvre sur un fond clair, comme pour mieux enfoncer dans l’obscurité le cervidé qui, sur la droite, descend rejoindre le ruisseau.
Le Paysage de neige dans le Jura, avec chevreuil (ill.15) affirme le même calme, soutenu par les blancs travaillés de bleus et de roux pâles de la neige. Pourtant, la déclivité du terrain, sur laquelle pèse un feuillage vert sombre et roux affirmé, forme une gorge qui mène au chevreuil, puis au coin inférieur gauche au noir d’un lac. Malgré que le calme de l’animal assis au repos, un négatif pressentiment pèse. Les Cerfs dans un paysage neigeux (ill.16) viennent renforcer l’impression : le même lac noir, le couple animalier tournant la courbe d’un enfoncement sombre, et sur la gauche tout le poids de massifs roches et broussailles écrase la scène. La même oblique sombre menace le fier cervidé du Paysage d’hiver, La Gorge aux loups (ill.17).
Il semble ne plus avoir que deux possibles destins, une patte avant lancée, l’autre à l’arrêt : devant, plonger dans l’eau et s’y noyer ou, derrière, s’engouffrer dans les creux des roches et dans le noir disparaître. Participe du malaise le fait que, présentés comme vivants, les modèles animaliers utilisés par Courbet sont en réalité des cadavres39 ; et que la sensation de coprésence du peintre et de l’animal, du spectateur et des scènes exacerbe l’absence de l’un ou de l’autre. En un temps ou ni les téléobjectifs, ni la sensibilité des supports daguerréotype ne peuvent capter des scènes animalières, les constructions peintes de Courbet fusionnent en atelier animal naturalisé et rendu paysagé dans un système de présence négative. Les animaux sont des observations de cadavres, rendus vifs ; peints de mémoire, les paysages sont des reconstructions mortes.Une fois la fiction constructive acceptée, reste une négativité logique : observer de si proche les animaux est impossible. La présence de l’animal induit l’absence de l’artiste, et du spectateur ; la présence de l’artiste, ou du spectateur, induit l’absence de l’animal. La coprésence n’est qu’illusion. La présence de l’un détruit celle de l’autre, l’engouffre, comme l’avalant. Autant que les scènes, c’est cette structure de présence-absence qui fait drame. Après le drame40, restent ces misérables Truites de la Loue. Celles d’Orsay (ill.18) et de Zürich (ill.19) gisent symétriquement dans l’anfractuosité d’un rocher qui semble les avaler. À cette gueule rocheuse répond la gueule ouverte des poissons qui laisse voir l’hameçon et le fil de pêche. Sur la version de Zürich, la prise est affirmée par la maxime in vinculis facibat qui suit la signature rouge de l’artiste. Des branchilles sort un sang rouge, comme un rappel de L’Homme au cœur blessé (1844-54, Musée d’Orsay). Deux des Trois truites (ill.20) de Berne sont suspendues à des branches, la troisième comme saisie alors qu’elle venait de se décrocher, dorsale encore dressée, tête s’affalant sur un sable ocre. Derrière, entre les poissons crochés et celui qui déchoit, s’affirme un noir absolu. Alors que vive, lisse et gluante, la truite glisse et échappe, ici morte, scellé est son destin : « ce poisson formidable, aux écailles de roc, semble reposer au fond des eaux vierges des âges préhistoriques », « un monde énigmatique des profondeurs [atteignant] l’ordre du mythique, voire du monstrueux41 ». Saturne ?
Saturne dévorait ses enfants et avec eux l’être et le temps du monde42. Dévoration dont Courbet inspirera, par ses manières de table et par sa maladie qui le rendait toujours plus amplement difforme43, des témoignages légendaires : « […] le corps du peintre pouvait être naturellement vu comme gorgé de la matière du monde — laquelle, quelques temps plus tard, se métamorphosa en sa décomposition immonde dans la célèbre diatribe d’Alexandre Dumas fils […] : de quel accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelle antithèse génésiaque, de quel suintement sébacé peut avoir été généré par exemple, cette chose qu’un appelle M. Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore, cette incarnation du Moi imbécile et impuissant ? […]. Camille Lemonnier cultive avec emphase cette représentation : […] on dirait un Gargantua aux appétits énorme, vautré dans le giron de la terre nourricière. Il a la double vue de l’estomac […]44 », bouche et anus45.
Saturne46 est aussi le dieu grec Chronos, fils de Gaïa (terre) et d’Ouranus (ciel) ou d’Hydros (eau) ; ou né du néant, uni à Ananké (la nécessité) ou à Nyx (la nuit). De cette union proviennent Chaos, Ether (air) et Phanès (jour, procréation et nouvelle vie — assimilé à Eros)47. Tant d’entités qui sont matières des paysages courbésiens : terre, eau, néant, nuit, chaos, air, jour. Écoutons Courbet : « suivez cette comparaison. Nous sommes enveloppés par le crépuscule du matin, avant les premières heures de l’aube : les objets sont à peine perceptibles dans l’espace ; le soleil monte ; elles s’illuminent par degrés et s’accusent enfin en toute plénitude. Eh bien, je procède dans mes tableaux comme le soleil agit dans la nature48 », et l’interprétant : « la lumière fait briller, révèle ces grandes masses sombres dont l’obscurité sous-jacente, le noir, comme dirait Courbet, exprime la profondeur, la vie sourde. La nature […| n’est ni le pittoresque ni l’accidenté, mais la conscience de cette troisième dimension des choses dans lesquelles on respire le plus largement, le plus intensément49 ». Lisons bien : la troisième dimension n’est pas le volume, c’est ce noir : l’obscurité, le sous-jacent, la profondeur ; la vie sourde. Il y a la vie, ici première dimension, il y a la mort, là seconde dimension. Et entre mort et vie, il y a la vie sourde, « qui vit de la vie, qui vit de la mort50 », troisième dimension. Il y a drame et néantisation des contraires, mais par l’annulation des termes en présence, sourd une a-présence51.
C’est ainsi que collé au côté de sa peinture, sans « reculée », Courbet semble s’y incorporer (y vivre) et y disparaître (y mourir), a-présent. Notons ici, et pour répondre aux interprétations formalistes et prédéterminées par la théorie d’un « drame » de l’anti théatralité52, que pour éclairer ces masses sans en dissoudre la profondeur obscure, pour éclairer les points saillants, le soleil ne peut agir que de biais. Le peintre, qui souhaite faire naître le visible sans faire disparaître l’invisible, travaille ses points saillants qui, picturalement sont des épaisseurs sillonnées (faisant grand usage du couteau à palette qui dépose la couleur sur la toile avec une franchise éclatante et brutale, tandis que les poils du pinceau creusent de petits sillons où la lumière vient s’émousser et s’éteindre). Hors dans la noirceur du fond, saillies et parfois sillons brillent, si et seulement s’ils sont vus de profils. C’est au simple niveau du « faire » que peut être comprise la posture biaisée et déportée sur le côté de Courbet, l’oblique étant la seule manière de voir briller la lumière par degré en révélant les masses obscures. La raison de sa position oblique et collée à la peinture peut maintenant se développer : comme le soleil, Courbet éclaire sans savoir ce qu’il révèle. Il s’infiltre dans un visible qu’il illumine sans voir53, tel le soleil qui éclaire les choses du monde ignorant qu’il les éclaire. La visibilité s’écoule et advient malgré la volonté de l’artiste qui la donne, en esthésie54. Loin d’être la capture frontale et objective de l’aveugle daguerréotype, elle est libérée par une absence subjective, latéralement déportée et confondue à l’espace du visible. Ce n’est pas la mort, la disparition ou l’absence du regard, qui se manifeste, mais une neutralisation du sujet regardant, qu’il soit l’artiste ou le spectateur55.
« Il descendit dans une sorte de cave qu’il avait d’abord crue assez vaste, mais qui très vite lui paru d’une exiguïté extrême : en avant, en arrière, au-dessus de lui, partout où il portait les mains, il se heurtait brutalement à une paroi aussi solide qu’un mur de maçonnerie ; de tous côtés la route lui était barrée, partout un mur infranchissable, et ce mur n’était pas le plus grand obstacle, il fallait aussi compter sur sa volonté qui était farouchement décidée à le laisser dormir là, dans une passivité pareille à la mort. […] La nuit était plus sombre et plus pénible qu’il ne pouvait s’y attendre. L’obscurité submergeait tout, il n’y avait aucun espoir d’en traverser les ombres, mais on en atteignait la réalité dans une relation dont l’intimité était bouleversante.
Sa première observation fut qu’il pouvait encore se servir de son corps, en particulier de ses yeux ; ce n’était pas qu’il vit quelque chose, mais ce qu’il regardait, à la longue le mettait en rapport avec une masse nocturne qu’il percevait vaguement comme étant lui-même et dans laquelle il baignait. […] C’était la nuit même. Des images qui faisaient son obscurité l’inondaient. Il ne voyait rien et, loin d’en être accablé, il faisait de cette absence de vision le point culminant de son regard. Son œil, inutile pour voir, prenait des proportions extraordinaires, se développait d’une manière démesurée et, s’étendant sur l’horizon, laissait la nuit pénétrer en son centre pour en recevoir le jour. Par ce vide, c’est donc le regard et l’objet du regard qui se mêlaient. Non seulement cet œil qui ne voyait rien appréhendait quelque chose, mais il appréhendait la cause de sa vision. Il voyait comme objet ce qui faisait qu’il ne voyait pas. En lui, son propre regard entrait sous la forme d’une image, au moment où ce regard était considéré comme la mort de toute image56 ». C’est ainsi, pour reprendre Dumas, que Courbet, corps gorgé et imbécile incorpore le visible qui l’enfle, tout en étant avalé par le monde, désormais sans Moi, esprit impuissant – seule sa signature ocre rouge reste un signe de protestation. Toujours trop marquée, elle l’affirme comme ego qui, une fois la toile finie, malgré tout demeure57. Reste que le tableau fini, c’est maintenant le regard du spectateur qui se confronte à cette même expérience pratique.
Les dessins de Courbet sont, pour la plupart, révélateurs de cette tension qui, faisant naître l’image, nous précipite dans le creux de l’inexistant, devenu point focal de l’attention à l’apparition. Des Sources du Lison ((ill.21) au Défilé rocheux dans la vallée de Lauterbrunn (ill.22), le tracé descendant des falaises s’appuie de plus en plus pour, arrivé au bas, se redoubler en lignes dures et serrées qui crochent les détails saillants dans les creux : arbres, pierres, maisonnettes, alors grisés de valeur. Le Creux Billard (ill.23) exacerbe cet effet de chute de par ses verticales qui s’appuient au centre de l’image, y soulignant la tombée d’une profonde lézarde ; comme un éclair noir qui fend la roche. Du blanc épars du papier dans la partie haute des dessins, l’œil est tiré vers ces gouffres grisés qui l’attirent à en fouiller le détail. Et plus le regard cherche à y voir, plus la grisaille devient noire. La Dame verte (ill.24) ouvre ostensiblement une caverne, qui devient accueil.
Les Promeneurs se reposant sous un abri rocheux (ill.25) dispose en rythme de plus en plus dense les figures accueillies, au fur et à mesure de leur recul dans l’obscur de la grotte, au dessin brutalement interrompu par une saillie du roc et le blanc du papier. Pour qui dessine, de tels lieux où la concentration des tracés, des déterminations, paraît créer de l’obscur ne sont pas des lieux de disparition : ce sont des lieux de concrétisation, le nœud où tout débute, lieux de l’apparition, cherchés par le dessin à l’envers. La détermination des troncs dans les Trois paysages de campagne (ill.26) se fait par entrelacement des tracés noirs, lesquels peuvent s’ouvrir pour laisser advenir le blanc, lumière et eau, comme dans La Cascade de Staubbach (ill.27).
Un dessin plus abouti, le Paysage avec cascade (ill.28) donne à la blancheur lumineuse de l’eau un statut d’apparition : elle coule se libérant des rocs sombres qui l’enserrent, de sa vigueur paraît d’elle-même écarter l’inertie de leur emprise.
La parution de l’eau, indissoluble des gouffres sombres, amène ce discours de saillie : de l’enfoncement, quelque chose surgit. Le Paysage avec rochers et chute d'eau (ill.29) témoigne de la nature de ce surgissement : si l’eau est du même clair que les tranches éclairées des rocs, elle a une autre lumière et blancheur. Elle est vive, en mouvement cascadant et rebondissant, frémissante hors du noir ; les roches comme les feuillages restant mornes empilements de couches picturales, géologiques ou végétales. Une fois jaillie de la saillie, après être disparue derrière un buisson, l’eau s’écoule en pan plus plat, retrouvant l’aspect minéral des rocs, perdant sa vivacité pour le sombre. Seul le surgissement de la chute d’eau, instant d’éclair toujours perpétué, semble avoir capté Courbet et être amené à nous capter ; le reste du paysage peint jouant comme d’un écrin, caverne ou boîte noire pour permettre cette captation. L’Entrée d’un gave (ill.30) désavoue cette parution : conduit entre la succession des pans de rocs, verticaux à gauche, plus horizontaux à droite, vers une faille sombre ouverte par deux lèvres rocheuses rougeâtres, le regard remonte le cours d’une eau atone pour s’engouffrer dans l’obscur. Déçus de ne rien avoir trouvé, que rien ne soit advenu, nous ne regardons pas le clair ciel picturalement insignifiant. Tenus par les lignes rocheuses, nous restons crochés dans le noir, passifs mais non désespérés : suspendus, mais en attente de quelque chose, d’une parution.
Ce quelque chose, Courbet l’a peint, avec parfois un biais narratif, comme dans La Source à Fouras (ill.31). Il se montre peignant (ou peut-être se transfert-il dans la figure d’un anonyme peignant) une jeune femme vêtue d’une robe blanche, en un cadre de nature domestiquée. Un terre-plein rectangulaire s’ouvre sur sa profondeur pour accueillir deux bassins de lavandière58, le tout donné à voir en une perspective centrale, rare chez Courbet, dont le point de fuite, un peu décalé à droite du point central de l’image, donne sur une grotte, manifestement aménagée en voûte.
Sa noirceur absolue est surmontée d’une broussaille vert sombre puis clair, et d’un pan de falaise dépeint d’un ocre lumineux, marqué de stries horizontales puis verticales, qui clôt la perspective. Ce pan est encadré par l’assombrissement progressif des verts feuillages qui s’alignent en son devant. Cette clôture frontale et lumineuse renforce le trou noir de la grotte voûtée, au point qu’elle apparaisse outre perspective, comme surgie d’un derrière la surface de visibilité. De ce gouffre dégueule, un peu à sa droite, un gluant tombant gris, de l’eau ? Elle file suivant la ligne perspective offerte par les entablements rocheux, puis est brusquement interrompue. Elle semble avoir été canalisée jusqu’à un réservoir qui se dessine devant la femme assise sur un bloc, dont le profil esquissé montre qu’elle en regarde le contenu. De ce réservoir, un canal sombre dirige l’eau vers les deux bassins. Un petit saut la fait cascader vers le bassin le plus avant, aussi le plus petit, qui peut par une entaille la laisser filer vers le bassin plus arrière et plus grand. Dans l’axe perspectif, ce second bassin ouvre aussi une entaille propre à laisser couler l’eau hors sa surface rétentive59.
Où va l’eau de là ? Un liseré vert sombre marque un creux : elle chute, en tous les cas pas vers la droite en amont, mais vers l’aval à gauche, là où en contrebas, en retrait mais face au modèle, se situe le peintre. Il est chapeauté d’un bloc de pierre ocre clair qui le menace d’écrasement, alors que son modèle, vêtu d’une robe ocre gris clair se love dans l’abri accueillant du talus rocheux. Entre peintre à gauche, en rentrait aval et modèle à droite, plus en avant amont, les deux bassins d’eau agissent comme des surfaces de médiation ; surfaces qui sont des creux, emplis d’eau, qui miroitent le vert sombre des feuillages ou sont obstruées du sombre vert de quelques algues et mousses. Et média, l’eau l’est elle-même60, sortant de l’antre noire, coulant près de la femme, reposant dans les bassins, s’engouffrant vers le peintre61. Elle est une sorte d’espace interstitiel, jouant le rôle d’un entre-deux, initiant un clivage à l’intérieur de l’image. Pour le spectateur, assistant de l’espace entre-forme à ce qui vient en a-forme dans la profondeur, une « vie vague » y transpire62. De la disparition, de l’effacement et de la mort se donne à voir, mais presque par la négative, la vie, la présence et l’apparition qui s’infiltrent.
La Source (ill.32), sans doute relecture d’Ingres (1820-56, Musée d’Orsay, Paris)63, scénarise ce même rapport de parution de l’eau vive hors de la morne béance noire. À l’oblicité du corps féminin aux massives fesses trop claires répond l’oblicité d’un ravin, qui sépare une clairière d’une petite cascade. Ce nu de dos retient de sa main gauche un filet d’eau jaillissant du centre de l’image, coupé par un tronc vertical. Cette tranchée sépare le jour qui s’ouvre au fond à gauche de l’obscurité proche, à droite, et là où elle est recoupée par l’oblique du corps et du décor, s’ouvre le lieu noir d’où sourd cette « source » invisible. L’eau semble ne saillir de rien pour animer la main de la nue, au profil fuyant, anonymisé, et qui pourrait basculer dans les ténèbres à droite, si de son autre main elle ne se tenait pas à une trop frêle branche. Le contraste des deux mains rend plus encore cette impression d’opposition entre l’animé et ce maintient figé.
Son pied droit se soulève enfin, montré plus vif, plus décrit, que ce corps massif qu’on dirait pétri, et répond à la vivante main gauche, au long d’une oblique qui croise celle du ravin, là où la verticale scinde l’image, là d’où l’eau jaillit : sur ce noir point central. L’amorphe se fait vif ; picturalement, l’informe se forme par infiltration latérale de la lumière ; dans la fiction peinte, il en va de même : la nymphe du pétri prend vie, sous l’écoulement frontal de l’eau.
Morpheús64, ce noir est réversible, voire est la réversibilité elle-même : disparition, engloutissement et apparition, surgissement, les deux à la fois ; en résurgence. Tels les cours d’eau jurassien, qui semblent sortir « tout fait » de quelque gouffre, mais dont l’origine est ailleurs, leur parution ne marquant que la fin d’un parcours quasi insondable65.
Ce pourquoi à « source » de la Loue et d’autres cours d’eau franc-comtois, il faut bien placer des guillemets : ce ne sont pas des sources, mais des résurgences. Là, au pied d’une falaise de calcaire blanche ouverte dans le sombre de la forêt, s’ouvre un vaste gouffre obscur, d’où noire et blanche jaillit une rivière déjà toute faite. Issue des recueils variés, lointains, de divers autres cours, passés par infiltration, faille, emposieux (dolines) et galeries souterraines, l’eau jailli avec un débit de plus de 50m3/s, rivière qui jamais nu fut ru, adulte sans enfance, déjà mûre, déjà exploitable pour sa force et son sel. Plus bas, à Salins, l’homme a ainsi ouvert les entrailles de la terre en mine. Depuis l’Antiquité66, on puise des tréfonds l’eau de saumure de la Furieuse (affluent de la Loue), remontée dans des fours de rocs, chauffés du bois des forêts locales, à évaporation. Et passant de la froide humidité noire des galeries au rouge sec surchauffé des fours, les travailleurs récoltent ce blanc charbon qu’est le sel, or incolore. Réaliste, Courbet n’a pas ailleurs jamais montré ce travail, mais ses paysages en manifestent la matière première : tréfonds de froide humidité noire saumure, entre bois et rocs où se puise et s’évapore le visible.
Le regard se fatigue à fouiller l’obscur et l’œil s’ensanglante dans une surchauffe asséchée du voir. Courbet ne montre pas le labeur mais semble en intérioriser la pénibilité, et nous en faire intérioriser le phénomène. Il inverse le positivisme social qui le précède et l’entoure67. Il oppose à l’idéal radieux d’un monde maîtrisé par les réalisations du travail libre68 un engloutissement dans la sombre matière du monde débordant d’énergie.
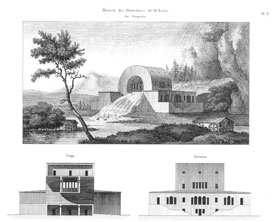
Maison des directeurs de la Loue,
1804, Saline Royale, Arc-et-Senans.
Courbet pénètre comme chtonien dans le ventre nature. Nous nous y engouffrons avec lui, passant outre le travail humain, inaperçu, au seuil du gouffre : que semble précaire et presque vaine cette activité humaine, par ailleurs fort passive puisque l’on n’y voit que pêcheurs ou roue de moulin tournant au fil de l’eau. La Source de la Loue de Washington (ill.33), présente un homme pêchant à la fourche, debout sur une dérivation, mieux visible sur la version d’Hambourg (ill.34 ): quelques planches horizontales maintenues par deux pieux, tels que le montre la version de Zurich (ill.35), dirige une part des flots vers un moulin visible sur celle du Metropolitan Museum of Art (ill.36). Si la façade de la bâtisse semble tenir, les planches se dispersent de plus en plus chaotiquement, écrasées par la cascade d’eau blanche sur noir, et Courbet de signer sur ce chaos, là où il s’efface dans une brume de non peint. Et si cette version nous a fait reculer et descendre un peu, force est de constater que la perspective qu’elle ouvre se referme sur la béance noire du gouffre qui, sur sa ligne d’horizon, dégueule le blanc des flots. Plus serrées, les deux versions précédentes nous placent comme déjà dans l’antre du monstre, une fois spectateurs d’un homme qui pourrait se faire avaler, une fois acteurs comme déjà engloutis. Impression confirmée par la version de Buffalo (ill.37), qui exclu toute présence ou construction humaine : nous sommes face au monstre, déjà dans sa béance. A l’inverse du positivisme affirmé en Franche-Comté par Ledoux qui imagina appuyer un bâtiment69 sur la source de la Loue (ill.38), pour mieux en cacher le gouffre et le domestiquer par le travail, maîtrisant la nature par la preuve platonicienne de la géométrie, les gouffres de Courbet font « forteresse dirigée contre le centralisme et le régime autoritaire70 », sont remparts à cette volonté idéalisée de maîtrise d’un travail garde et directeur de l’humanité et du monde. Ils se creusent en opposition à la métaphysique proudhonienne de réalisation par le travail. Ce parce que l’artiste perçoit que le travail n’est pas « naturel », mais qu’est « naturelle » et réelle la précarité humaine, la vanité des réalisations, travaux et activités ; précarité de la vie et de la mort, de l’existence même face aux forces du réel ; « ainsi la force est inhérente, immanente à l’être : c’est son attribut essentiel, et qui seul témoigne de sa réalité 71 ».
L’artiste Courbet apparaît bien plus proche d’une philosophie de la condition humaine que l’homme engagé dans les débats sociaux de son époque72. Ainsi faudrait-il comprendre la phrase paradoxale « ce sont les gens qui vivent de vie, qui vivent de la mort » de sa lettre sur L’Atelier, bilan de la première partie de sa recherche, sociale, et ouverture d’une seconde partie bien plus métaphysique, déjà depuis longtemps pressentie. Alors, si l’on peut lire dans le frise noire des vêtements de L’Enterrement une affirmation que « la communauté présente absorbe l’individu [… et que] la conscience d’appartenir à une communauté, conscience éveillée par la révolution de 1848, apparaît […]73 », il faut être aveuglé par une lecture trop politiquement idéologisée pour ne pas voir que cette communauté humaine est elle-même absorbée par le monde, qu’il soit figuré en paysage ou présence picturale de matière noire ; la seule conscience étant d’appartenir au monde réel, comme précaire et éphémère existant. De là, il convient de lire dans les paysages non pas « une tension entre le radicalisme et le conservatisme […] d’un retour à la nature ou à la perception naturelle, et à des structure sociales enracinées dans un homme qui ne fait qu’un avec le monde physique [… comme] moyen de fuir les fléaux présents de la société ; [… ni] la dualité paradoxale et douloureuse de l’homme – être naturel et laborieux, objet et sujet du monde74 », mais l’affirmation d’un homme pris par le monde, objet et jouet d’une réalité physique qui le déborde, force de réalité qui est seule sujet. Les diverses versions de La Grotte Sarazine précipitent ce même assujettissement de l’homme par le monde, cette fois plus de biais. Celle de Lons-le-Saulnier (ill.39) nous présente un pêcheur assis, dont la fragile canne dressée pointe le gouffre, celle du Getty de Los Angeles (ill.40) use de deux blocs de pierres claires, presque sphériques, pour nous tirer à gauche dans le trou. Sur le côté opposé, appuyée contre la paroi rocheuse, une frêle treille semble être placée dans la vaine fonction de prévenir quelque effondrement. Au bord supérieur des deux peintures, la grotte se referme. Elle « sature le champ, le remplit bord à bord et […] le déborde75 » : nous sommes déjà dedans. La Source du Lison de 1866 (ill.41) crache de sa gueule noire une cascade d’eau blanche qui, enserrée dans le défilé de deux blocs, paraît remonter pour se faire avaler, et notre regard avec. Alors que la version de 1864 (ill.42) semble nous présenter le monstre : deux yeux diagonaux percés de noir et rouge et les mêmes teintes pour la gueule qui s’ouvre horrible biaisée, sur un croc. Elle bave une abondante salive qu’elle peut à tout moment ravaler76. Est dépassée ici la possibilité d’une lecture uniquement sociale et politique du réalisme Courbet : toute activité est minimisée par la béance de l’être nature, avalée comme notre regard par sa capacité insondable d’origine77 : faire naître ce qui existe déjà est en effet le paradoxe de tels gouffres. Est-ce l’intuition d’un réalisme plus profond : « et si, du fait de son incompréhensibilité fondamentale, le réalisme […] de Courbet, c’était précisément cela : la tentative d’un peintre de représenter non pas la réalité, mais le Réel ? Le Réel, c’est-à-dire ce qui s’oppose à l’imaginaire comme au symbolique dans la […] topique lacanienne78, et qui constitue ce qui reste impossible à symboliser, cet ailleurs du sujet […], cette réalité désirante qui s’exprime [… dans la peinture], mais qui reste inaccessible à toute pensée subjective. Ce Réel au fondement du réalisme de Courbet serait alors ce qu’on ne peut ni saisir, ni appréhender, et qui se définit d’abord à partir d’une limite du savoir : un impossible à rejoindre79 ».
« On pourrait dire que le Réel, c’est ce qui est strictement impensable. Ça serait au moins un départ. Ça ferait un trou dans l’affaire […]80 ». L’Origine du monde (1866, Musée d’Orsay, Paris) est une faille sombre ouverte par deux lèvres de chair rougeâtre, comme L’Entrée d’un gave où le regard remontait un cours d’une eau atone pour s’engouffrer dans l’obscur et ne rien trouver. Nous restons crochés dans le noir, passifs : suspendus, en attente de quelque chose, d’une parution. « Qu’est-ce qu’un trou, si rien ne le cerne81 » ? Trou, ce sexe engloutit tout ce qui existe, ravale la visibilité, absorbe l’ampleur des formes, plis des cuisses, du ventre et de la poitrine, replis du drapé blanc, emportés par une force centrifuge survenue de l’interne de la fente. Le regard subit le même double mouvement fascinant : la ronde bosse massive des cuisses, amplifiée par un raccourcis trop rapide vers la poitrine, projette le premier plan vers le spectateur, qui, scrutant la fente offerte, est happé dans ce sexe, qui l’emporte derrière la toile82. Le fond pictural est brun noir, la touffe de poil pubien un peu plus noir, la fente plus noire encore, et là où le regard s’engouffre est un noir absolu, un noir d’outre-monde.
« Pour plaire à un très riche musulman qui payait ses propres fantaisies au poids de l’or et qui, pendant un certain temps, eut à Paris une certaine notoriété due à ses prodigalités, Courbet, ce même homme dont l’intention pompeusement avouée était de renouveler la peinture française, fit un portrait de femme bien difficile à décrire. Dans le cabinet de toilette du personnage étranger auquel j’ai fait allusion, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert. Lorsque l’on écartait le voile, on demeurait stupéfait d’apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, extraordinairement émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite con amore, ainsi que disent les Italiens en donnant le dernier mot du réalisme. Mais par un inconcevable oubli, l’artisan, qui avait copié son modèle sur nature avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Il est un mot qui sert à désigner les gens capables de telles ordures, dignes d’illustrer les œuvres du marquis de Sade, mais ce mot, je ne puis le prononcer devant le lecteur, car il n’est usité qu’en charcuterie83 ». L’aveuglement de la mauvaise foi du critique est révélateur84 : sa description du corps devient symptôme85 de ce que la peinture produit. Courbet n’a certes pas représenté les pieds, les jambes, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête ; mais les cuisses, le ventre, les hanches, et la poitrine sont bels et bien là, dépeints. Sinon qu’à force de ne retomber que sur le gouffre sexué, les volumes des cuisses, du ventre, des hanches et de la poitrine sont bels et bien absentés, engouffrés. Ne restent que l’ordure86 et évidemment le procès de pornographie bouclant l’accusation rhétorique qui fait du peintre un prostitué87.
Abjectes, ces entrailles, obscènes ? En ce qu’elles précipitent hors scène, dans un « monde » qui précède sa venue au monde visible, oui. Comme un système emposieu – résurgence, L’Origine du monde est, engouffrant le visible, ce monde à son origine, avant sa visibilité. Et sans doute est-ce la raison de sa double occultation, hors la question de la morale privée, de toute façon préservée, le tableau étant accroché non dans le salon de Kalhil-Bey, mais, derrière son mur, dans un cabinet de toilette88 et recouvert d’un rideau vert. A son ouverture, le rideau, va découvrir89 la hanche, la cuisse, le ventre, le nombril et la poitrine du modèle, qui par son mamelon l’identifie comme féminin ; puis la dense toison noire des poils pubiens et enfin cette fente. Ce trou, pourtant de détail, fait oublier le dévoilement de la seconde cuisse et, plus encore, de ce qui avant avait été découvert, faisant dénoncer au critique « un inconcevable oubli [de] l’artisan, qui […] avait négligé de représenter […] les cuisses, le ventre, les hanches, et la poitrine ». Il agit comme la « source » de la Loue, qui fait resurgir un cours d’eau dont on finit par ne plus pouvoir penser qu’il est impossible, s’il ne vient pas d’ailleurs, engouffré par quelque emposieu. Sidérante, L’Origine fait oublier l’origine ; le trou, la femme ; le noir, le visible ; la visibilité, le réel.
C’est dire que la sidération opérée par ce trou fait oublier au spectateur ce que pourtant il a sous les yeux, et l’engouffre dans une totale absence de visibilité. L’Origine du monde agit comme un moule qui engouffre la visibilité dans l’invisible, et même l’indicible. Perçue comme « contre épreuve […] du Torse du Belvédère90 », l’image troue la conception même que l’on a, devenant inconcevable91. Ce monde peint, qui nous offre la vue de ce sexe, nous retire aussi toute vue de la femme ; parce qu’avec le retrait du rideau, il nous apparaît que le drapé pictural qui la couvrait a été retiré de son torse et sexe, pour mieux recouvrir son sein gauche et voiler son visage. Cette éclipse est aussi construite par la composition du tableau qui y conduit le regard : la vue est appelée par le coin inférieur gauche et la pénétration de l’image suit, en profondeur, la diagonale du format. Arrivée au coin opposé, la vue achoppe sur le repli blanc du drap, triangle droit coupé net par le bord de l’image : rien n’est visible plus loin, pas même imaginable92. Ainsi hors de l’image, il n’y a plus d’image visible ou mentale. Le triangle supérieur droit appelle son symétrique brun à gauche, qui n’est qu’un fond, pas même un mur. Borné par la limite, le regard ne peut que descendre pour constater la coupure de la cuisse droite. Revenu à son point de départ, il va cette fois longer ce bord qui s’impose, constater en bas le même fond brun sur lequel le drapé se soulève et la même coupure de la cuisse gauche. Et la vue remontant le bord droit finit par saisir l’absence de bras. S’offre au regard d’emblée toute la peinture visible, et plus le spectateur parcourt la surface visible du tableau, plus son cadre lui en retire la visibilité. « Ce qu’il cherche à voir, […] c’est l’objet en tant qu’absence ; ce qu’on regarde c’est ce qui ne peut pas se voir93 ».
Si nous avons ici le monde à son origine ou l’origine même du monde, le moment et le lieu de La Genèse, ce qui nous en est donné ressort d’une sorte de théologie négative où le theos serait quelque monstre. Si peindre c’est montrer (monstrer), ne se montre que le visible du monde. Courbet montre pour cacher, et en creux il a-montre un monde outre visible, l’immonde, le monstre, le daimon94. Cet i-monde visuel qui en tout instant donne naissance au monde visible et à tout moment, en même temps, le reprend. Qu’est ce monstre sinon ce qui offre et retire l’apparence dans une folle débauche d’énergie centripète, dispersant le visible et centrifuge, l’absorbant. Energie contradictoire dont les effets s’annulent, ne libérant in fine que l’énergie pour elle-même.

Une Trombe "Audaces tromba juvat",
1867, Le Journal amusant, Paris.
Ainsi, comme beaucoup l’ont remarqués, L’Origine du monde a une grande similitude avec les Sources, Puits, Grottes et gouffres, pas seulement formellement, mais dans son fond ontologique95. Et tous lient la question formelle, puis phénoménologique, avec la série des Vagues96, mais tous effleurant la question ontologique : que sont ses vagues ?
Les vagues de Courbet, ce sont celles de la série maintenant célébrée, du rouleau de vague s’écrasant, spectaculaire, que l’œil prend de tiers profil97. La version du musée Oskar Reinhart, Winterthur (ill.43) manifeste cette énergie centripète, donnant forme blanche à l’arrête, la crête et l’écume de la vague ; doublée de la force centrifuge, refermant la forme sous le repli de l’écume en rouleau noir. Effets annulés, l’énergie se libère pour elle-même dans les reflux de l’avant plan, alors que la suite de sa dispersion s’annonce à l’horizon, non seulement dans les crêtes des vagues en préparation, mais aussi dans les masses nuageuses qui semblent prêtes à se briser en rouleau. Point culminant, la crête triangulaire blanche de la vague, se soulevant devant le clair verdâtre de l’eau en repli, fait saillie sur le tréfonds obscur du rouleau qui l’écrasera. Dessous et devant, tout s’écrase en chaos. Une version de 1870 (ill.44) montre le rouleau s’écraser sur le fond pictural brun de la toile, où gît la signature ocre rouge de Courbet. Le reflux d’eau se déroule comme un drapé blanc qui ourle, de son volume pictural posé, le rembrunissant, le plat fond pictural. Et l’extraordinaire de cette peinture, qui ici s’affirme comme matière réellement posée sur son support, est qu’elle ne renvoie pas à la réalité plane du support mais, mise en contraste avec le tréfonds noir de l’abîme de la vague en rouleau, à une outre réalité, comme « derrière » le support pictural. C’est ici le même appel que celui du rebord du drapé blanc qui gît sous le corps de L’Origine du monde et du bord inférieur gauche où la cuisse finit par « manquer » au cadre et laisser apparaître le brun du fond pictural.
Et des vagues, il y en a d’autres, aujourd’hui moins connues, parce que moins spectaculaires, soit échappant au speculum, à la visibilité pour elle-même. Elles se dressent comme lieu d’apparition d’une « invisibilité oubliée, à même le visible, [qui] hante le visible. Cette invisibilité, c'est le visible en tant que tel. Elle s'acharne, elle fascine. On ne peut pas la faire réapparaître comme quelque chose qui aurait été cachée, qui aurait disparu, car elle est invisible par principe, en-dehors de toute phénoménalité98 ». Ces autres vagues sont délibérément frontales, et confrontent de fait le spectateur à une masse, qui n’est plus trou, fente, puits, grotte, gouffre, abîme. C’est une a-surface énorme et a-volumétrique, ou i-volumétrique, agissant comme une poussée du fond, « toujours recommencée et jamais finie, [qui] enveloppe ou aspire le regard du spectateur, [… qui] supprime toute perspective, disqualifie tout recul et interdit tout point de fuite au peintre. La mer s’impose en soi en tant que tel au regard, dont l’activité visuelle se trouve comme suspendue et réduite. La mer surgit, seule et d’elle-même99 ». Ainsi de cette pochade de La Vague (ill.45) (peut-être avec collaboration d’atelier) qui, par l’arrête verticale d’un trait blanc poussant telle une cime, nie la crête accomplie du volume la dominant, et va encore la faire se dresser. Le noir domine cette pulsion sous la vague, devant elle, et à droite, derrière, sous apparence de flots, comme à gauche, derrière, sous apparence de nuées. Ces noirs arrière rejoignent le noir avant et engloutissant le regard du spectateur, qui s’engouffre alors derrière, en arrière toile, dans un « impossible » outre-monde. Plane, la toile, niée par le volume d’une vague qui se renie en creux, zeigt « daß es keine wahrhaft schöne Fläche ohne eine schreckliche Tiefe gibt100 ».
La Trombe (1866, Philadelphia Museum of Art) préfigure cette effroyable profondeur : nous sommes encore lointain de cet événement qui se profile, mais se fait sentir : les deux tiers de la surface sont emplis des tracés noirs de l’eau en déluge se fermant en courbes verticales pour clore le clair ciel du visible. Elles écrasent les horizontales du tiers pictural restant, qui alternent en coloris noir, gris, blanc, gris, noir, gris, noir, gris, blanc, beige, le fond pictural. Entre ces lignes, à l’horizon, le vestige d’un récit : des voiles noires, de quelques trop téméraires navigateurs, une voile blanche, qui encore peut fuir, et devant une sombre à nouveau, annonçant l’inéluctable : devant cette trombe, rien de l’apparence ne sera bientôt visible. Rien de l’éphémère existence ne restera, seule la puissance des flots viendra frapper, venue du fond, ce que la caricature de Gustave Randon (ill.46), amplifiant l’effet en effaçant l’anecdote, exprime au mieux. Venue d’un espace outre-toile, la grisaille aqueuse va frapper sa surface, comme sur une vitre, noyée d’invisibilité.
« Dans une grande pièce nue, un gros homme graisseux et sale collait avec un couteau de cuisine des plaques de couleur blanche sur une grande toile nue. De temps en temps, il allait appuyer son visage à la vitre et regardait la tempête. La mer venait si près qu'elle semblait battre la maison, enveloppée d'écume et de bruit. L'eau salée frappait les carreaux comme une grêle et ruisselait sur les murs. Sur la cheminée, une bouteille de cidre à côté d'un verre à moitié plein. De temps en temps, Courbet allait en boire quelques gorgées, puis il revenait à son œuvre. Or cette œuvre devint La Vague et fit quelque bruit par le monde101 ». Ce monstre aqueux offre et retire l’apparence dans une folle débauche d’énergie centripète, dispersant le visible et centrifuge, l’absorbant. Cette énergie contradictoire dont les effets s’annulent, ne libérant in fine que l’énergie, pour elle-même, commence à prendre identité : Maupassant nous livre la contingence intérieure, grasse, sale, collante, de la fabrication de la peinture, a priori préservée du réel externe de la tempête. Mais ce pour nous décrire Courbet se collant à la vitre comme pour se faire battre par les flots salés, enveloppé de leur écume et bruit, pour revenir, ruisselant, au mur pictural de son œuvre. Ne pouvant techniquement pas peindre dans la tempête, incorporée à elle, il fait tout pour se l’incorporer, jusqu’à en boire le substitut fermenté, dissolvant sa contingence intérieure pour précipiter en lui le réel extérieur.
L’incorporation de ce monstre, tempête de l’outre-monde, s’amplifie avec les versions les plus frontales des Vagues. « Celle de Berlin (ill.47), prodigieuse […], bien plus palpitante, plus gonflée, d’un vert plus boueux, d’un orange plus sale […] avec son enchevêtrement écumeux, sa marée qui vient du fond des âges, tout son ciel loqueteux et son âpreté livide. On le reçoit en pleine poitrine, on recule, toute la salle sent l’embrun…102 ». Les versions du Dallas Museum of Art (ill.48) ou de la National Gallery of Victoria (ill.49) imposent en leur bas le fond pictural brun sombre et la signature ocre rouge de l’existant Courbet ; en leur haut, des massifs montagneux de nuées ocre blanches, blanches et gris bleutées, grises et noires, pur flux de force matérielle. Pris en tenaille entre ces deux bords, le regard se heurte ensuite en bas à un chaos d’écume épaisse, en haut au chaos nuageux plus fin, de noirs, blanc et gris verdâtre. Ce regard est alors enclavé au centre, pris dans la nasse du soulèvement blanc de l’écume, qui domine un horizon presque disparu103, et cette saillie s’engouffre dans un creux vert sombre qui ramène à la disparition de l’horizon, de l’espace de visibilité. Cette énergie qui se soulève pour mieux s’affaisser est une débauche qui paraît inutile, palpitante, gonflée, boueuse, sale, écumeuse, âpre, venue du fond des âges : c’est « la pâte même des choses ».
« Donc j’étais tout à l’heure au Jardin public. La racine du marronnier s’enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c’était une racine. Les mots s’étaient évanouis et, avec eux la signification des choses, leurs modes d’emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J’étais assis, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j’ai eu cette illumination. Ça m’a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n’avais pressenti ce que voulait dire exister. J’étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux la mer est verte ; ce point blanc, là-haut c’est une mouette, mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une mouette-existante ; à l’ordinaire, l’existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle est nous, on ne peut pas dire deux mots sans parler d’elle et, finalement, on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, il faut croire que je ne pensais rien, j’avais la tête vide ou tout juste un mot dans la tête, le mot être. Ou alors je pensais… comment dire ? Je pensais l’appartenance, je me disais que la mer appartenait à la classe des objets verts ou que le vert faisait partie des qualités de la mer. Même quand je regardais les choses, j’étais à cent lieues de songer qu’elles existaient : elles m’apparaissaient comme un décor. Je les prenais dans mes mains, elles me servaient d’outils, je prévoyais leur résistance. Mais tout se passait à la surface. Si l’on m’avait demandé ce que c’était que l’existence, j’aurai répondu de bonne fois que cela n’était rien, tout juste une forme vide qui venait s’ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà : tout d’un coup, c’était là, c’était clair comme le jour : l’existence s’était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite : c’était la pâte même des choses, cette racine était pétrie dans l’existence. Ou plutôt la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s’était évanoui ; la diversité des choses, leur individualité n’était qu’une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles en désordre – nues d’une effrayante et obscène nudité […]. Je veux dire que, par définition, l’existence n’est pas la nécessité. Exister c’est être là, simplement : les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais jamais on ne peut les déduire […]. J’étais la racine du marronnier. Ou plutôt j’étais tout entier conscience de son existence. Encore détaché d’elle – puisque j’en avais conscience – et pourtant perdu en elle, rien d’autre qu’elle […]. Le temps s’était arrêté : une petite mare noire à mes pieds ; il était impossible que quelque chose vint après ce moment-là. J’aurais voulu m’arracher à cette atroce jouissance, mais je n’imaginais pas que cela fut possible ; j’étais dedans ; la souche noire ne passait pas, elle restait là, dans mes yeux, comme un morceau trop gros reste au travers d’un gosier. Je ne pouvais ni l’accepter ni la refuser104 ».
Ces noirs dans le visible, ces gouffres qui absorbent ou rejettent, ces trous qui attirent et engouffrent, ces vagues qui déferlent et noient, ce monstre, le voici. Il est ce qui offre et retire l’apparence dans une folle débauche d’énergie centripète, dispersant le visible et centrifuge, l’absorbant. Il bat de ses flots salés, enveloppe de son écume et de son bruit, ruisselle, palpitant, gonflé, boueux, sale, écumeux, âpre, venu du fond des âges, d’outre-monde. Il est cette masse monstrueuse et molle en désordre – nue d’une effrayante et obscène nudité ; ce conglomérat de forces contradictoires dont les effets s’annulent, ne libérant in fine que pure énergie, pour elle-même. Il est L’Être. Et pour le ressentir, il faut engloutir les apparences visibles et le sujet sensible. Ainsi Courbet peint une masse nocturne qu’il perçoit comme étant lui-même et dans laquelle il baigne. Par ce vide, c’est donc le regard et l’objet du regard qui se mêlent, appréhendant la cause de la vision, au moment où ce regard était considéré comme la mort de toute image105. Pour Courbet et ses spectateurs, engloutis par les apparences, c’est l’Être qui nous est donné. Cet outre-monde, infini océan, outre espace, est celui de la plénitude de l’Être. Plénitude qui ne peut se montrer, dans sa réalité, que par la négativité : « l'invisible n'est pas non-visible provisoirement ou circonstanciellement, il est en deçà […] du visible, exclu du visible par structure ou par définition. Par structure, c'est l'irreprésentable106 ».
En ceci, non seulement Courbet est réaliste, mais, par anticipation, en phéno-ménologue du visible, existentialiste. Il eu put écrire107 : « la vision n’est pas un certain mode de la pensée ou présence à soi : c’est le moyen qui m’est donné d’être absent de moi-même, d’assister du dedans à la fission de l’Être, au terme de laquelle seulement je me ferme sur moi […]. Le propre du visible est d’avoir une doublure d’invisible au sens strict, qu’il rend présent comme une certaine absence […]. Quant à nous, notre cœur bat pour nous amener vers les profondeurs […]. Il y a ce qui atteint l’œil de face, les propriétés frontales du visible – mais aussi ce qui l’atteint d’en bas, la profonde latence posturale où le corps se lève pour voir […]. Au fond immémorial du visible, quelque chose a bougé, s’est allumé, qui envahit son corps, et tout ce qu’il peint est une réponse à cette suscitation108 ».
Ainsi, Courbet n’est pas la morte et aveugle machine daguerréotype que son temps y a vu109. Si ses noirs engouffrent son corps et le regard du spectateur, ce n’est pas pour disparaître, mais pour exister dans un « neutre »110 apte à laisser advenir la poussée de l’Être111, alors accueillie par un corps disponible à la perception, rétentif112.
Si vous regardez les paysages de Courbet, c’est pour « voir » hors de ce qui est regardé, en deçà du visible ; regarder l’apparence c’est prendre conscience de ce qui ne peut être regardé, parce qu’en deçà de tout visible, de toute apparence : l’Être même. Et cela dévale, par frayage113, en infiltration en écoulement, en résurgence, en flot puis en masse. Telle la coulée blanche du Paysage de neige avec les Dents du Midi (ill.50), cela emporte tout sur son passage : surmontée de l’écume noire des montagnes qui la presse, la neige en dévaloir va emporter l’or noir de l’arbuste central, les buissons et roches, recouvrir la rivière figée au premier plan, s’écraser et noyer le massif bosquet noir à gauche. Dans un instant ne restera qu’un agglomérat de blanc, taché de noir, piqueté d’ocres, de verts et de bleus, vague éclaffée de la pâte même de choses. La massivité noire des vues du Grammont (ill.51 et 52), réalisées lors de l’exil à la Tour-de-Peilz procède de même. La vague est devenue montagne, l’écume neige et nuage, mais celle-ci est là pour procéder à la même annihilation de l’apparence visible par le visible lui-même pour, dans la négativité obscure, nous faire déceler l’Être réel du monde.
On aura fait de Courbet le chantre du réalisme, le précurseur de l’impressionnisme, puis de Cézanne114. N’annonce-t-il pas plutôt le Quadrangle noir sur fond blanc (ill.53) de Malevitch qui affirme le primat de l’ontologie sur l’esthétique115, et de fait ouvre le champ de la question de l’Être en outre-monde de l’apparence. Ou plutôt, moins hégélien116, moins positif, plus tragique117, Courbet réaliste existentiel ne fraie-t-il pas la voie des color fields (ill.54) de Rothko118 et de l’Être apparu de Giacometti (ill.55), peignant en paysage ce que le sculpteur su modeler et peindre en figure119. Aux yeux, ou plutôt au regard troué qui perce l’apparence visible pour faire surgir cette vérité de l’Être, équivalent les noirs, gouffres, sources, résurgences, origines, vagues et dévaloirs de Courbet, l’un comme négatif120 de l’autre.
Notes
1) ↑— Georges Riat, « Gustave Courbet, peintre » in Pierre Courthion, Courbet raconté par lui-même et par ses amis, p. 227.
2) ↑— Aller de Besançon à Ornans se fait aujourd’hui en un peu plus d’une demi-heure de conduite automobile par la D67. Passant par le montée de l’échancrure de More, redescendant sur plateau des Marais de la Saône, puis remontant au long du Bois Blanc, le trajet frise le Bois du Grand Mont, atteint les plateaux à Tarcenay, se faufile entre la Charmotte et la Chassagne, passe la Tuilerie des Combes et plonge dans le Ravin du Puits-Noir. Il faut ensuite descendre la Brême encaissée entre les Bois de Narpent et ceux de sur le Grand, avant de déboucher sur la Loue et d’en remonter le cours jusqu’à Ornans qui s’ouvre, surplombé de son cirque rocheux. Faire ce parcours actuellement est aisé, mais le décrire ainsi est tenter d’en saisir ce qu’était de le faire à pied, à dos d’âne ou en calèche. C’est avec la même démarche que Courbet sera ici regardé, certes avec les outils analytiques actuels, mais sans oublier ceux de son époque, l’analyse pointant à la conjonction ressentie des deux moments des discours.
3) ↑— Les guillemets cadrant le terme de source importent, et sur ce statut nous reviendrons, laissons-les pour l’instant renfermer le mot au point qu’il puisse acquérir quelque obscurité (voir note 65 et la part de texte qui en est le renvoi).
4) ↑— Sur le statut de l’exposition personnelle payante de L’Atelier, voir en particulier Laurence des Cars, « Les Manifestes » in Gustave Courbet, catalogue de l’exposition aux Galeries nationales du Grand-Palais, p. 167.
5) ↑— L’amphibologie est, en logique, une construction grammaticale qui permet à une phrase d’avoir deux sens différents. Cette indécidabilité sémantique peut conduire à un raisonnement fallacieux sur lequel la rhétorique peu jouer comme figure de style d’ambiguïté grammaticale pouvant donner lieu à diverses interprétations d’une même phrase. (Outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue, CNTRL, Centre national des ressources textuelles et lexicales.
6) ↑— Eugène Delacroix, Journal, 3 août 1855.
7) ↑— Pour Un Enterrent à Ornans, Courbet a par ailleurs laissé témoignage écrit à Champfleury, printemps 1850, de ses conditions de travail, « sans reculée », assimilables à L’Atelier. Cité par Jean-Luc Marion, Courbet ou la peinture à l’œil, p. 61 : « Il faut être enragé pour travailler dans les conditions où je me trouve, je travaille à l’aveuglotte, je n’ai aucune reculée. Ne serait-on jamais casé comme je l’entends ».
8) ↑— Voir la description que fait Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., pp. 121-126, en particulier lorsqu’il pose que : « le spectateur reçoit l’étrange impression que toute la double scène des deux parties latérales du triptyque manque de lumière et de couleurs. Le même ocre, seulement décliné en différents tons apparentés, recouvre, comme d’une poussière ou d’une brume, tous les personnages, qui, malgré leurs personnalités très marquées, sombrent dans l’indistinction ».
9) ↑— Les indentifications de ce mannequin divergent : Saint Sébastien, Saint Barthélémy, ou un écorché inspiré de Michel-Ange ainsi que presque visible dans L’Homme à la ceinture de cuir (1845-46, Musée d’Orsay), voire une interprétation du Laocoon (en tout cas pas le Christ en croix ou en déposition). Il est plus intéressant de remarquer qu’une fois le paysage posé en pivot de la toile, ce mannequin d’atelier fait symétrie au modèle d’atelier qui fut dépeint depuis une photographie. S’opposent l’ancien travail académique sur modèle moulé et l’usage de techniques modernes de travail, la douleur de la posture de l’homme nu et l’érotisation du corps nu de la femme, le modelé assombri du corps masculin qui semble prendre chair et l’aplat trop éclairé du corps féminin qui paraît se désincarner, et in fine le regard possible de la femme sur le paysage peint et celui impossible du mannequin sur son revers.
10) ↑— Le terme anglais pour point de fuite, vanishing point, prend ici une certaine importance : il est, traduit, un point d’évanouissement, de disparition du visible. Le rendre noir, évanoui, c’est nier ou « porte[r] à son point d’achèvement le programme albertinien d’une appréhension quasi exhaustive de ce qui est visible », Bernard Vouilloux, « Les Beaux morceaux de M. Courbet » in Courbet à neuf, actes du colloque international, Musée d’Orsay, p. 196.
11) ↑— Phrases reconstruites depuis Gustave Courbet, Lettre à Champfleury, hiver 1854, citée (entre autre) dans Gustave Courbet, catalogue, op. cit., annexes, p. 446. Voir également note 15.
12) ↑— Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., p. 125 note de même : « Procéder ainsi revient à déployer une espèce de réduction et aboutit à la destruction tant du visible social et mondain (partie gauche) que du visible psychologique et subjectif (partie droite) » ; hors qu’ici ne seront plus séparés droite et gauche pour mieux lier tous les visibles décrits sous les quatre aspects socio-mondains et psycho-subjectifs. Marion cite aussi (note de la p. 123) Werner Hoffmann, Das Atelier. Courbet’s Jarhrundertbild, p. 41 : « Le peintre est le sujet conscient, les autres ne sont que des objets [mais le peintre reste] Unerkannt ».
13) ↑— Baudelaire a manifestement dénoncé ce trait dans son article « Le Public moderne et la photographie » in Salon de 1859, dont Paul-Louis Robert, « Les Empreintes photographiques de Gustave Courbet » in Courbet à neuf, op. cit., p. 120 relit le texte : « ce phénomène est la recherche exclusive par le public du Vrai […], cette comédie […] qui voit la promotion, au travers du genre historique comme du genre anecdotique issus de la peinture Troubadour, de l’amour de la réalité […]. Ce qui prime alors n’est plus le caractère, l’esprit de la représentation mais les artifices employés par les artistes – modernes – pour attester de cette réalité et ainsi étonner le public ». Robert conclu, p. 128, par : « le public n’a que très rarement suivi le peintre [Courbet] dans ses expériences ». De là, est éclairant de retourner à Jean-Luc Marion, op. cit., p. 122 : « Le tableau dans le tableau s’impose comme la monstration de la seule chose vraie et existante de tout le tableau. Le reste, pourtant dépeint en grand style, apparaît précisément comme irréel […]. Tous ces personnages restent en fait de purs fantômes, irréels ». Il cite aussi en note, p. 121, la remarque de Pierre Georgel, Courbet, Le Poème de la nature, p. 71 : « Les penseurs, comme les misérables […] ne jouissent que d’une demi-réalité. Les figures, peu empâtées ont pour la plupart une consistance faible et comme spectrale. A droite comme à gauche, chaque personnage est absorbé dans sa rêverie. Aucun geste, aucune expression n’indique d’action ou de communication véritable ». Ce trait est repris par James H. Rubin, Réalisme et vision sociale chez Courbet et Proudhon, pp. 58-59 : « Courbet souligne la matérialité de l’objet qu’il se représente en train de créer [le paysage peint]. En comparaison de ses grandes œuvres des années précédentes, la plupart des figures de L’Atelier frappent par leur caractère lisse, conventionnel et leur modelé traditionnel ; leur surface est si mince, qu’avec le temps, elles ont commencés à s’estomper. Cette rupture avec son style antérieur n’a pas échappé à Théophile Sylvestre qui écrira [in Histoire des artistes vivants, français et étrangers : Courbet, p. 265] : La peinture, si l’on excepte la femme nue et l’artiste à son chevalet, est d’un ton louche, blafard et amolli […]. Le paysage de chevalet est également peint avec la liberté et la vigueur des œuvres plus anciennes » ; hors que renvoyer cette touche au passé exprime l’ignorance des paysages postérieures à 1855, Rubin marquant comme tous les critiques attachés au réalisme social de Courbet, un dédain pour les œuvres qui suivent la percée réaliste.
14) ↑— Voir Michael Fried, Le Réalisme de Courbet, pp. 169-172 : « Loin d’être une relation […] de face à face, la relation entre la figure du peintre et le tableau posé sur le chevalet […] est particulièrement oblique […]. Le corps du peintre est dans sa quasi totalité projeté contre, et en fait englobé par, le paysage qu’il est en train de peindre, exactement comme si on devait le croire adossé au flanc de colline qui s’élève au-dessus de la rive à droite […]. Cette toile, qui représente un paysage de rivière […] s’écoule à son tour dans la figure du peintre […] ». Voir aussi note 60 et la part de texte qui en est le renvoi.
15) ↑— Beaucoup de commentaires lisent, sans relever l’ambiguïté de sa syntaxe globale, la Lettre de Courbet à Champleury, décrivant l’Atelier du peintre, hiver 1854-1855 (recueillie par Petra ten-Doesschate Chu, Correspondance de Courbet, et citée dans des sources multiples, dont « Autour de Courbet, une anthologie de textes » in Gustave Courbet, catalogue, op. cit., pp. 446-447). Le terme de « première partie » (5e ligne) est accroché à « l’histoire morale et physique de mon atelierA […] : ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mon idée, qui participent à mon actionB. Ce sont les gens qui vivent de vie, qui vivent de la mortC. C’est la société dans son hautB, dans son basC, dans son milieuD. En un mot c’est ma manière de voir la société et ses passionsA ». La « première partie » est donc toute l’allégorie réelle de l’Atelier (A), puis la partie droite de la peinture (B), puis la gauche (C), la droite (B), la gauche (C), le milieu (D) et toute l’allégorie à nouveau (A). Dans cette « première partie » Courbet a introduit la description de tout son tableau (A, B, C, B, C, D, A), non de sa première partie, souvent lue comme la partie gauche seule (C).
Il fait suivre cette introduction d’une description plus précise de la peinture, qui va reprendre les points précédents en une autre séquence (A, D, B, C, D, B), énonçant que « le tableauA est divisé en deux parties. Je suis au milieu peignantD, à droite tous les actionnairesB […], à gauche l’autre monde de la vie trivialeC […] ». Courbet ajoute une longue description des figures de gauche (environ 26 lignes), puis change de paragraphe. Et là il écrit : « seconde partie. Puis vient la toile sur mon chevalet et moi peignantD […] », à la suite de quoi il décrit les figures de droiteB. Ce terme de « seconde partie » relève de la même amphibologie que son tableau de paysage dans le tableau de l’atelier en ce qu’il fait croire se rapporter à celui de « première partie », alors qu’il se rapporte aux deux parties de la division du tableau énoncées au début du paragraphe, sans que cette partie première ne soit nommée.
Recomposons l’essentiel de la phrase pour permettre quelque clarté : c’est l’histoire morale et physique de mon atelier, première partie, ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mon idée, qui participent à mon action. Ce sont les gens qui vivent de vie, qui vivent de la mort. C’est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot c’est ma manière de voir la société et ses passions.
Le tableau est divisé en en moitié droite et gauche. Je suis au milieu peignant ; à droite tous les actionnaires, à gauche l’autre monde de la vie triviale (description de la moitié gauche). Moitié droite (et non seconde partie), vient la toile sur mon chevalet et moi peignant (description de la moitié droite), sur laquelle in fine Courbet revient pour dire : « je vous ai fort mal exprimé tout cela, je m’y suis pris au rebours. J’aurais dû commencer par Baudelaire, mais c’est trop long pour tout recommencer ».
Cette relecture détache radicalement le terme de « première partie » de la description d’une première partie (gauche) de l’image, qui serait suivie par sa deuxième partie (droite). Il permet par contre de l’attacher au « titre » ou à l’intention de l’œuvre : « c’est l’histoire morale et physique de mon atelier, première partie, ce sont les gens […], c’est la société […], c’est ma manière de voir la société », histoire déterminant une phase de sept années de ma vie artistique, histoire maintenant passée. La « seconde partie suivra » et sera autre. L’Atelier établit un bilan avant de passer à autre chose : essentiellement les paysages des creux de la Loue, de la Brême ou du Lison, paysage qui s’annonce en amphibologie dans L’Atelier comme dans la lettre. Ainsi il relève du lapsus que Courbet écrive : « seconde partie. Puis vient la toile sur mon chevalet et moi peignant [ce paysage] avec le côté assyrien de la tête ». Ce rapport primordial au paysage sera bien la seconde partie qui suivra le bilan deL’Atelier, seconde partie de carrière où fier assyrien, Courbet seul se confronte au tréfonds de la nature, de la toile et de la peinture, hors de la mondanité.
Dernier point sur le sujet, dans sa lettre, Courbet évoque les peintures d’arrière plan et celle qu’il peint : « dans le fond, contre la muraille, sont pendus les tableaux du Retour de la foire, Les Baigneuses, et le tableau que je peins. C’est un tableau d’ânier qui pince le cul à une fille qu’il rencontre et des ânes chargés de sacs dans un paysage avec moulin ». Hors l’intention écrite de la lettre programmatique, ce qui sera visible est : seront pendus des tableaux esquisses de paysages futurs, « seconde partie », et non les tableaux passés, « première partie » ; et loin de l’ânerie populacière et sociale planifiée, dans un rappel de cette première partie mondaine, avec pince-fesse et moulin, un pur paysage, indiqué par le pinceau du peintre, qui, là, nous montre sa seconde partie, outre trivialité, populasserie, discours social ou mondain.
16) ↑— Il s’agit ici plus de marquer un changement de tendance et d’attitude qu’une rupture et un basculement, voir par exemple le décrié Retour de la Conférence (1863, détruit) et de certaines Chasses, dont La Curée (1856, Museum of Fine Arts, Boston), conçues comme véritables scènes de genre à destination du Salon. Voir également note 19.
17) ↑— Portraits « de commande » ou vendables (voir note 87), tel par exemple Le Portrait de Mme de Brayer (1858, Metropolitan Museum of Art, New York) et en matière d’autoportrait le retour sur soi que doit entreprendre pour lui Courbet après son incarcération à Sainte-Pélagie (Portrait de l’artiste à Saint-Pélagie, 1872-73, Musée Courbet, Ornans). Voir également note 19.
18) ↑— Bruno Foucart, Courbet, Tout l’art, p. 36, note la similitude entre retrait du sommeil avec celui des paysages : « Courbet aime à peindre ces dormeuses, ces assoupies, comme il aime peindre la profondeur et le calme des sous-bois, la vasque des sources. Cet extraverti, ce sanguin, grand raconteur d’histoires énormes et sonores, cet agitateur d’idées révolutionnaires est en fait et dans son intime le poète de la paix, du silence, de ce paradis perdu des origines où tout est clame, simplicité et dormition ». Voir aussi Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., pp. 70-71 et son renvoi à l’étude de René Huyghe, « Courbet » in Catalogue d’exposition Gustave Courbet. Voir également note 64.
19) ↑— « Mondain » est de fait ici compris dans l’entier du spectre de sa définition (CNTRL, op. cit.). Sociale : qui est propre à la société des gens en vue, à ses habitudes et à ses divertissements ; qui fréquente le monde et aime les mondanités ; qui adopte les usages en vigueur dans la société des gens en vue. Matérialiste : qui est attaché aux biens et aux plaisirs de ce monde, qui témoigne de cet attachement. Philosophique : qui appartient au monde, au siècle, par opposition aux choses religieuses. Il est important de noter que Courbet n’a jamais cessé d’être un homme « mondain », cherchant comme artiste l’acceptation d’une « certaine société » ou défendant comme citoyen des idées politiques « matérialistes et sociales », s’engageant même pratiquement en 1870 pour la République et en 1871 dans La Commune ; et que c’est bien sa peinture, soit la recherche artistique de Courbet, qui comme clivée des engagements de l’homme Courbet, glisse outre-monde. Voir aussi note 40.
20) ↑— Sur L’Enterrement, voir notes 27 et 28, et la part de texte qui en est le renvoi.
21) ↑— Voir Timothy J. Clarck, Image of the People : Gustave Courbet and the 1848 Revolution, postscript, pp. 155-161 ; il s’agit ici de penser à l’inverse d’une pensée politique de l’art qui permet à Clarck de congédier quasi toute la production de Courbet postérieure à 1855.
22) ↑— Voir Micheal Fried, Le Réalisme, op. cit., p. 15 : « Après l’avènement de Manet au début des années 1860, la peinture de Courbet cessa d’être une source d’innovation au sein de l’avant-garde française et, en partie pour cette trahison, des critiques contemporains affirmèrent parfois qu’elle avait perdu son tranchant. On ne saurait non plus nier que, dès la seconde moitié des années 1850, sa peinture trahit des préoccupations moins manifestement sociales […] ».
23) ↑— Voir Paul Galvez, « Painting at the Origin » in Symposium Looking at the Landscapes ; Courbet and Modernism : « It is striking how much Courbet avoids the long expansive views to be found on the plateau of Flagey. His first strategy could therefore be called one of downward descent. His eye gravitates to sites naturally corralled. Usually he even accentuates their enclosure ».
24) ↑— Voir à ce propos les descriptions de Laurence des Cars et analyses de Thomas Galifot, Gustave Courbet, catalogue, op. cit., pp. 227-229, 232-233, puis 241-242 : « Le peintre s’est placé au plus près de son motif […] contrarié par cet écran végétal, le regard s’échappe difficilement […], si le sentiment de claustrophobie n’est pas très loin […] la toile de Courbet se veut avant tout une évocation de l’énergie vitale qui sourd du tissus végétal […]. Les troncs centraux sont ainsi le pivot d’une composition basée sur un double mouvement, vers l’extérieur avec le ruisseau qui semble se déverser hors du cadre, vers les profondeurs où le regard s’enfonce […]. Dans un effet de fenêtre ouverte au hasard sur la nature, l’œil se heurte à un mur de roche et de végétation qui, évacuant là encore presque entièrement le ciel, vient épouser le plan de la toile. Courbet prend le contre-pied de la convention voulant que la lumière occupe le cœur du tableau et […] base sa composition sur un trou d’ombre central qui aspire le spectateur ». Reste que l’approche de ces critiques est sensualiste, au service d’un pur discours esthétique et formel.
Si pour Bruno Foucart, Courbet, op. cit., p. 111, « le noir […] exprime la profondeur, la vie sourde […] », plus loin mène l’analyse de Klaus Herding, « Traits de lumières d’outre-Rhin jetés sur la réception de l’artiste » in Courbet à neuf, op. cit., pp. 210-215 : « ce désir de laisser le monde en suspens pour plonger dans les abîmes de sa propre existence montrait bien combien la portée du terme réalisme était restreinte. A quelques exceptions près, on n’avait guère analysé la noirceur silencieuse des peintures à la texture épaisse et aux couleurs sombres de Courbet […]. Aujourd’hui, on reconnaît que Courbet a révolutionné la notion de peinture et l’on attribue un sens profond même aux trous, aux endroits creux et vides dont certains de ces tableaux abondent ». Voir aussi du même auteur, « The More you approach Nature, the More you must Leave it : Another look at Courbet’s Landscape Painting », Symposium, op. cit. : « Introspection was as important to the painter as was provocation ; these were two complementary forces to him, and I should even add : introspection was a kind of provocation, if applied to figures, since it prevented them from appearing all too pleasant or conformist. If applied to landscapes, introspection results in an expression of autonomy, self-enjoyment, or, sometimes, resistance against the central power […]. Not only did Courbet keep nature alive, but by shaping it through abstract patterns, his landscapes were best suited to describing his feelings, to expressing the painter’s relationship to the world. In this respect, nothing is more explicit than the silence of his dark and introspective Black Well pictures, where the beholder is invited to dive into the painter’s inner life ».
Voir encore Paul Galvez, « Painting at the Origin », in Symposium, op. cit. : « While in the Black Well series individual trees and rocks are easily recognized, they are oases of stability in an otherwise pulsating vortex of hesitant forms and black holes, where craggy outgrowths, verdant canopies, and mossy embankments creep out toward the beholder. Their stealthy approach seems to warp space around them, initiating an imagination of space running from uppermost leaf all the way to the stream’s watery depths. Add to this the undifferentiated dark areas near the center and middle ground, and it is hard not to feel that the entire image field is somehow in flux, convulsing, as if powered by an invisible bellows ».
25) ↑— Bruno Foucart, Courbet, op. cit., p. 110.
26) ↑— Bernard Vouilloux, « Les Beaux morceaux de M. Courbet », in Courbet à neuf, op. cit., p. 204.
27) ↑— Sur le précipice du Fou de peur, voir Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., p. 67 : « [Courbet] paraît bondir directement vers le spectateur et, considérée dans sa totalité, l’image laisse penser que c’est la contemplation de l’abîme qui s’ouvre devant lui qui l’a poussé à ce geste de folie […]. Il peut s’interpréter comme une thématisation du sentiment qu’a le peintre, je crois, du gouffre vertigineux qui sépare le modèle du spectateur et au bout du compte, ajouterai-je, la peinture du spectateur ». Que de prudence dans les mots, alors que c’est cette séparation qui devrait autrement ce thématiser.
28) ↑— Sur la béance de L’Enterrement, voir Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., pp. 128-129, en particulier l’idée que « la vallée et la fosse […] répondent à un certain désir d’excavation et de comblement […] ».
29) ↑— Timothy J. Clarck, Image of the People, op. cit., p. 82.
30) ↑— Etienne-Jean Delécluze, « Exposition de 1851 » in Journal des débats, cité par Paul-Louis Robert, « Les Empreintes photographiques de Gustave Courbet » in Courbet à neuf, op. cit., p. 126.
31) ↑— Eugène Bonnassieux, « Beaux-Arts. Salon de 1850-1851 » in Journal des femmes, cité par Paul-Louis Robert, idem.
32) ↑— Frédéric Henriet, « Beaux-Arts. Salon de 1851 » in Le Théâtre, cité par Paul-Louis Robert, idem.
33) ↑— Edmond et Jules de Goncourt, Etudes d’arts. Le Salon de 1852 – La Peinture à l’Exposition de 1855, cités par Paul-Louis Robert, idem, p. 128.
34) ↑— Phrase de Courbet recueillie par Max Claudet, Souvenirs, Gustave Courbet, cité par Bruno Foucart, Courbet, op. cit., p. 111.
35) ↑— Max Claudet, idem, cité par Manuel Jover, « Noir Courbet » in Art absolument, n°22, p. 65.
36) ↑— Théophile Sylvestre, Histoire des artistes vivants, op. cit., p. 270, cité par Bruno Foucart, Courbet, op. cit., p. 110.
37) ↑— Lettre de Courbet à ses parents, avril 1845, citée par Bruno Foucart, idem, p.11.
38) ↑— Pierre-Joseph Proudhon, Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère, chapitre XIII, IIIe partie, section 2 : « Travailler c’est dépenser sa vie ; travailler en un mot, c’est se dévouer, c’est mourir. Que les utopistes ne nous parlent plus de dévouement : le dévouement c’est le travail, exprimé et mesuré par ses œuvres… L’homme meurt de travail et de dévouement, soit qu’il épuise son âme […] dans un effort d’enthousiasme ; soit qu’il consume sa vie par un travail de cinquante ou soixante années […]. Il meurt parce qu’il travaille ; ou mieux, il est mortel parce qu’il est né travailleur ; la destinée terrestre de l’homme est incompatible avec l’immortalité ».
39) ↑— Voir à ce propos l’étude de Gilbert Titeux, « L’Inquiétante étrangeté de certaines chasses franc-comtoises », in Courbet à neuf, op. cit., pp. 259-279. Il démontre en particulier les méthodes de travail des scènes animalières, pp. 262-265.
40) ↑— Entendre ici autant le drame pictural qu’humain, suite à l’incarcération de Courbet à Sainte Pélagie, puis à la clinique de Neuilly. Ce pour sa participation au Conseil de la Commune comme délégué à l’instruction publique, président de la Fédération des artistes ; et avant que le seul chef d’accusation retenu contre lui n’ait été de s’être rendu complice, par abus d’autorité, de la destruction de la colonne Vendôme, dont il avait suggéré la destruction six mois avant le début de la Commune. Preuve que l’homme Courbet n’avait cessé d’être actif politiquement, mondainement réaliste, alors que l’artiste ne s’occupait plus en peinture de réalisme politique et de mondanité (voir aussi note 19). Le remboursement de la colonne auquel il sera alors condamné justifie-t-il l’exil, ce remboursement étant de toute façon impossible, ou cet exil à La Tour-de-Peilz ne manifeste pas plutôt la crainte qu’une nouvelle incarcération se déroule sous le même régime que celle de Sainte-Pélagie ? À savoir : interdiction de peindre, puis autorisation matériellement extrêmement limitée. Sur les conditions d’incarcérations du peintre, voir Bertrand Tillier, La Commune de Paris, révolution sans image ? - Politique et représentations dans la France républicaine, pp. 150-152.
41) ↑— Charles Sterling, La Nature morte, de l’Antiquité au XXe siècle, p. 90, cité par Laurence des Cars, « L’Expérience de l’histoire, Courbet et la commune » in Gustave Courbet, catalogue, op. cit., p. 424.
42) ↑— Pour Courbet comme pour son cercle d’influence, dont Proudhon, 1848, puis 1871 ne sont que les suites de la révolution entamée en 1789, encore inachevée. Sa fin est bien perçue comme une remise à zéro de l’histoire, sous le regard de Chronos-Saturne, tel que le montre la caricature de Proudhon par Cham (1818-1879), P-J Saturne dévorant ses enfants (Bibliothèque nationale de France, Collection de Vinck). Voir aussi l’ample thèse de Chakè Matossian, Saturne et le sphinx, en particulier : p. 147 sqq. « Art et révolution, le degré zéro du langage artistique ». Voir encore note 46 et la part de texte qui en est le renvoi.
43) ↑— Manières de tables décrites, entre autre, par Théophile Sylvestre, Histoire des artistes vivants, op. cit., pp. 249-251 (le dîner à Pontoise) et analysées par Bertrand Tillier, La Commune de Paris, op. cit., p. 45, comme : « l’image forcée dès avant la Commune, du gros mangeur, gros buveur (de bière), gros paysans comtois, volubile et tonitruant, bon vivant, chasseur et amateur de gibier ». La question est aussi largement abordée par Frédérique Desbuissons, « Le matérialisme de Courbet » in La production de l’immatériel, pp. 399-405, qui définit médicalement la maladie d’hydropisie de Courbet : ascite du cirrhotique (voir note 59).
44) ↑— Frédérique Desbuissons, « La Chair du réalisme : le corps de Gutave Courbet », in Courbet à neuf, op. cit., pp. 76-78. Pour sa citation d’Alexandre Dumas fils, Lettre sur les choses du jour, 6 juin 1871, p. 16 ; pour celle de Camille Lémonnier, Gustave Courbet et son œuvre, p. 46.
45) ↑— Il faut ici renvoyer au concept topologique de la Bouteille de Klein, tel qu’utilisé par Jacques Lacan, qui un temps possédera L’Origine du monde (voir notes 78, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 93 et les parts de texte qui en sont le renvoi). Voir en particulier Problèmes cruciaux de la psychanalyse et D’un Autre à l’autre.
46) ↑— Courbet s’est intéressé à Saturne lorsqu’il peignit en 1865, de manière posthume, Proudhon (Proudhon et ses enfants, 1865, Musée du Petit Palais, Paris) en penseur mélancolique, portrait qui fait dire à Chakè Matossian, Saturne et le sphinx, op. cit., après le long développement du chapitre « Proudhon ou la mélancolie de Courbet », p. 23 sqq. : « il est surtout difficile de ne pas voir dans le portrait de Proudhon […] une évocation de Saturne comme celle de Girolamo Da Santa Croce, s’inscrivant à la suite de celle de Campagnola, associant Saturne et le monde paysan. La blouse de Proudhon contribue à donner à son portrait un aspect saturnien […]. En peignant le jeu d’eau de la fille cadette, Courbet marque peut-être une réminiscence de la tradition du Moyen-Age et dont la gravure de Campagnola se fait l’écho, associant Saturne à un fleuve de même que, pour la tradition pythagoricienne et orphique, à laquelle n’est pas étranger Proudhon [ni ne peut l’être un peintre qui a quelque connaissance des humanités] qui affirme […] suivre les préceptes pythagoriciens, Chronos règne sur les eaux et les rivières […]. Proudhon détient les caractéristiques du dieu ambivalent, il apparaît comme le descendant de Chronos-Saturne, personnalité hybride résultant de l’association du Chronos grec (négatif) et du Saturne romain (positif) […]. Chronos fait partie du travail même de Proudhon, de ses projets éditoriaux à visée universelle et cosmique. Il tient à produire une Chronique de l’humanité […] dans laquelle il inclurait une cosmogonie. Cet ouvrage en chantier, Proudhon veut l’intituler Kronos » (pp 60-64). Ajouter que Chronos-Saturne fait partie du travail même de Courbet, régnant sur les rivières, origine et fin, les gouffres et, on le verra, les vagues, relève du complément.
47) ↑— Sur les filiations Chronos-Saturne, voir The Orphic Hymns, Hymn 6, retraduit ici : « Tu as dispersé la brume sombre qui se trouvait devant tes yeux et, battant tes ailes, tu tourbillonnais, et c’est toi qui dans tout ce monde a apporté la lumière pure. Pour cela, je t’appelle Phanès ». (ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην πάντη δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον λαμπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν , ἀφ ‘ οὗ σε Φάνητα κικλήσκω).
48) ↑— Phrase de Courbet recueillie par Théophile Sylvestre, Histoire des artistes vivants, op. cit., p. 270, citée par Bruno Foucart, Courbet, op. cit., p. 111.
49) ↑— Bruno Foucart, idem, p. 111.
50) ↑— Pour reprendre le paradoxe énoncé par Courbet à propos des figures de L’Atelier, Lettre à Champfleury, op. cit., voir notes 11 et 15.
51) ↑— Voir Paul Galvez « Landscape and phenomenology » in Courbet à neuf, op. cit., pp. 170-171 : « Notice how the rock at the bottom-right corner of the Orsay Ruisseau couvert is not circumnavigated by any contour. With the exception of the tree trunks rendered with a single stroke, Courbet avoids full outlines. It is up to the viewer to assemble the marks into an object. This is true of many of his rocks […] it is not the extra application of paint, but the way the ground is incorporated into forms that gives them weight and heft. Sometime, as in the Ruisseau couvert rocks, the ground invades the figure as a liquid fills its container. Sometimes it is made to function as a kind of interstitial space, not part of any figure, but at the same time not mere background either. It plays the role of the in-between in all those landscapes […] where the center is empty and goes unnoticed. Most powerfully, it initiates a cleavage from within the fabric of the image […] ». Voir également note 62 et la part de texte qui en est le renvoi.
52) ↑— Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., pp. 147-150 différencie dans L’Enterrement deux points de vue structurels : celui du peintre-spectateur et celui du spectateur-de-peinture ; ce idéologisé par son discours « antithéâtral ». Il tend à plier ses descriptions à l’idée à priori qui le gouverne ; voir Absorption and Theatricality. De fait Fried est toujours dans une théorie de la représentation, des figures et de la mise en scène, ce qui le pousse à écrire dans Le Réalisme, op. cit., p. 236 : « même si Courbet fut un maître dans l’art de peindre des paysages, il ne fut pas essentiellement paysagiste mais peintre de figures : le sens des paysages n’apparaît tout à fait qu’en regard de ses peintures de figures. Telle est la raison essentielle du rôle secondaire accordé dans cette étude aux paysages ». Raison contre laquelle cet essai s’inscrit en faux : le drame que mettent en place les structures paysagères de Courbet n’a rien à voir avec le théâtre ou son antithèse, avec la mise en scène et les figures. Il a à voir avec la peinture et la question de la visibilité (voir, pour conclure, note 119), parce que Courbet n’est pas dans l’ordre de la représentation image, mais bien, ce qui Fried oublie, du réalisme pictural.
53) ↑— Voir le concept d’invu chez Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., qui écrit p. 26 : « Ainsi, le geste de peindre précède le regard identifiant la chose, qui trouve son identité après avoir été peinte ; son apparition sur la toile ne reproduit pas ce que l’on saurait déjà, si on l’avait connue d’un regard objectivant, mais consigne sa pure apparition – apparition et non apparence d’ailleurs, car l’identification objective qui suivra la confirme comme une parence (un eidos) authentique ; au contraire d’une apparence, il s’agit de l’apparition de la chose avant son identification comme un objet déjà bien connu par le regard. En ce sens, le peintre ne sait pas ce qu’il peint, du moins ne le sait pas d’un savoir théorique, objectivant, indépendant de l’apparition elle-même ; il peint ce qui se met en lumière et en évidence par soi-même, connu ou non ; on peut donc dire que la chose se montre d’elle-même, sans aucun concept regardé qui la précède. [Et citant Courbet] : Quand je le (l’éclairage le plus vif) verrai la chose sera faite sans que je le veuille. (Francis Wey, Courbet, Ecrits, propos, lettres et témoignages, pp. 280-281) ».
54) ↑— Pierre-Joseph Proudon, Du Principe de l’art et de sa destination sociale, p. 22 : « En premier lieu, de ce que notre âme a la faculté de sentir, à première vue et avant toute réflexion, indépendamment de tout intérêt, les belles choses, il s’ensuit, au rebours de ce qu’enseignent de grands philosophes, que l’idée du beau n’est pas en nous une pure conception de l’esprit, mais qu’elle a son objectivité propre ; en autres termes, cette beauté qui nous attire n’est point chose imaginaire, mais réelle. En sorte que l’art n’est pas simplement l’expression de notre esthésie, qu’on me passe ce néologisme ; il correspond à une qualité positive des choses ». Passage que Chakè Matossian, Saturne et le sphinx, op. cit., commente ainsi, p. 73 : « l’esthésie, capacité de découvrir le beau et le laid, se définit comme une réaction physiologique d’attraction/répulsion et précède toute réflexion. Il y a une objectivité de l’attirance qui fait que la beauté n’est ni une idée, ni un produit de l’imagination, mais qu’elle est bien réelle en tant […] qu’efficace de l’image et, en conséquence, trame ou arrière-plan de toute image à venir. L’art surgit ainsi comme l’écho de cette réalité de la nature dont Proudhon démontre le mécanisme ».
55) ↑— Sur la neutralisation du moi, voir Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., pp. 69-95, en particulier : « L’épokhè suspend le prima de cet ego, en l’exposant directement au donné antérieur du monde, qui ne constitue plus la collection statique, éventuellement totale et totalisante, des objets, mais surgit comme un événement. Le monde advient sans se laisser constituer en un objet ou par une somme d’objets, donc sans plus dépendre d’un sujet le constituant. Le monde apparaît pour autant qu’il advient a-subjectivement à la vue qui s’y adonne ». Et plus loin, pp. 197-198 : « Ce qui implique […] que le peintre ne créé pas tant le visible qu’il n’enregistre la montée vers lui des invus toujours inattendus et jamais pré-vus. Témoin de ce qui se montre par soi plus que fabricant d’un visible à consommer, il laisse passivement apparaître ce qui […] se constitue sans que la main de l’homme ne l’ait produit (acheiropoïète). Car, si le phénomène se montre en soi et de soi […], alors le tableau doit finir par accomplir absolument la chose même, sans autre soi que le sien. Il s’ensuit une disparition, ou du moins un retrait extrême de tout autre soi, en particulier du moi du peintre et même du spectateur ». Voir aussi Maurice Blanchot, « René Char et la pensée du neutre » in L’Entretien Infini, pp. 439-450, et en particulier, dès la p. 447 la partie « Parenthèses ».
56) ↑— Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur (seconde version), pp. 15-18. Il est évident que Courbet ne pouvait rien connaître de l’existentialisme, de la phénoménologie ou de l’ontologie heideggérienne (voir notes 104 et 117) ; mais à y voir de près, une filiation peut s’énoncer de Blanchot, Sartre au surréalisme, de là à Maupassant, qui rencontra Courbet, dont la nouvelle fantastique du Horla (1886) annonce le vertige existentiel de Thomas. De même, l’appel se tourne vers Poe, dont Une Descente dans le Maelstrom, traduit en 1841 par Baudelaire, relation de Courbet, manifeste le même vertige.
57) ↑— « Par définition, une signature écrite implique la non-présence actuelle ou empirique du signataire. Mais, dira-t-on, elle marque aussi et retient son avoir-été présent dans un maintenant passé, qui restera un maintenant futur, donc dans un maintenant en général, dans la forme transcendantale de la maintenance », Jacques Derrida, Marges de la philosophie, p. 391.
58) ↑— Il ne paraît pas impossible de voir dans ces bassins une relecture « sous les plateaux » du Château d’Ornans ou Fontaine d’Ornans, Le Bassin aux vipères, manifeste des vues « sur les plateaux ». Mondaine, la scène d’Ornans reflète dans le bassin la clarté du ciel, ce à quoi répondent, en outre-monde, les bassins de Fouras qui n’ont pour reflet que les feuillages ; la perspective descend les creux des collines pour mieux s’ouvrir au-dessus des valons sur le ciel, à l’inverse elle se ferme sur un pan vertical de falaise et l’absence de tout ciel ; claire, la scène d’Ornans s’ouvre au monde des apparences, panorama paysagé, celle de Fouras, sombre, est engouffrée dans le monde réel, condition de notre enfermement ici même.
59) ↑— Rétentif : faculté de capter et de retenir par l’esprit, mémoire CNTRL, op . cit.). À ce propos, rappelons que si Courbet peint sur le motif, la plupart de ses tableaux sont poursuivis, voire intégralement repris, en atelier, soit de mémoire. Il est aussi à noter que l’ascite du cirrhotique, dont souffrait Courbet (voir note 43), est une maladie de la rétention : un excès d’eau se localise dans cavité péritonéale (la cirrhose, due à une trop grande absorbtion – captation – d’alcool en est le plus souvent la cause), voir L’Ascite, Centre Hépato-Biliaire Paul Brousse.
60) ↑— Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., p. 171-172 note à propos du paysage de L’Atelier, que « cette toile, qui représente un paysage de rivière […] s’écoule à son tour dans la figure du peintre : comme si le mouvement implicite […] du corps du peintre dans la peinture avait sa réciproque ou qu’il était peut-être anticipé par un contre-mouvement de la peinture à l’extérieur, vers le peintre. [… Ce] sont autant de métaphores visuelles de l’écoulement, de la chute et de la turbulence des eaux dont la source est la peinture même […] ». Mais, s’agissant du sens de la métaphore, Fried n’en dit rien, alors qu’il semble bien essentiel à la compréhension du sens des paysages : l’eau est, éclairée, le visible absolu, blanc, qui s’infiltre ou s’exfiltre de la noire invisibilité.
61) ↑— Cette médiation de l’eau n’est pas éloignée de celle présente dans les lacs de Nicolas Poussin, en particulier dans Le Paysage d’orage avec Pyrame et Thisbé (1651, Städel Museum, Francfort), dont Louis Marin, « Déposition du temps dans la représentation peinte » in Nouvelle revue de Psychanalyse, 1990, N°41, p. 62 (repris sous une autre forme dans De la représentation, p. 299), dit que : « […] le lac central, inaltéré dont la surface calme reflète imperturbablement dans une immobile durée, les apparences des choses et des êtres en proie à l’instant […]. Figure de la théorie [et] image de la représentation, le lac renvoie à l’œil du peintre et du spectateur le regard apathique du tableau et en constitue le sujet en son lieu de contemplation ». Hors que chez Courbet, comme par renversement du sublime poussinien, le lac renvoie le tableau au regard apathique du peintre et du spectateur, dont l’œil est noyé dans le réel (ou son rendu perceptif) en attente de la parution des êtres et des choses.
62) ↑— Voir note 51 : adaptation de la conclusion de Paul Galvez, « Landscape and phenomenology » in Courbet à neuf, op. cit., p. 171 : « […] a kind of interstitial space, not part of any figure, but at the same time not mere background either. It plays the role of the in-between in all those landscapes […] where the center is empty and goes unnoticed. Most powerfully, it initiates a cleavage from within the fabric of the image. […] For the viewer […][a] ‘vague life’ transpires […] by attending to the area in-between forms, to what goes ‘unformed’ in the depths of Courbet’s landscapes […] ».
63) ↑— Si La Source à Fouras est relecture « sous les plateaux » du Bassin aux vipères (Le Château d’Ornans), il en va de même de La Source, relativement à celle d’Ingres et de sa Baigneuse Valpinçon. À la peinture image, miroir des apparences idéalement formées, Courbet répond par une peinture procès, informée d’un réel où elle puise la parution.
64) ↑— Hellénisation volontaire de Morphée (μορφεύς / μορφή), pour rendre à la fois le concept de forme, morphologie, l’état physiologique de retrait, amorphe, et la divinité du sommeil et des rêves (voir note 18). Morphée est par ailleurs engendré par Nyx (voir note 47 et la part de texte qui en est le renvoi).
65) ↑— André Berthelot, « Sur les origines de la source de la Loue » in Comptes-rendus de l’Académie des Sciences, Volume 12, pp. 394-397 ; confirmé par les expériences de Martel et Fournier (1910), voir Édouard-Alfred Martel, Nouveau traité des eaux souterraines.
66) ↑— Pour une histoire de l’eau de Salins et une étude de ses caractéristiques, voir Camille Laissus, Notice historique, physico-chimique et médicale sur les eaux thermales chlorurées de Salins, pp. 1-13.
67) ↑— Sur le discours positiviste du réalisme social, voir Chakè Matossian, Saturne et le sphinx, op. cit., en particulier pp. 190-196 : « L’adoption de la philosophie pratique pythagoricienne devient la manière de transformer en conclusion nécessaire ce qui est énoncé d’un ton prophétique. L’avenir est splendide devant nous, déclare Proudhon [Du Principe de l’art et de sa destination sociale, op. cit., p. 17], établissant une liste de constructions à effectuer pour la réalisation de cette splendeur à venir, entendue comme concrétisation des utopies de Fourier. En écrivant : un jour les merveilles prédites par Fourier seront réalisées [idem, p. 374], Proudhon […] annonce la réalisation prochaine des prédictions faites par un autre tout en cherchant à convaincre le lecteur qu’il se situe dans le champ de la démonstration ». Sur Proudhon et le positivisme, voir aussi notes 68 et 69.
68) ↑— Sur la notion de travail et les filiations entre Proudhon, Saint-Simon, Fourier, Comte et le positivisme, voir James H. Rubin, Réalisme et vision sociale, op. cit ., pp. 51-57, 113-119 et 132-133 : « Critiquant l’apriorisme, qui avait marqué l’éclectisme de Cousin et d’autres, Proudhon écrit dans La Philosophie du progrès [p. 93] : Divin Platon, ces dieux que tu rêves n’existent pas. Il n’y a rien au monde de plus grand et plus beau que l’homme. Mais l’homme, sortant des mains de la nature, est misérable est laid : il ne devient sublime et beau que par la gymnastique, la politique, la musique, et surtout chose dont tu ne parais guère te douter, l’ascétique. (Par ascétique, il faut entendre ici l’exercice industriel, ou le travail réputé servile et ignoble chez les anciens). C’est à travers diverses formes d’activité naturelle, en particulier par le travail, que l’homme s’ennoblit […]. Car, avec le développement du travail, son produit s’approche toujours d’avantage de son type parfait. Et Proudhon d’apostropher Platon : Qu’est-ce que le Beau ? avant de répondre : Tu l’as dit toi-même : c’est la forme pure, l’idée typique du vrai. L’idée, en tant qu’idée, n’existe que dans l’entendement ; elle est représentée, réalisée avec plus ou moins de fidélité et de perfection, par la nature et l’art ». Citons encore Proudhon, Du Principe de l’art, op. cit., pp. 190-192 : « l’art, devenu rationnel et raisonneur, critique et justicier, marchant de pair avec la philosophie positive, la pensée positive, la métaphysique positive […] ne peut plus être fauteur de tyrannie, de prostitution et de paupérisme ». De là Proudhon définit son positivisme en art comme vérité et observation, et énonce que l’art « travaille à la déification des hommes, tantôt par la célébration de leurs vertus et de leurs beautés, tantôt par l’exécration de leur laideur et de leurs crimes » (Philosophie du progrès, op. cit., p. 94), citant en exemple Les Paysans de Flagey, auxquels ont pourrait ajouter d’autres scènes de travail de Courbet, comme Les Casseurs de pierre ou Les Cribleuses de blé. Ce sont pourtant les rares scènes de travail montrées par le peintre qui leur préfère un travail absent dans l’endormissement de La Fileuse (1853, Musée d’Orsay, Paris), un travail passif, avec ses pêcheurs devant les sources, un travail joueur tout au plus, dans les scènes de chasse ; voire l’absence de tout travail et intervention humaine dans la plus grande partie des paysages. Ici seule règne l’activité naturelle et non le travail, que Proudhon considère naïvement (tel que Marx le critiquera dans Misère de la philosophie) comme une « activité naturelle » (voir note 71). Chez Courbet, ne règne que la forme « naturelle », soit réelle et non « la forme pure, l’idée du vrai » ; la captation sensible du réel et non sa conceptualisation en idée. Le peintre n’a ni rationalité ni raison mais une pure perception qui à l’inverse noie la maîtrise raisonnable de l’ego ; il n’est ni critique ni justice mais l’affirmation de l’état de fait : l’homme, le travail, le moi n’est rien, seul ce gouffre qui avale et éjecte est. Et il n’est question ni de représentation ni de réalisation, s’agissant d’une présentation picturale, d’une parence (eidos, voir note 53) qui se constitue comme si la main de l’homme ne l’avait produit (acheiropoïète, voir note 55), de fait sans travail et hors toute réalisation.
69) ↑— Imaginée par Claude-Nicolas Ledoux en 1804, La Maison des Directeurs de la Loue (ou des Surveillants de la source de la Loue) pose à peine en contrebas de la résurgence un bâtiment en cylindre creux traversé par la cascade des eaux. Naturelle en amont, la chute des flots est domestiquée en aval, par cette architecture symétrique qui repose sur un socle en double gradin. La Vue Perspective présente ensuite un cours d’eau aux rives à priori naturelles, bordées de deux rustiques moulins et d’un pittoresque arbre. Pourtant ce cours apparaît singulièrement plat, et s’ouvrir sur une plaine qui ne correspond en rien au paysage de la source. Ou le site n’est pas à la source, mais bien plus bas, près d’Arc-et-Senans, ou Ledoux n’avait jamais vu la source (ou n’a que faire de l’avoir vue), se contentant d’une vue d’esprit du site, ou encore l’architecte avait pour vision d’aplanir à forces de gigantesques travaux le val de la Loue. Conservons un instant cette vision, pour observer sa Maison depuis le seul lieu où elle se donnera à voir, en aval et de dessous et cette fois de face. L’on verrait une chute d’eau juste naturalisée par quelques pierres tombées à son pied, chute canalisée en rayons quasi solaires, sortie d’un parfait anneau circulaire blanc. Cette pure forme architecturale se découpe sur la falaise bien plus sombre et a surtout pour effet de cacher le naturel gouffre noir de la résurgence. Ce cercle rayonnant renvoie à la grande métaphore néo-classique des rayons du regard et au dessin qu’en fit Ledoux, Le Théâtre de Besançon, coup d’œil (gravure de l’ouvrage L’Architecture considérée sous le rapport des arts, des mœurs et de la législation). Il a aussi pour effet de totalement domestiquer le monde naturel. Ainsi, du haut de la falaise, ce qui semble être les rayons naturels d’un soleil filtré par quelque végétation, tombe en courbes rais noirs, auxquels répondent les rais blancs de la cascade canalisée. Il s’agit de « surveiller », voire de « diriger » cette nature, en observant voire réglant son débit trop irrégulier pour un usage rationnel. La nature est menace, le travail réalise la nature et, la rendant utile, en produit l’ami de l’homme. De fait, ce positivisme voit dans le travail la fonction noble qui humanise le chaos du monde existant, en le réalisant.
70) ↑— Champleury sur les paysages de montagnes et de roches de Courbet, cité par Klaus Herding, « Traits de Lumières d’outre-Rhin » in Courbet à neuf, op. cit., p. 210.
71) ↑— Courbet choisirait ainsi la nature et, on le verra, le réel dans la confusion qu’entretient Proudhon entre travail et nature. « Tout être, par cela seul qu’il existe, qu’il est une réalité, non un fantôme, une idée pure, possède en soi, à un degré quelconque, la faculté ou propriété, dès qu’il se trouve en présence d’autres êtres, d’attirer et d’être attiré, de repousser et d’être repoussé, de se mouvoir, d’agir, de penser, de produire, à tout le moins de résister, par son inertie, aux influences du dehors. Cette faculté ou propriété, on la nomme force. Ainsi la force est inhérente, immanente à l’être : c’est son attribut essentiel, et qui seul témoigne de sa réalité. Ôtez la pesanteur, nous ne sommes plus assurés de l’existence des corps. Or, les individus ne sont pas seuls doués de force ; les collectivités ont aussi la leur ». (Pierre-Joseph Proudhon, « Petit catéchisme politique, Du pouvoir social, considéré en lui-même » in De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise, p. 480).
La faculté d’attirer et d’être attiré est une force naturelle, comme l’est le repousser, le mouvoir, le résister. Par contre, l’agir, le penser, le produire ne sont pas forces naturelles de même statut, supposant une conscience et un vouloir. Le premier type de force peut concerner la pierre, l’eau, le cerf ou l’humain ; le second n’est qu’agir humain. Confondant ces forces, Proudhon naturalise le travail et humanise le réel. Ainsi, écrivant « être », il l’anthropologise et pense « homme », oubliant que les humains sont par leur faible masse nullement en capacité d’attirer ou d’être attiré, sinon en langage imagé : à savoir par leur volonté. Et de l’être humain, Proudhon de décliner l’individu, puis le collectif.
Courbet semble bien trier et choisir, ne conservant que la forme qui suit et que l’on peut nommer forces du réel, attribuant à « être » le recouvrement de tout ce qui est, au sens philosophique :« tout être, par cela seul qu’il existe, qu’il est une réalité, non un fantôme, une idée pure, possède en soi, à un degré quelconque, la faculté ou propriété, dès qu’il se trouve en présence d’autres êtres, d’attirer et d’être attiré, de repousser et d’être repoussé, de se mouvoir, à tout le moins de résister, par son inertie, aux influences du dehors. Cette faculté ou propriété, on la nomme force. Ainsi la force est inhérente, immanente à l’être : c’est son attribut essentiel, et qui seul témoigne de sa réalité. Ôtez la pesanteur, nous ne sommes plus assurés de l’existence des corps ».
72) ↑— Courbet, Lettre au Messager de l’assemblée, 19 novembre 1851, cité par Bertrand Tillier, « Un Utopiste à l’épreuve de la vie politique » in Gustave Courbet, catalogue, op. cit., p. 19, écrit : « M. Garcin me nomme le peintre socialiste ; j’accepte bien volontiers cette dénomination. Je suis non seulement socialiste, mais bien plus encore démocrate et républicain, en un mot partisan de toute la révolution, et par dessus tout réaliste ; mais ceci ne regarde plus Mr. Garcin c’est ce que je tenais à constater, car réaliste signifie ami sincère de la vraie vérité ». Ici encore, un regard sur le style littéraire particulier de Courbet éclaire quelque sens caché : du particulier nommé peintre socialiste, il généralise au démocrate, républicain, partisan de toute la révolution, avant, par-dessus tout, d’atteindre la plus grande généralisation : réaliste. Ecartant moqueusement celui qu’il prend à partie comme hors d’une si haute sphère, Courbet insiste : réaliste signifie ami sincère de la vraie vérité ; à savoir, philosophe.
73) ↑— Meyer Shapiro, « Courbet et l’imagerie populaire. Essai sur le réalisme et la naïveté » in Style, artiste et société, pp. 327-328.
74) ↑— James H. Rubin, Réalisme et vision sociale, op. cit ., p. 115.
75) ↑— Tel que l’écrit Bernard Vouilloux du Chêne de Flagey, voir note 26 et la part de texte qui en est le renvoi.
76) ↑— Il peut y avoir chez Courbet une tendance à l’anthropomorphisme paysagé, tel que nettement exploité dans son Paysage fantastique aux rochers anthropomorphes (1865, Musée de Picardie, Amiens) et celui des Gorges de Saillon (1875, collection privée).
77) ↑— Voir Laurence des Cars, « Courbet paysagiste » in Gustave Courbet, catalogue, op. cit., p. 268 : « Ces peintures des profondeurs et des origines ne proposent aucune perspective, aucune régression d’échelle des motifs qui puisse creuser l’espace. Elles imposent au spectateur un mur de matière tactile et charnelle, et osent le noir irrésistiblement attirant et effrayant, en exergue central […]. L’obscurité dominante n’est pas seulement celle de la cavité, elle est aussi celle qui recouvre les fonds de toile de l’artiste et renvoie à une perception du monde venu de l’intérieur, de l’autre côté du miroir de la peinture » ; de l’autre côté du miroir des apparences du monde.
78) ↑— Voir Jacques Lacan, « Le Symbolisme, l’imaginaire et le réel » in Bulletin de l’association freudienne, N°1, pp. 4-13.
79) ↑— Gilbert Titeux, « L’Inquiétante étrangeté de certaines chasses franc-comtoises », in Courbet à neuf, op. cit., p. 275. Il y parle des chasses et la citation complète est : « et si, du fait de son incompréhensibilité fondamentale, le réalisme – cynégétique du moins – de Courbet, c’était précisément cela : la tentative d’un peintre de représenter non pas la réalité, mais le Réel ? Le Réel, c’est-à-dire ce qui s’oppose à l’Imaginaire comme au Symbolique dans la fameuse topique lacanienne, et qui constitue ce qui reste impossible à symboliser, cet ailleurs du sujet chassant, cette réalité désirante qui s’exprime dans la chasse, mais qui reste inaccessible à toute pensée subjective. Ce Réel au fondement du réalisme de Courbet serait alors ce qu’on ne peut ni saisir, ni appréhender, et qui se définit d’abord à partir d’une limite du savoir : un impossible à rejoindre ». Titeux construit sur les chasses, mais il semble que son constat puisse être extensible à tous les paysages de Courbet. Chasse et peinture s’équivalent, dans leur désir de captation, leur réalisation prédatrice, et la réalisation advenue, face au cadavre, la déception : ce qui était désiré n’est pas ce qui fut capturé et néantisé ; ce qui conduit en cercle « vicieux » à une reprise de la traque. Voir aussi note 86 et la part de texte qui en est le renvoi.
80) ↑— Jacques Lacan, Séminaire (1974-75), R. S. I., pp. 13-14.
81) ↑— Jacques Lacan, idem, p. 92. Lacan qui, en 1955, acheta avec Sylvia Bataille L’Origine du monde et la fit cacher non par un rideau mais par un panneau masque conçu par André Masson (Terre érotique, 1955, collection privée).
82) ↑— Ce derrière le support pictural a déjà été perçu comme signe dans L’Atelier où le mannequin sans vie semble pouvoir « regarder » le tableau depuis son revers : voir note 9 et la part de texte qui en est le renvoi. Voir aussi, cette fois à propos des Baigneuses (1863, Musée Fabre, Montpellier), Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., pp. 176-178 : « Les Baigneuses représentent une scène de regard : en l’occurrence, la baigneuse debout se montre d’un côté que nous ne pouvons voir – plus ou moins de face – à sa compagne assise […]. Et si nous adaptons aux Baigneuses une notion d’abord avancée à l’égard du groupe central de L’Atelier et voyons dans la baigneuse debout une synecdoque de la peinture considérée dans son ensemble, il s’ensuit que Les Baigneuses suggèrent une relation à l’œuvre elle-même, dont nous ne verrions que l’envers, et un spectateur qui la voit non pas de notre côté de la surface du tableau mais de l’autre côté, qui serait alors l’endroit de la toile ». La topologie ici décrite est celle de Bouteille de Klein, jouant de l’envers et de l’endroit, à considérer à rebours (voir note 45). Ainsi la main de cette baigneuse semble par ailleurs aller appuyer sur la toile, indiquant par ce geste un sombre arrière toile allant jusqu’au revers, geste qui, A regarder […] de l’autre côté – pour reprendre le titre d’une œuvre de Marcel Duchamp (1918, Museum of Modern Art, New York), serait non un geste qui dit l’appui, mais un interdit : noli me tangere ; ou un inter-dit lacanien : ce qui dit entre, outre la défense de l’entre, ici l’espace pictural d’une représentation sur toile plane.
83) ↑— Maxime Du Camp, Les Convulsions de Paris, T. II, pp. 263-264, cité par Dominique de Font-Réaulx, « Le Nu, la tradition transgressée » in Gustave Courbet, catalogue, op. cit., p. 380.
84) ↑— On notera que les paroles de Du Camp sont révélatrices de son mépris affiché de Khalil-Bey, qu’il ne veut nommer, n’affichant son identité qu’en collant les statuts économiques et religieux (à l’époque des lignes, Khalil-Bey, dont on peut douter qu’il était pratiquant, était ruiné). Ce mépris efface l’autre, son appartenance à la diplomatie ottomane, sa noblesse et son intérêt culturel pour les œuvres occidentales. De même, son aveuglement touche l’altérité du renouvellement courbésien de la peinture française et son incompréhension du réalisme, au point qu’il le confonde à l’idéalisme des italiens, dont la seule réalité est d’avoir été reconduit « en même » par l’art néo-classique, faisant ainsi effet de vérité du modèle. C’est cette attitude consistant à croire pouvoir s’élever au-dessus de ce qui est qui empêche Du Camp de voir ce qui est peint, de comprendre cette advenue de l’altérité qu’ouvre L’Origine du monde.
85) ↑— Ainsi à Du Camp, qui semble n’avoir aussi aucune considération pour le fond philosophique des « charcuteries » de Sade, on peut opposer Lacan : « pour qui est encombré du phallus, qu’est-ce qu’une femme ? C’est un symptôme. C’est un symptôme et ça se voit, ça se voit de la structure là que je suis en train de vous expliquer. Il est clair que s’il n’y a pas de jouissance de l’Autre comme telle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de garant rencontrable dans la jouissance du corps de l’Autre qui fasse que jouir de l’Autre comme tel ça existe, ici est l’exemple le plus manifeste du trou, de ce qui [ne] se supporte que de l’objet a lui-même, mais par maldonne, par confusion. Une femme, pas plus que l’homme, n’est un objet a ». (Jacques Lacan, R. S. I., op. cit., pp. 64-65). Il est aussi à noter que si pour l’artiste et son collectionneur, Le Sommeil de Courbet (1866, Musée du Petit Palais, Paris) pouvait faire pendant au Bain turc d’Ingres (1862, Musée du Louvre, Paris), L’Origine fait plutôt réponse : l’oculus du Bain fait croire que nous voyons la scène à travers quelque œilleton, en pur voyeur accédant, caché, à la visibilité ; le rideau de L’Origine averti d’emblée que la question sera non celle du visible, mais du visuel ; des conditions de la visibilité – ou de son impossibilité.
86) ↑— Lacan avait par ailleurs un terme pour l’ordure : palea, qui s’oppose à l’agalma, dans l’incessante recherche, à jamais atteignable de l’objet a ; voir sur ces aspects Jacques Lacan, L’Angoisse, pp. 204 sqq. On peut, à ce stade, relire la note 79 où, suite à Gilbert Titeux, s’établit l’équivalence entre chasse et peinture. Au désir de captation de l’objet a, sa quête de l’agalma, et l’objet partiel comme réalisation advenue, suit la déception : ce qui était désiré n’est pas ce qui fut capturé et néantisé, le palea du cadavre ou de la peinture achevée ; ce qui conduit en cercle « vicieux » à une reprise de la traque, que ce soit celle de rechasser, de repeindre ou de regarder. L’Origine se referme ainsi en trou sur elle-même et referme le regard en trou sur lui-même. En ce sens, le dialogue ambigu que Marcel Duchamp entretint avec Courbet trouve bien une résolution dans Etant donnés 1°La chute d’eau 2°Le gaz d’éclairage (1968, Philadelphia Museum of Art) : entré par le trou d’un œilleton de porte, le regard se heurte à un trou sexué et est renvoyé au trou du regard (malgré la vivacité d’un bec auer et le frémissement d’une cascade qui s’offrent à sa vue). Voir aussi notes 88 et 91.
87) ↑— Hors le mépris affiché par Du Camp, le nécessaire rapport de l’artiste à l’argent, dès le moment où il n’est plus « un monsieur plus ou moins à la solde d’un roi ou d’un empereur, ou même d’un groupe de collectionneurs » (Marcel Duchamp, à propos de Courbet, Entretien avec Alain Jouffroy, p. 11), est largement explicitée par l’artiste dans sa correspondance. Sur ce sujet, qui à cause de la soi-disant intégrité politique que l’on devrait à un artiste « réaliste », fait condamner son rapport à la plus simple économie, soit à la survie, voir entre autre Jérôme Poggi, « Le Réalisme économique de Gustave Courbet » in Courbet à neuf, op. cit., pp. 227-244.
88) ↑— Pour le plan de l’appartement de Khalil-Bey, voir les Archives de Paris, D1 D4 1114-3, rue Taitbout (9e arr.), 1862. L’occultation derrière le mur annonce bien la paroi muséale sur laquelle se présente la porte de grange munie de deux œilletons conçue par Marcel Duchamp pour Etant donnés (voir note 86), comme anticipant la visibilité qui allait advenir à L’Origine du monde, lorsque léguée par dation à la République française, elle s’expose non doublement cachée mais doublement encadrée, au mur du Musée d’Orsay. Il est révélateur de mettre en rapport la fonction du voile selon Lacan et la question benjaminienne de l’aura : « on peut même dire qu’avec la présence du rideau, ce qui est au-delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile se peint l’absence […]. Le rideau, c’est, si l’on peut dire, l’idole de l’absence » (Jacques Lacan, La Relation d’objet, p.155). Et Benjamin : « la production artistique commence par des images qui servent au culte. On peut supposer que l’existence même de ces images a plus d’importance que le fait même qu’elles sont vues […]. Cette image est certes exposée aux regards de ses semblables, mais elle est destinée avant tout aux esprits. Aujourd’hui, la valeur cultuelle en tant que telle semble presque exiger que l’œuvre d’art soit gardée au secret […]. A mesure que les différentes pratiques artistiques s’émancipent du rituel, les occasions deviennent plus nombreuses de les exposer […], [la] valeur d’exposition lui assigne des fonctions tout à fait neuves, parmi lesquelles il se pourrait bien que celle dont nous avons conscience – la fonction artistique – apparaisse par la suite comme accessoire ». (Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (dernière version de 1939) » in Œuvres III, pp. 283-285). Ainsi exposée à Orsay, L’Origine apparaît aujourd’hui, en un premier temps, dans un refus de l’altérité, pornographique, comme elle le fut pour Du Camp ; puis rapidement dans un système de conformité au « même », elle n’est plus qu’un phénomène culturel. Pour en retrouver le sens que Courbet, Khalil-Bey, puis Lacan y trouvaient il faudrait la revoiler, lui redonner un sens cultuel, aussi profane soit-il ; ce que fit Duchamp avec Étant donnés.
89) ↑— Tous les témoignages de l’époque évoquent un rideau au singulier. Il semble logique que Khalil-Bey tire ce rideau unique de sa main droite, tournant le dos à ses invités. L’Origine se dévoilerait de fait de droite à gauche.
90) ↑— Bernard Vouilloux, « Les Beaux morceaux de M. Courbet » in Courbet à neuf, op. cit., p. 189.
91) ↑— Ainsi, L’Origine appelle les toiles fendues au cutter de Lucio Fontana (à l’exemple de Waiting, 1960, Tate) ; actes assez vulgaires, parce que trop simples dans leur immédiate radicalité ; ou la question des Moules chez Marcel Duchamp, alors qu’il concevait La Mariée mise à nu par ses célibataires, même ou Grand verre (1915-23, Philadelphia Museum of Art), par ailleurs transparent, donc à vision réversible, mais dont les aspects dicibles et concevables, proposés par le mode d’emploi annexé de La Boîte verte (1934, multiple dont un au Centre Pompidou, Paris) échappent à tout entendement logique.
92) ↑— Paul-Louis Robert, « Les Empreintes photographiques de Gustave Courbet » in Courbet à neuf, op. cit., p. 120, rappelle que Baudelaire, dans « Le Public moderne et la photographie », op. cit., regrette « la disparition, chez l’artiste moderne de […] la reine des facultés, l’imagination » ; Courbet répond et dépasse la critique baudelairienne : ce n’est pas l’absence d’imagination mais l’inimaginable qui ressort de L’Origine du monde. Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., a une juste description de ce privatif par débordement de l’imaginaire lorsqu’analysant, pp. 64-67 les Autoportraits ou p. 129 sqq. L’Enterrement, il constate l’analogie entre inimaginable et débordement pictural au seuil des images. Ce que Fried n’analyse pas est que L’Origine est manifeste non d’un débordement mais d’une clôture, qui nous empêche de voir un externe de l’image, qui plus est de l’imaginer ; et d’un engouffrement, qui attire non pas hors image mais en elle, l’outrepassant en trou, dans un en deçà qui est l’inimaginable.
93) ↑—
94) ↑— L’idée d’opposition suivie ici est un chiasme très héraclitéen. Notons que Proudhon, qualifié en son temps de nouvel Héraclite, fait appel à la notion de mouvement et de dynamisme contradictoire de la nature comme force. Sur ce sujet, voir Chakè Matossian, Saturne et le sphinx, op. cit., pp. 65-66. Sur le monstre et la notion de daimon, idem, pp. 147-148.
95) ↑— Est entendu par ontologie sa définition philosophique contemporaine : « partie de la philosophie qui a pour objet l’élucidation du sens de l’être considéré simultanément en tant qu’être général, abstrait, essentiel et en tant qu’être singulier, concret, existentiel » (CNTRL, op. cit.).
96) ↑— Vagues qui connaissent de nombreuses variantes et copies, nécessité économique oblige (voir note 87).
97) ↑— Cette vue de tiers de la vague se brisant pourrait être inspirée par le modèle d’Hokusai (La Grande Vague de Kanagawa, 1830-31, multiple dont un exemplaire au Musée Guimet, Paris), estampe largement médiatisée à Paris, peut-être dès 1856 par Bracquemond, mais dont on ne sait si Courbet avec connaissance.
98) ↑— D’après Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle, p. 48. On peut aussi renvoyer à ce commentaire, d’Elena Terblom, L’Ourlet de la chose : « je me disais que quelque chose restait inaccessible, irreprésentable, et que c’était ce quelque chose qui m’intéressait. Cela, ce sans-nom n’avait rien de spirituel, de transcendant ou de divin, il n’avait rien à voir avec un Dieu, et pourtant il était invisible - mais ce mot-là, invisible, ne convenait pas. C’était un machin, un truc, Zeug comme on dit en allemand. J’aurais pu renoncer à le désigner […], je voulais des mots, et je continuais à buter sur ce problème de vocabulaire. […] Bien sûr, je comprenais la contradiction. Pourquoi chercher un mot pour désigner l’innommable ? Mais je ne renonçais pas. Je n’arrêtais pas d’y penser jusqu’à la répugnance, au dégoût - et c’est probablement ça, le dégoût, qui m’a permis d’avancer. Le dégoût est proche de ce que je cherche, il est tout à fait au bord du langage. Il est tout-autre, aux limites de l’artChose, en ce point qu’aucun savoir, aucun logos ne peut appréhender ».
99) ↑— Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., p. 145.
100) ↑— Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, Ende 1870–April 1871, NL11[1]7.351.
101) ↑— Guy de Maupassant, « La Vie d’un paysagiste » in Revue Gil Blas du 20 septembre 1886.
102) ↑— Paul Cézanne, propos rapportés par Joaquim Gasquet, « Ce qu’il m’a dit » in Conversations avec Cézanne, p. 144.
103) ↑— Voir Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., pp. 143-144 : « Nous avons enfin vu la mer, la mer sans horizon (que c’est drôle pour un habitant du vallon) [Courbet, lettre à ses parents, été 1841]. Sans horizon, la mer ? Ne découvre-t-on pas au contraire l’horizon terrestre à sa surface ? Courbet énoncerait-il ici une évidente contre vérité ? Certes, la mer dessine l’horizon terrestre, mais en soi elle n’a pourtant pas de limites, parce qu’elle outrepasse celles de notre regard ; en ce sens elle apparaît bien sans horizon pour nous […] son absence d’horizon pour nous la définit bien en soi ».
104) ↑— Jean Paul Sartre, La Nausée, pp. 178-185. Existentialiste, Courbet ? Voir à ce propos note 56. Les racines du marronnier appellent en tous les cas un paysage de gouffre tardif de Courbet, Le Vieil arbre dans une gorge (1872, Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne). Ces racines s’agrippent comme une glu à la roche, arrachant l’arbre ployant à l’obscurité du gouffre, montrant que « l’existence est un fléchissement » (Sartre, idem, p. 180).
105) ↑— Réécriture de Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur, op. cit., pp. 15-18, voir note 56 et la part de texte qui en est le renvoi.
106) ↑— Elena Terblom, L’Ourlet de la chose, op. cit.
107) ↑— Mais Courbet écrit à Castagnary, le 18 janvier 1864, cité par Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., p. 112 : « Si on pouvait expliquer les tableaux, les traduire en parole, il n’y aurait pas besoin de les peindre ».
108) ↑— Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, pp. 81 et 85-86. Cet appel est construit par le lien tissé entre Courbet et la phénoménologie par Paul Galvez, « Landscape and phenomenology » in Courbet à neuf, op. cit., pp. 165-172, qui cite à plusieurs reprises Merleau-Ponty.
109) ↑— Sur la réception contemporaine à Courbet relativement à la photographie, voir notes 30 à 33 et la part de texte qui en est le renvoi. On peut y répondre avec Maurice Merleau Ponty, L’Œil et l’esprit, op. cit., p. 80, que « la photographie maintient ouverts les instants que la poussée du temps referme aussi tôt, elle détruit le dépassement, l’empiétement, la métamorphose du temps, que la peinture rend visibles au contraire ».
110) ↑— Neutre, au sens de Maurice Blanchot, voir note 55.
111) ↑— Maurice Merleau-Ponty, Signes, p. 21.
112) ↑— Rétentif, voir note 59. Capter et retenir, à savoir : capter, du dehors au dedans ; retenir, de dedans à dedans ; et l’acte manquant et de dedans à dehors. Soit : ce qui s’affirme comme existant chez l’existé peut exister en l’existé ; mais en aucun cas l’existé ne peut aller positivement vers ce qui s’affirme. Remis en un autre langage : ce qui s’affirme de l’Être chez l’étant peut être en tant qu’être étant ; mais en aucun cas cet être étant ne peut aller positivement vers l’Être. L’approche ne peut-être que négative, par le manque, le trou, l’absence ou l’irreprésentable, derrière toile, outre-monde – dans ce creux de la peinture qui a été ici traqué.
113) ↑— Jacques Derrida, L’Ecriture et la différence, p. 317. Derrida développe la question d’un serrage par frayage de l’invisibilité, en particulier dans Mémoires d’aveugle, op. cit.
114) ↑— Voir, entre autres, Jean-Luc Marion, « La Certitude de Cézanne » in Courbet, op. cit., pp. 159-196. Certes Cézanne semble reprendre le « trou noir » de Courbet pour en faire naître sa « vérité en peinture », mais ce en développant, par dessus l’obscur, la surface phénoménologique du visible, annonce d’une structure formelle sans en deçà. Le cubisme se fourvoiera dans ce qui s’énoncera comme un formalisme, élaborant une structure plastique et une grammaire des apparences graphiques ; bien loin de la question de l’Être tel que le trou courbésien l’ouvre.
115) ↑— À propos de sa Composition suprématiste : quadrangle blanc sur fond blanc (1918, Museum of Modern Art, New York), Malevitch écrira : « [la] volonté [de l’artiste est] enfermée entre les murs des surfaces esthétiques au lieu d’une pénétration philosophique [...]. J’ai troué l’abat-jour des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc, voguez à ma suite […] dans l’abîme […]. J’ai vaincu la doublure du ciel coloré après l’avoir arrachée, j’ai mis les couleurs dans le sac ainsi formé et j’y ai fait un nœud. Voguez ! L’abîme libre blanc, l’infini sont devant vous » (Kasimir Malevitch, « Le Suprématisme » in Catalogue de l’exposition non figuration et suprématisme).
116) ↑— Positiviste et utopiste, Malevitch enferme la question dans un sac (voir note 115) et nous expose le reste, mais où demeure le sac ? Courbet nous présente ce sac pour nous y enfermer et nous a-expose la question : de l’abîme noire, où est le libre blanc infini ? Ainsi, moins hégélien, ce que Courbet « présente, ce ne sont pas les idées de la raison, mais le chaos, l’abîme, le sans fond, à quoi il donne forme. Et par cette présentation, il est fenêtre sur le chaos, il abolit l’assurance tranquillement stupide de notre vie quotidienne, il nous rappelle que nous vivons toujours au bord de l’abîme » (Cornelius Castoriadis, « La Culture dans une société démocratique » in La Montée de l’insignifiance, p. 202).
117) ↑— Heideggerien, peut-être ? voir note 56 ; ce avec les concepts de monstration, laisser voir et sous regard de Martin Heidegger, Sein und Zeit, § 7, « das Sich-an-ihm-selbst-zeigende » (« ce-qui-se-montre-en-lui-même », ainsi traduit par Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., p. 194) et Remarques sur art-sculpture-espace : « Mais que veut dire plus philosophique ? Philosophique est le laisser-voir qui met sous le regard l’essentiel des choses ».
118) ↑— Le rapprochement avec Rothko s’impose et surtout éclaire la tentative de Courbet : les […] bandes comblent l’espace avec une extrême simplicité de moyens, libérant un horizon à la fois vide (de détails, de silhouettes, d’incidents) et saturé (de couleurs […] ) ». Jean-Luc Marion, Courbet, op. cit., p. 145.
119) ↑— En opposition totale à Michael Fried, Le Réalisme, op. cit., p. 236 (voir note 52), il faudrait écrire : même si Courbet fut un maître dans l’art de peindre des figures, il ne fut pas essentiellement peintre de figures mais paysagiste : le sens de ses peintures de figure n’apparaît tout à fait qu’en regard de ses paysages. Et laisser la phrase de Fried intacte pour Giacometti : « il ne fut pas essentiellement paysagiste mais peintre de figures : le sens des paysages [(par exemple Landschaft bei Stampa, 1952, Bünder Kunst Museum, Coire), natures mortes ou dessins d’intérieur] n’apparaît tout à fait qu’en regard de ses peintures [et sculptures] de figures ».
120) ↑— Décrire Giacometti comme une « sorte de rocher gris et large, hirsute, horripilé, terrifié ; terrifié par sa force, sa dureté, terrifié par sa stupeur, terrifié par la nuit, par ses rêves et les apparitions de formes grêles et menaçantes autour de lui » (Francis Ponge, Réflexions sur les statuettes, figures et peintures d’Alberto Giacometti), est le saisir tout à l’inverse de l’ample, gros, gras, vulgaire Courbet. Il en va de même des sculptures, ramenées à leur âme de fer, au squelette (voir Paola Carlotta, Monsieur Giacometti, je voudrais vous commander mon buste, pp. 56-60), à opposer aux masses grasses maçonnées par Courbet. Inverses sont la capacité de trouver de Courbet et la hantise de rater chez Giacometti, l’ajout et la suppression ; comme sont aussi opposées les combes jurassiennes et les pics grisons. (NB : l’auteur est familialement doté de ces doubles lieux d’origine).
Bibliographie et Œuvres citées : voir le site de l'auteur.
Avec l'aimable autorisation de l'auteur, Christian Perret.






















































