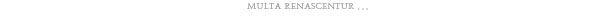« Que l'on soit descendu des hauteurs du Pinde où l'on s'obstinait quand même à rester, pour entrer un peu plus dans la vie réelle, on a très bien fait ; mais, comme toutes ces oscillations humaines, une fois l'élan donné, on arrive à l'excès contraire. Chaque chose dans la nature a un rôle à remplir qui lui est plus ou moins circonscrit. Vous ne ferez pas que les diamants et les pierres précieuses deviennent jamais des boutons de culottes de ramoneurs ; attendez l'art architectural adapté aux chaumières ! Il y a des arts qui sont d'essence divine ; héroïques, leur but est d'élever… La sculpture est patricienne ; elle ne peut devenir démocratique que comme monuments nationaux, et presque toujours sous forme allégorique. C'est une inscription cosmopolite qui a ses lois, sa tradition, fondées sur le sens commun. Je sais bien que, outre les lois du grand art, il y a la fantaisie, le caprice, qui sont quelquefois curieux, amusants et même intéressants. Mais, en sculpture, l'idée est tellement circonscrite qu'elle n'est, pour ainsi dire, rien par elle-même ; c'est sa forme, sa façon qui la rendent quelque chose ; sans forme, ce n'est rien… Rappelez-vous qu'il faut se mettre à genoux devant la nature ; il faut aimer sa passion jusqu'à en devenir mélancolique pour se plaire dans la solitude… »
J.-J. Perraud, lettre à Max Claudet

Max Claudet Fécamp, 1840 - Salins-les-Bains, 1893
La Renommée, c'est son bon plaisir, souffle dans ses trompes de manière fort partiale, aléatoire dirait-on. Même si l'Histoire justifie souvent ses choix, rien pourtant ne nous empêche de trouver quelque peu iniques certains de ses divins accords et, dans certaines occurrences, désolante l'absence de ceux-ci. Il ne nous appartient évidemment pas de discuter de la pertinence et du bien-fondé de ces derniers mais il reste néanmoins que le nôtre, notre bon plaisir "à nous", bien moins puissant il est vrai mais tout aussi partial, consiste en un modeste et lancinant air de flûte destiné à faire remonter de certains limbes le souvenir de ceux qui, ayant abandonné tout espoir, s'y trouvent malheureusement ferrés.
Max Claudet fait indubitablement partie de cette sorte d'artiste à laquelle le fatum n'a que partiellement sourit et à qui les "cinq cents mains pour empoigner le hasard aux cheveux" ont cruellement manqué… Sa "gloire" n'a guère dépassé les frontières de notre province voire celles, plus restreintes encore, du département du Jura. Jusqu'à la fin du dernier siècle (le xxe) un musée municipal à Salins-les-Bains portait son nom, il a laissé la place à un nouveau musée, plus attractif peut-être, consacré à l'industrie du sel… Il ne me semble pas non plus qu'aucune rue de Salins ne porte son nom. Il y a toujours une fontaine sur une placette qui arbore bien fièrement la statue d'un vigneron un peu mélancolique et qui témoigne de l'activité de l'artiste ici, et également la tombe de Max Buchon avec un buste et une plaque en bronze au cimetière municipal.
La sculpture de Max Claudet tient à la fois de l'Académisme, défendu par son mentor le sculpteur lédonien Jean-Joseph Perrault, pour la forme, et du Réalisme que Courbet et les idées socialisantes de l'époque avaient mis au goût du jour, pour le fond, mais sans toutefois déborder de la sphère sociale, de la scène de genre.
Claudet, même s'il se mêle de politique dans le cadre un peu étriqué de la municipalité où il tient un rôle de premier plan sur la scène des querelles publiques (pamphlets, articles, croquis satyriques…), reste et demeure un bourgeois cultivé menant à la loge Claudet (c'est ainsi que l'on nomme la propriété où habite l'artiste à la sortie de Salins en direction de Champagnole) une vie dédiée à l'art et à la culture. Il reçoit chez lui ce que l'intelligentsia locale compte d'esprits brillants et aménage à la loge Claudet un petit musée privatif pour son plaisir et celui de ses invités.
Max Claudet se marie "sur le tard", à presque 40 ans. Il épouse en 1879 Julie Besson avec qui il formera un couple d'artistes qu'on qualifierait peut-être aujourd'hui de fusionnel. Épouse attentionnée elle est également son élève : « Julie, femme de distinction par sa personne, par son intelligence et par son cœur (Henri Chapois) fut l'épouse attentionnée et l'élève de Max Claudet. Il l'initia à la sculpture et à la céramique. Julie a adressé aux Salons des Artistes Français de 1885 et 1889 des petits médaillons représentant son fils. Elle composa des vases et des cache-pots de céramique, ornés de fleurs artistiquement modelées. Julie collabora avec son époux à la réalisation de plats et d'assiettes décoratives surchargés de ces mêmes motifs floraux, qu'ils signèrent ensemble. » (in : Daniel Clot, Gilles Saint Sever, Max Claudet, statuaire et céramiste salinois, Salins-les-Bains, 2010 )
Claudet pratique la céramique depuis le début des années 1880. Les circonstances de cet apprentissage restent assez floues, il semble qu'il ait travaillé avec la faïencerie Salins-Capucins mais également avec celle située à Nans-sous-Sainte-Anne, petit village faïencier situé à 10 km au nord de Salins. Toujours est-il que l'activité faïencière de Salins (activivité qui perdurera jusqu'aux années 1980) est plus que probablement à l'origine de la dilection de Claudet pour l'art céramique.
Si sa sculpture en ronde bosse est un peu convenue, conventionnelle et manque pour tout dire d'un peu d'audace et de fantaisie, il en va tout différemment pour sa production céramique marquée par le courant néo-palissyste dont la production connaît à la fin du xixe siècle un prodigieux regain d’intérêt. Les thèmes, la facture, les coloris, la dérision parfois, la profusion ou encore la profondeur des sujets abordés, tout concourt à mettre en exergue ce travail du feu et des émaux. Ses grands plats émaillés présentant des scènes bibliques, de l'Antiquité ou encore dédié à la mémoire de personnages illustres gardent depuis presque 150 ans une fraîcheur et un attrait que l'art du statuaire pourrait difficilement soutenir.
Max CLaudet meurt le 28 mai 1893 des suites d'une bronchite. Son fils Georges, formé à l'école des Arts Décoratifs et à l'école des Beaux-Arts poursuivra l'œuvre paternelle.
DAS
⇒ De Artibus Sequanis, Max Claudet.
⇒ Daniel Clot, Gilles Saint Sever, Max Claudet, statuaire et céramiste salinois, Salins-les-Bains, 2010.
⇒ Le monde étrange de Max Claudet, céramiste à Salins à la fin du XIXe siècle, 2010. Cahier de l'exposition présentée au musée de Pontarlier en 2010.
⇒ Emmanuel Vingtrinier, Max Claudet, statuaire salinois, Revue du Lyonnais, recueil historique et littéraire, 1880, Paris.