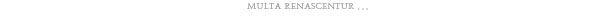« Parmi les peintres de ce temps en Europe, nul n'a égalé Courtois dans l'expression graphique de l'horreur de la bataille. »
Le Bernin,
in : F.A. Salvagnini, I pittori borgognoni Cortese, Rome, 1937.
« Rien n'est si recherché que ses ouvrages ; l'on y apperçoit un feu & une intelligence qu'on ne trouve point dans les autres peintres de batailles. »
Antoine Joseph Dezallier d’Argenville,
in : Abrégé de la vie des plus fameux peintres,
t. IV, Paris 1762.

Jacques Courtois, Saint-Hippolyte, 1621 - Rome, 1676
Parmi les 540 œuvres des 167 peintres exposés au Muséum central des arts de la République (le Louvre donc) lors de son ouverture au public le 8 novembre 1793, se trouvaient quatre tableaux du Franc-Comtois Jacques Courtois, le Bourguignon des batailles.
Jacques Courtois est né en 1621 à Saint-Hippolyte dans le Doubs dans une famille de peintres dont tout l'art ressortissait plutôt à une sorte d’artisanat que l’on se transmettait de père en fils. Dans cette première moitié du xviie siècle, la guerre de Dix Ans (1634-1644), épisode franc-comtois de celle de Trente Ans, s’accordant funestement avec la peste noire et la famine, dévasta la Franche-Comté en décimant environ 60% de sa population et laissant ainsi le comté de Bourgogne, au propre comme au figuré, exsangue.
Jacques Courtois comme bon nombre de ses compatriotes choisit, ou plus probablement fut contraint à l’exil. Sans le sou et tout juste formé aux subtilités de son art (il n’avait que 15 ans), il trouva d’abord à s’enrôler dans l’armée du Milanais, cette région étant à ce moment-là, à l'instar de la Franche-Comté, sous l'autorité des Habsbourg d’Espagne.
Cette armée était commandée par Charles de Watteville lui-même d’origine franc-comtoise. Cet épisode militaire qui dura trois années fut aussi l’occasion pour Courtois de peindre des paysages mettant en scène les faits d’armes du maître de camp, préludant ainsi à ce qui ferait son succès quelques années plus tard. De Watteville aurait également demandé au jeune Courtois de terminer des portraits inachevés de Diego Velázquez… (selon Filippo Baldinucci, un des biographes de Courtois, xviie s.)
Après trois ans de cette vie martiale, Courtois reprit son périple vers Rome où se trouvait implantée une forte communauté de Bourguignons (“Bourguignon” désignant au xviie s. les seuls Francs-Comtois) « […] on comptoit qu’ils estoient à Rome dix ou douze mille Bourguignons de tout sexe » (Jean Girardot de Nozeroy, Histoire de dix ans de la Franche-Comté de Bourgogne)
Il s’arrête quelque temps à Bologne, il y rencontre Guido Reni et l’Albane. À Florence ensuite il travaille avec Jan Asselijn, peintre de bataille et enfin à Sienne où il peint des caprices et des paysages dans l’atelier d’Astolfo Petrazzi.
Courtois arrive à Rome vraisemblablement au début de 1640.
Cette première période romaine dure environ 10 ans pendant lesquels il parfait sa technique, rencontre Bamboche, Pierre de Cortone et Cerquozzi, le fameux « Michelangelo des Batailles ». Sa carrière démarre doucement, peut-être aidé par l’entregent de de Waterville, mais à la fin de cette première période la vente de ses tableaux lui assure une vie relativement confortable. Il travaille notamment pour la famille papale, pour le pape lui-même, Innocent X Pamphilj et, sans abandonner la peinture de paysage, se spécialise dans la peinture de bataille très en vogue à cette époque.
Un épisode quelque peu scabreux ponctue cette vie déjà bien remplie. La relative aisance de Courtois lui permet de fonder un foyer et il épouse vers 1646 Anna Maria Vaiani, un peintre de près de 20 ans son aînée, amie de Galilée, et qui était déjà une artiste accomplie, ayant travaillé pour la famille papale. La vie conjugale est rapidement tumultueuse et se termine, dans un premier temps, par une séparation. Courtois semble avoir été terriblement jaloux. Son épouse meurt en 1654 et plusieurs des biographes de Courtois allèguent, à tort à ce qu’il semble, qu’il a été convaincu d’empoisonnement et que son enrôlement chez les Jésuites (son noviciat n’a pourtant lieu qu’à la mi-décembre 1657) ne serait qu’une échappatoire pour se dérober à d’éventuelles poursuites judiciaires… cold case…
Toujours est-il qu’à partir de 1650 il n’est plus à Rome qu'épisodiquement. Courtois travaille à Florence et peint pour Mattias de Medicis deux pendants célébrant les victoires militaires de ce dernier, conservés à la Galerie Palatine du Palais Pitti à Florence : La Bataille de Lützen et La Prise de la forteresse de Radicofani. Entre les deux séjours qu’il fit à Florence (vers 1650 et 1656/57) on retrouve Courtois à Fribourg (1655) où deux de ses sœurs, Anne et Jeanne, avaient rejoint la communauté religieuse des Ursulines fuyant elles aussi leur pays dévasté par la guerre. Les Ursulines, faute de pouvoir subvenir aux besoins matériels de l’impétrante, exigeaient de cette dernière le versement d’une sorte de dot. Jacques et son frère Guillaume, peintre renommé également, s’engagèrent donc auprès de la communauté à faire « touts les Tableau de [l’] Esglise, et aprire a ladite Anne perfaitemant a crayonner » en sus d'une somme d'argent. Jacques poursuivit son périple jusqu’à Saint-Hippolyte pour “liquider” l’héritage de ses parents décédés.
Retour en Italie, 1655-1657. Étapes à Milan, Bergame (plusieurs tableaux dans la région) et surtout Venise où il entre au service de Nicolò Sagredo, futur doge de la Sérénissime. Il travailla notamment à la décoration du palais Sagredo (Passage de la Mer Rouge, Bataille de Rephidim, Entrée des Israélites en Terre promise et Josué arrêtant le soleil).
Puis vers 1656/57 nouveau séjour en Toscane, à Sienne. Nombreux tableaux pour Mattias de Medicis (Bataille de Nördlingen, et deux épisodes de la première guerre de Castro, la Prise de Radicofani et la Bataille de Mongiovino)
À la fin des années 1650 débute la deuxième période romaine de Courtois (1657-1676) et une deuxième vie, longue de presque vingt années, placée sous le signe de son engagement religieux dans la compagnie de Jésus. Engagement tardif mais qui semble tout à fait sincère et où perce « ses origines franc-comtoises, et sa jeunesse dans une province au catholicisme exclusif et pour longtemps ultramontaine ». Courtois abandonne sans regret sa vie aisée de peintre reconnu pour les mortifications et les rudes contingences de la vie des Jésuites. Ces derniers l’emploient rapidement à la décoration des maisons de l’Ordre mais Courtois n’est pas un peintre de grands formats, il ne finira d’ailleurs jamais les cycles entrepris pour son Ordre et, ce qui devait être son opus magnum, la décoration de la tribune de l’église du Gesù (Rome), est interrompu par la mort de l’artiste, cloué par une attaque d’apoplexie en 1676.
La guerre de dix ans, presque parfaitement oubliée aujourd’hui en Franche-Comté, est l’arrière plan nébuleux, le sfumato, où s’est déroulée la vie hors du commun du peintre Jacques Courtois que le travail de recherche de Mme Lallemand-Buyssens, notamment, à qui cette brève biographie doit l’essentiel, permet de redonner un peu de lustre.
Jacques Courtois, le Bourguignon des batailles, fait partie de ces artistes célébrés de leur vivant et ayant connu également une gloire posthume mais que la poussière des siècles a fini par ensevelir à l’ombre d’obscures cimaises. Il laisse pourtant une œuvre considérable, présente dans de nombreux musées, qui témoigne, dans une Europe tourmentée politiquement et religieusement, dévastée pour une bonne part par les guerres de religion, de l’engouement pour ces nombreux artistes, dont Jacques Courtois fut un des plus illustres, qui donnèrent, au xviie s, ses lettres de noblesse à la peinture de bataille.
DAS
⇒ De Artibus Sequanis, Jacques Courtois.
⇒ Nathalie Lallemand-Buyssens, Jacques Courtois dit le Bourguignon, (alias Giacomo Cortese detto il Borgognone), 1621-1676, Biographie critique et analyse de l’œuvre, thèse, Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II.
⇒ Nathalie Lallemand-Buyssens, Jacques Courtois (1621-1676) n'était pas qu'un peintre de batailles, in Recherches en Histoire de l'Art, n°. 6, 2007, p. 49-59.
⇒ Nathalie Lallemand-Buyssens, Jacques Courtois et Salvator Rosa, in Salvator Rosa e il suo tempo, 1615-1673, Rome, 2010, p. 357-371.
⇒ Nathalie Lallemand-Buyssens, Rome ou les deux vies de Jacques Courtois, in Bulletin de l'Association des Historiens de l'Art italien, n°. 17, 2011, p. 99-105.
⇒ Antoine Joseph Dezallier d’Argenville (1680 - 1765), Abrégé de la vie des plus fameux peintres/ Jacques Courtois, tome 4 , Paris, 1762.
⇒ Filippo Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, 6 vol., Florence, 1681-1728, vol. VI, p. 417-426.
⇒ Edward Holt, The Jesuit Battle-Painter:Jacques Courtois (le Bourguignon), in Apollo, no. 85, mars 1969, p. 212-223.
⇒ Leone Pascoli, Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni, 2 vol., Rome, 1730-1736, vol. I, p. 63-87.
⇒ Francesco Alberto Salvagnini, I pittori Borgognoni (Courtois) e la loro casa in piazza di Spagna, Rome, éd. Fratelli Palombi, 1937.
⇒ Georges Blondeau, L'œuvre de Jacques Courtois, dit le Bourguignon des Batailles, Réunion des sociétés savantes des départements à la Sorbonne, p. 114-156,Section des beaux-arts, Ministère de l'instruction, 1914.
⇒ Eugène Muntz, Jacques Courtois, in Biographies inédites des peintres Simon Vouet, Jacques et Guillaume Courtois, par le romain Nicolas Pio, 1724.
⇒ G. Locatelli, Per la biografia di Giacomo Cortesi (Courtois) detto il Borgognone delle Battaglie, Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo, N° 2-3, 1909
⇒ Charles Blanc, (1813-1882), Histoire des peintres de toutes les écoles / Jacques Courtois, tome 8.
⇒ Robert-Dumesnil, (1778-1864), Le Peintre graveur / Jacques Courtois, tome 1, Paris, 1835.